Frédéric Barbier, L’Europe de Gutenberg. Le livre et l’invention de la modernité occidentale (XIIIe-XVIe siècle)
Paris, Belin, 2006, 364 p., ill. (« Histoire & société »). ISBN 2-7011-4203-2
Yann SORDET
Paris
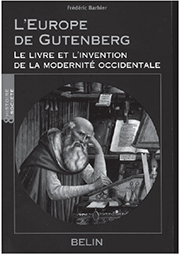
La problématique des mutations de l’écrit est familière à Frédéric Barbier. En publiant les actes du colloque Les Trois révolutions du livre (2001), il avait défini, pour comprendre les trois bouleversements majeurs qui ont affecté l’histoire du livre (le gutenbergien au XVe siècle, l’industriel aux XVIIIe et XIXe, l’électronique aux XXe et XXIe), une approche construite autour de trois grands principes méthodiques. Ce sont ceux que nous retrouvons au fondement de l’Europe de Gutenberg : 1) le long terme, qui autorise à appliquer à ces événements différents des questionnements proches ; 2) une perception globale et intégrée du média, attentive aux relations étroites entre innovations techniques, initiatives commerciales, formes des objets et modes de consommation ; 3) la prise en considération d’un espace géographique large, qui permet d’observer à l’échelle de l’Europe entière, dans un souci comparatiste, des rythmes différenciés de mutation, et de mesurer le rôle du livre dans la constitution des géographies linguistiques, économiques, politiques ou religieuses.
Un demi-siècle après la publication de l’Apparition du livre, et comme en un écho que confirme la dédicace à Henri-Jean Martin, l’auteur reprend ici l’analyse des modalités et des conséquences de l’invention de l’imprimé dans l’espace européen. Il convoque cinquante ans de recherches en histoire du livre, mettant également à profit des modèles d’analyse récents de type économique (le capital-risque, la logique des start-up), des approches globales qui sont celles des historiens de la communication et de la médiologie, et exploitant les données statistiques fournies par les outils bibliographiques les plus à jour. Des prémisses de la « Renaissance scribale » au tournant des XIIe et XIIIe siècles, jusqu’à la Réforme, l’ouvrage est organisé en trois volets, consacrés respectivement aux conditions de possibilité de l’apparition du livre (« Gutenberg avant Gutenberg »), aux logiques de l’innovation typographique (« Le temps des start-up »), et à l’analyse de cette révolution en tant que telle, c’est à dire à ses incidences sur la forme, l’économie, l’autorité et la géographie de l’imprimé (« La première révolution des médias »).
Le développement de l’écrit, rappelle Frédéric Barbier en le confrontant à l’évolution des indices démographiques et économiques, se trouve à partir de la fin du XIIIe siècle au cœur des changements les plus importants que connaissent les sociétés européennes: organisation des pratiques de gestion, mise au point de la comptabilité en partie double, développement de la mémoire bourgeoise et urbaine, etc. Il devient l’outil et le moteur d’une rationalité portée par certaines classes d’hommes (notaires, hommes de lois, enseignants, négociants, administrateurs), qui développent de nouveaux modes de suprématie. L’atelier de copie, la bibliothèque, la boutique du libraire, contribuent bien sûr de manière décisive à la structuration de cet « environnement artificiel » qui précède et porte la révolution gutenbergienne. L’analyse du phénomène est souvent confrontée aussi bien à celle de sa représentation (Holbein, Carpaccio), qu’à des examens de masse. Les travaux quantitatifs conduits par Uwe Neddermeyer sur la production manuscrite médiévale du monde germanique servent ainsi à mesurer sur le plan statistique la conjoncture générale de l’écrit. A ce même titre on soulignera l’ingéniosité des tris et calculs appliqués plus loin aux quelque 26 000 enregistrements de la base ISTC ancienne.
Une attention toute particulière est apportée aux implications de chaque changement (en premier lieu le passage du scriptorium monastique au développement de la reproduction des textes dans le monde urbain) en termes de logique commerciale. L’aspect fondamental de ce faisceau de mutations étant la naissance et l’organisation d’un marché (de la production, de la diffusion, de la consommation des objets textuels), marqué par l’intervention de dynasties d’affaires, et intégrant des systèmes de régulation comme celui de la pecia. Le recours à un certain nombre de notions économiques qui ont accompagné le développement des NTIC (recherche-développement, start-up, capital-risque, etc.), n’a rien d’une allégeance terminologique anachronique : les concepts s’avèrent particulièrement pertinents, tout spécialement sans doute pour un large public, pour comprendre la mise en place du « système Gutenberg » et ses conséquences. Celui-ci reposant indissolublement sur la mise au point d’« innovations de procédé » (la presse, la normalisation des caractères, leur fabrication en série), sur la prédominance croissante du modèle marchand et sur des initiatives portées par des groupes très minoritaires (inventeurs et techniciens, financiers supportant des recherches longues et aléatoires). Analysant la singulière conjonction des trois histoires techniques qui donne naissance à l’imprimé (le travail du métal, la décomposition du texte par caractères mobiles, l’utilisation de la presse), Frédéric Barbier montre bien que cette évolution n’est pas forcément linéaire, qu’elle a connu transferts de technologie, hésitations techniques, apories parfois. L’auteur reprend ainsi, en faisant le point, la plupart des grands problèmes historiographiques de l’histoire du livre. Cela va de la question ancienne des rapports entre l’Extrême-Orient et l’Europe et du rôle de Prokop Waldvogel à Avignon vers 1444, à l’hypothèse, plus récemment formulée par Wolfgang v. Stromer, d’un transfert de technologie déterminant entre Prague et Mayence : la technique de gravure des lettres à ergots mise au point par les orfèvres en Bohême pour le décor des bâtiments, les pièces de fonderie ou la reliure, ayant pu directement inspirer les graveurs de poinçons travaillant pour Gutenberg.
De même, après un état de l’ensemble des sources qui documentent l’activité de Gutenberg à Mayence et à Strasbourg, et une restitution de la chronologie des premiers imprimés, sont présentés quelques « dossiers » dont les enjeux ne sont pas anodins pour la compréhension du livre imprimé au XVe siècle. À cet égard, à côté des hypothèses relatives au Catholicon de Mayence (1460, ou bien entre 1460 et 1472), peut-être composé avec des paires de lignes fondues en bloc plutôt qu’avec des caractères mobiles, auraient également pu trouver quelque écho les questions soulevées par Paul Needham en 2001 à propos de la Bible à 42 lignes. On sait en effet que, sur la base d’une analyse numérique des signes typographiques de la Bible à 42 lignes et des bulles pontificales imprimées dans l’atelier de Gutenberg, l’incunabuliste a constaté des variantes telles entre deux mêmes lettres qu’il estime devoir penser que Gutenberg a utilisé une autre technologie que celle de la matrice métallique pour produire des caractères. Il n’y aurait pas deux lettres qui puissent être, à l’analyse, jugées produites par des caractères moulés dans la même matrice. Si l’hypothèse d’un recours à des moules à usage unique, composés à base de sable, doit être retenue, une nouvelle question s’impose : qui, si ce n’est Gutenberg, a le premier utilisé des caractères mobiles issus de matrices métalliques uniques ?
Quelques haltes dans l’exposé chronologique sont l’occasion de rappels sur les pratiques de composition, sur le partage des responsabilités dans le processus typographique et sur les relations investisseurs/producteurs, rappels documentés par analyse d’impositions, citations contemporaines, commentaire de contrats. Après les innovations de « procédé », l’examen porte sur les innovations de « produit », au nombre desquelles figurent l’invention de la politique éditoriale, et le développement de dispositifs « publicitaires » comme les catalogues, nés peut-être avec Mentelin à Strasbourg en 1469, et Schoeffer à Mayence à partir de 1469-1470. La mécanisation du procédé et le développement conjoint de la dimension marchande du produit représentent pour Frédéric Barbier l’originalité de cette mutation déterminante et matricielle de l’Europe. Il convoque à ce propos, dans leur sens étymologique le plus exact, les concepts solidaires de software (textes et informations en tant que marchandises) et de hardware (matériel de production).
La dernière partie est consacrée à l’expansion de l’imprimé, et aux aspects de la première révolution des médias induite par elle. Le classement des villes sur la base d’une corrélation entre date d’apparition de l’imprimerie, chiffre de population et distance du berceau de l’invention, fondé sur les données de l’ISTC, donne la mesure précise des rythmes de pénétration et de la chronologie de l’équipement typographique européen. Et l’explication des déterminismes à l’œuvre dans cette géographie, qui parfois « s’entrecroisent de matière paradoxale », n’évacue pas les cas singuliers : Naples ou Prague par exemple, qui figurent alors parmi les plus grandes villes européennes, n’apparaissent qu’à un rang médiocre pour leur production imprimée. On retiendra aussi le rappel du rôle des « passeurs », issus des trois milieux déterminants que constituent l’Église (Torquemada à Rome), l’Université (Guillaume Fichet à Paris) et les affaires (Barthélemy Buyer à Lyon, William Caxton en Angleterre), et une approche largement européenne qui intègre les espaces orientaux (le livre en Bohême, l’imprimerie glagolithique). La question de l’expansion et des spécialisations à l’œuvre dans le marché du livre est l’occasion d’une analyse du phénomène de la traduction, autour de l’exemple de la Nef des fous, dont l’histoire éditoriale combine deux modèles : celui de la traduction en latin d’une œuvre dont on cherche à élargir le lectorat potentiel ; et celui, à l’inverse, d’une traduction en vernaculaire d’une œuvre qu’on souhaite diffuser plus profondément au sein d’un espace linguistique donné. Enfin, au terme de cette dense réflexion chronologique, la notion de « krach des médias » (empruntée au « krach des images » de Paul Virilio) permet de rendre compte d’un processus inédit : la construction entièrement médiatique de certains « événements » (les 95 thèses de Luther en 1517, les placards d’Amboise de 1534, l’Augustinus de 1640), construction emblématique d’une révolution désormais achevée, entraîne conjointement une impossibilité de contrôler la diffusion de l’information et une irrationalité des réactions que ce constat engendre (François Ier interdisant par exemple en 1535 l’impression de tout nouveau livre dans le royaume !).
Essai d’« actualité », rigoureusement articulé et proposant des clés pour l’intelligence de la révolution des médias en cours, l’ouvrage constitue surtout une relecture précise et nerveuse de la révolution gutenbergienne, appuyée sur de nombreuses sources reproduites ou commentées, ainsi que sur un matériel bibliographique et iconographique complémentaire spécialement rassemblé et publié. Un de ses grands mérites est aussi de faire le point sur un ensemble de problématiques historiographiques souvent pointues. De rares coquilles subsistent (les noms d’Uwe Neddermeyer ou de Paul Virilio accidentellement écorchés ; la publication du premier Index des livres condamnés par la Sorbonne datée de 1542 au lieu de 1544). Mais grâce à Du Bellay, du reste cité par Frédéric Barbier (p. 160), nous savons à qui les imputer : « si tu treuves quelques faultes en l’impression, tu ne t’en dois prendre à moy… ».