Pistes pour une histoire de l’édition juridique française sous l’Ancien Régime
Yves-Bernard BRISSAUD
Ancien maître de conférences d’histoire du droit à l’université de Poitiers
I- L’ÉDITION JURIDIQUE : UNE TERRA INCOGNITA DANS L’HISTOIRE DE L’ÉDITION FRANÇAISE
1) La révolution de l’imprimé l’émergence d’une logique éditoriale et ses incidences sur l’édition du livre juridique
La révolution technologique constituée par l’invention de la typographie, en ouvrant à l’infini les possibilités de multiplier les textes écrits, a donné naissance à de nouveaux métiers liés à cette action complexe qu’est l’édition d’un livre. Antérieurement, le client et commanditaire, dans une relation bilatérale, pouvait convenir, avec un copiste, d’un texte à reproduire et d’un prix. Dans la mesure où l’artisan avait correctement réalisé le calcul très simple consistant à additionner le prix de sa matière première et de sa main-d’œuvre, tout se passait bien pour lui.
L’imprimerie allait bouleverser ce processus de négociation de gré à gré en obligeant l’éditeur1 à prendre des initiatives et des risques personnels. Pour gagner un maximum d’argent, il doit produire un maximum d’exemplaires au moindre coût unitaire, ce qui nécessite au départ une mise de fonds importante. Mais la rentabilité de son investissement est soumise à un ensemble de facteurs subtils qui l’obligent à bien évaluer la demande, à la fois au plan intellectuel – quelle est l’étendue du besoin culturel? – et géographique: quelle pourra être sa zone de diffusion et de combien de points de vente aura-t-il besoin ? Même s’il a réfléchi à ces deux questions, la rentabilité de son entreprise pourra être mise à mal par la présence de produits concurrents, notamment ceux en provenance de presses étrangères. À ces facteurs généraux se combinent les facteurs particuliers liés à la discipline qu’il a choisi de cultiver. Il n’envisagera pas de la même façon l’édition d’un livre de piété à succès, dont le public est a priori illimité, et d’un livre ne pouvant intéresser qu’une catégorie professionnelle déterminée, limitée par nature, ce qui est le cas dans l’édition juridique.
Or ce dernier type d’édition va dès le début, sans doute plus encore que tout autre domaine, illustrer tous ces aléas. Au chapitre des avantages commerciaux : si la clientèle est limitée, ses besoins sont homogènes et le goût personnel intervient peu dans l’achat. Tout homme de loi doit impérativement constituer sa bibliothèque des mêmes livres de base. Ces livres ne se démodent que lentement, certains restant directement utiles plusieurs décennies, et parfois jusqu’à un ou deux siècles. Un stock de livres de droit est donc une valeur sûre à long terme, ce qui limite les risques. Au chapitre des inconvénients : les livres de base que sont les corpus, les coutumiers généraux, les recueils d’ordonnances ou d’arrêts sont nécessairement de grands formats, le plus souvent in-folio, qui demandent de très importantes mises de fonds débouchant sur des prix de vente élevés, les plus élevés de tous les secteurs éditoriaux. Ce prix, s’il n’est pas de nature à effrayer un riche parlementaire, est hors de portée d’un robin de moindre volée.
2) Un champ de recherche quasiment vierge malgré son importance
C’est donc tout un ensemble de paramètres qui va caractériser l’édition juridique dont nous entreprenons de survoler l’histoire depuis l’invention de l’imprimerie jusqu’à la Révolution française. Entreprise difficile, car si les ouvrages et les travaux érudits consacrés à l’histoire du livre en général sont innombrables et la quantité de bibliographies immense2, ceux consacrés au livre juridique sont quasi inexistants. S’il est naturel que la spécialisation restreigne le champ des ouvrages de référence, il paraît pour le moins étrange que tous les domaines de l’activité éditoriale aient pu faire l’objet dans le passé de publications et de bibliographies plus ou moins nombreuses, à l’exception du seul droit.
Comment ne pas s’étonner que l’immense production juridique antérieure à la Révolution n’ait suscité, en tout et pour tout, qu’une seule bibliographie, et encore à peine digne de ce nom, celle que donna en 1772 Armand-Gaston Camus, en annexe de son traité sur la profession d’avocat ?3 En effet ses éditions successives et en dernier lieu la cinquième, revue et augmentée en 1832 par André-Marie Dupin, restèrent fidèles à l’idée limitativement utilitaire de départ, révélée sans ambiguïté dans le titre même : donner aux futurs praticiens la liste des « livres de droit qu’il est le plus utile d’acquérir et de connaître » pour exercer au mieux leur métier. Si elle put être fort utile aux manieurs de procès du temps, cette bibliographie, qui n’en est pas une véritable, ne l’est guère aux bibliophiles modernes. Elle mentionne en effet les lieux d’édition et leurs principales dates, mais elle ignore généralement les éditeurs, transcrit les titres de façon approximative, fourmille d’erreurs et souffre par définition de trop nombreuses lacunes. Il faut pourtant s’en contenter aujourd’hui encore, l’ancienne jurisprudence n’ayant jamais trouvé ni son Brunet4, ni surtout son Grandin5. Si l’on excepte quelques très rares et bien incommodes bibliographies spéciales6, il a fallu attendre 1975 pour que l’honneur de bibliographe des historiens du droit fût partiellement lavé grâce à André Gouron et Odile Terrin, auteurs d’une fort utile bibliographie des coutumes de France7. Hélas, à notre connaissance, ils n’ont point fait encore d’émules et ce n’est que la seule section II du titre VII du « Camus et Dupin » qui a pu être ainsi retraitée avec bonheur.
Ce déficit a une première explication technique. Le nombre de bibliographies et d’études sur une classe déterminée de livres est directement proportionnel à l’intérêt que les bibliophiles ont pris à collectionner ce type de livres. Les livres de droit n’ont pas suscité dans le passé et ne suscitent guère dans le présent l’intérêt passionné de vrais bibliophiles comme ont pu le faire la littérature, la médecine, les sciences, la chasse, la gastronomie, etc.8 Ils n’ont donc pas été étudiés pour eux-mêmes. Quant à une possible explication psychologique, osons hasarder que les hommes de droit n’aiment pas d’amour les livres de droit. Leurs bibliothèques sont des lieux de travail et non de plaisir. Leur réalisme les éloigne de la tentation du fétichisme qu’implique toute idée de collection. Ils en apprécient le contenu, mais restent indifférents au support lui-même. Nous avons connu des médecins tremblant d’émotion devant un bel Ambroise Paré, des lettrés en transe devant un Ronsard, des cuisiniers se saignant pour acquérir un Don de Comus, nous peinons à imaginer un magistrat contemporain, à défaut de l’avoir rencontré, caresser amoureusement le vélin doré d’un vieux Tiraqueau !9 Cela n’empêche point l’histoire du droit d’être bien vivante comme en témoignent l’existence, depuis 1855, d’une toujours active Revue historique de droit français et étranger et une multitude de manuels et de traités assortis d’un solide et érudit appareil bibliographique, notamment celui, utile entre tous, de Jean-Baptiste Brissaud10. Mais tout se passe comme si l’étude des livres juridiques n’était qu’un chapitre tout à fait accessoire de la bibliographie en général et non une spécialité propre aux juristes11. Aussi, hors de notre modeste expérience personnelle de bibliophile, devrons-nous compter avant tout sur les historiens du livre12, et non sur ceux du droit, pour recueillir ici et là les informations utiles à notre propos, dans l’attente de la thèse qu’il faudra bien qu’un jour l’un d’eux consacre à cette terra incognita qu’est l’édition juridique.
II- LE DIFFICILE DÉMARRAGE AU TEMPS DES INCUNABLES
Il ne faut guère compter, pour la période 1460-1500, berceau de l’imprimerie, sur de trop rares documents d’archives pour nous renseigner avec précision sur la fabrication et la diffusion des livres juridiques. On peut néanmoins se faire quelque idée du nombre d’éditions produites et de la localisation des principaux centres de production en inventoriant et en analysant le contenu des grands catalogues d’incunables qui recensent les centaines de milliers d’exemplaires parvenus jusqu’à nous et conservés dans les principales bibliothèques du monde13.
Mis au point en Allemagne au milieu du XVe siècle, l’art de la typographie en caractères mobiles va utiliser d’abord sa puissance reproductrice pour multiplier des textes religieux : Bible et Psautier. Les premiers grands textes juridiques publiés ne s’éloignent pas directement de ce domaine, puisqu’il s’agit de droit canonique : les Constitutions de Clément V en 1460, et les Décrétales de Boniface VIII en 1465. Les Institutes de Justinien suivent de près en 1468. Ces trois ouvrages d’importance, publiés avant même que le premier atelier d’imprimerie ne soit installé en France (1470), sortent du berceau de l’imprimerie : l’atelier de Johann Fust, ancien associé de Gutenberg, et de son gendre Peter Schœffer, à Mayence. Il s’agit de textes anciens qui, à l’époque précédente, avaient déjà fait l’objet d’une large diffusion sous forme manuscrite et étaient donc susceptibles d’une forte demande. Les éditions allaient s’en succéder et se multiplier, produites par diverses presses allemandes et italiennes. Les grandes caractéristiques de l’édition juridique, qui allaient se perpétuer pendant plus d’un siècle, sont ainsi bien marquées dès le départ. D’une part, le droit canon semble bénéficier de tirages et donc d’un potentiel de diffusion supérieur au droit romain. D’autre part, les textes de base anciens, c’est-à-dire antérieurs au XVe siècle, paraissent faire l’objet de tirages supérieurs à ceux des textes contemporains. L’édition italienne, avec en tête Venise, domine largement, suit l’édition germanique et, bien à la traîne, la France. Il faudra du temps pour que les textes de droit moderne prennent toute leur place et que les presses françaises soient capables de s’imposer face à leurs concurrentes.
À l’époque où les centres d’imprimerie se multiplient dans toute l’Europe, vers 1470, la production juridique se répartit en effet entre l’Italie, qui joue le rôle moteur avec, en tête, Venise et Rome, puis Bologne, Milan, Pavie, Naples et Pérouse, et l’aire germanique avec Mayence, Strasbourg et Bâle. Les pays germaniques sont les plus gros producteurs de droit canon, l’Italie de droit romain, ce qui ne veut pas dire que les contrées germaniques soient de moindres consommatrices de droit romain. En effet, l’Italie y exporte une partie de sa production, affirmant en ce domaine un rayonnement commercial international qui perdurera. Par contre, l’Italie se montre imperméable à la pénétration de la production extérieure. La France, pour l’heure, reste en retrait.
Au cours de la décennie suivante la production de l’Italie du Nord s’accroît aux dépens de celle de l’Italie du Sud et un phénomène de concentration donne à Venise, à la fin du siècle, avec 63% de la production, le quasi-monopole de l’édition des textes de base14. Mais comme ce type d’édition a tendance à stagner en raison de la saturation du marché15, les autres centres de moindre importance d’Italie du Nord, d’Allemagne et de France, vont choisir de se reconvertir en développant un secteur juridique jusque-là moins rentable, celui des textes récents ou nouveaux dont Venise, qui sélectionne sévèrement les seuls ouvrages susceptibles d’une large diffusion, ne produit que 40% des titres. Installés près des centres universitaires, ces éditeurs secondaires compenseront par la multiplication des textes, adressés à une clientèle de proximité, la faiblesse de leurs tirages. Ils ne cesseront plus, au cours du siècle suivant, de développer ce secteur, créant ainsi les conditions de la naissance d’une véritable édition nationale. Dans ce contexte nouveau, les éditeurs français joueront d’autant plus facilement leur rôle que beaucoup d’importants éditeurs allemands, qui tiraient à un grand nombre d’exemplaires, abandonnent le terrain juridique. Il faut en effet préciser que, sur le plan strictement commercial, si l’on en juge par la progression globale, le livre juridique est loin d’être le plus porteur des secteurs éditoriaux. Son taux de croissance est toujours inférieur au taux général. Comparé aux autres textes latins destinés aux lettrés, dont le taux va doubler, le sien n’augmentera que de 25%.
L’espace se dégageant, une autre ville, géographiquement bien située sur les grands axes commerciaux européens, Lyon, entreprend, à la fin du siècle, de concurrencer l’Italie, notamment grâce à l’initiative de marchands qui, ayant compris qu’il s’agissait là d’un domaine porteur, mènent une politique commerciale agressive. Le cas de Barthélemy Buyer, qui tenait à la fois de l’état de clergie et de celui de marchand et devint aussi éditeur, est éloquent à cet égard16. Fils d’un docteur ès lois, il alla étudier à Paris, fut reçu bachelier en droit, revint à Lyon prendre la direction d’une des plus importantes maisons de commerce du temps et eut, le premier, l’ingénieuse idée d’ajouter un comptoir de librairie à son commerce principal. Il installa une presse dans sa propre habitation vers 1472 et fut bientôt à la tête d’une véritable maison d’édition rayonnant dans tout le Midi de la France et le Sud-Ouest, avec, en même temps, une antenne à Paris. Son exemple fut suivi par plusieurs autres grands marchands qui, comme lui, pratiquèrent le commerce du livre et exportèrent au dehors, non seulement leurs propres publications, mais celles de leurs confrères. Son œuvre maîtresse fut son Commentaire de Bartolus de Saxoferrato sur le Corpus juris civilis, qu’il produisit à l’aide d’une équipe de « cinq jurisconsultes éminents (…) très éloquents et très célèbres » en 1481-1482, en 8 vol. in-folio. Malgré tout il abandonna ce type d’éditions pour se spécialiser dans des ouvrages plus « populaires », qui le mettaient mieux à même de lutter contre la concurrence des imprimeurs étrangers, surtout allemands, lesquels étaient de plus en plus nombreux à s’installer à Lyon même. Ce sont ces derniers, les Husz, Reinhard, Sybert, Wensler, qui allaient développer la publication des livres de droit : les deux Corpus, les Lecturae des grands jurisconsultes, les Practicae, etc.17
Le nombre des éditions juridiques lyonnaises finit bientôt par égaler celui produit par Venise, avec toutefois une différence de taille : les tirages sont beaucoup plus modestes, inférieurs de l’ordre de 75%. Le taux de réédition d’un même texte étant plus élevé en France qu’ailleurs, ce double phénomène s’explique par le fait que les éditeurs français, moins bien armés en matière de diffusion, cherchaient à limiter les risques en fractionnant les coûts. Au lieu d’imprimer un livre à mille exemplaires à écouler en cinq ans, ils préféraient l’imprimer à deux cents exemplaires à écouler annuellement, et le retirer dès que besoin, faisant porter le risque principal sur le seul coût de la composition et évitant que ne s’y ajoute celui du tirage et du papier en cas de surtirage dû à une mévente éventuelle. Ainsi conçue, la production française de livres juridiques, qui se développe d’ailleurs dans un mouvement général d’augmentation de la production destinée aux lettrés, multipliée par quatre en dix ans, connaît un accroissement considérable mais qui, rapporté à sa part de marché, reste modeste : seulement 15% à la fin du siècle.
III- PRÉDOMINANCE DU DROIT SAVANT DANS LA LITTÉRATURE JURIDIQUE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIe SIÈCLE
1) Les sources principales de la matière juridique
Le début du XVIe siècle va être décisif pour les progrès de l’édition française. La consommation générale de livres, y compris de livres juridiques, s’accroît alors considérablement, ce qui permet aux éditeurs de disposer d’un marché suffisamment vaste pour se lancer. Ils vont être en mesure d’imprimer sans trop de risques des textes qu’on ne pouvait trouver jusque-là que dans des éditions étrangères et inverser le taux d’autocouverture du marché national. Base de l’enseignement et de la réflexion doctrinale, droit romain et droit canonique vont constituer, pendant une bonne moitié du XVIe siècle, le gros de la production éditoriale juridique18. Leur importance intellectuelle, mais aussi quantitative, nécessite qu’on revienne rapidement sur leurs principales sources, dont on peut résumer comme suit les grandes étapes.
Les textes de droit romain, émanés pour l’essentiel de l’activité législative et compilatoire de l’empereur Justinien, étaient classés sous le nom de : 1) Code, recueil des constitutions impériales de ses prédécesseurs et de lui-même, divisé en douze livres ; 2) Digeste ou Pandectes19, réunion revue et corrigée des traités de tous les jurisconsultes antérieurs distribuée en cinquante livres et quatre cent vingt-deux titres ; 3) les Institut(e)s (ou Institutiones, Instituta, Elementa), abrégé des grands principes de droit destiné aux débutants ; 4), les Novelles, ou réunion des nouveaux édits impériaux parus postérieurement à la codification précédente. D’abord publiées en grec, elles furent traduites en latin après la mort de Justinien, donnant naissance à une version Vulgate qualifiée par la suite d’Authentique (c’est-à-dire de version originale) pour la distinguer d’un abrégé en latin réalisé vers 570 par un antécesseur de Constantinople, Julien, désigné sous le nom d’Epitome. À ces textes de base, d’autres textes subséquents allaient s’ajouter dont les Libri Feudorum ou lois féodales des Lombards. Classés aux XIe et XIIe siècles, par les jurisconsultes de l’école de Bologne, tous ces ouvrages furent réunis en un ensemble devenu désormais immuable dans son ordre de publication mais qui n’allait néanmoins cesser de grossir du fait des travaux de ses commentateurs.
En effet les textes avaient fait l’objet de multiples notes ou gloses qui s’étaient accumulées en marge ou entre les lignes des manuscrits. Elles avaient été fixées au XIIIe siècle dans une version définitive par Accurse, qualifiée de Grande Glose pour la différencier des gloses postérieures qui avaient continué à fleurir dans un processus sans fin aboutissant à faire gloser la glose de la glose. À cette école de glossateurs, surtout préoccupés de reconstituer la législation de Justinien, succédèrent aux XIVe et XVe siècles des commentateurs menés par Bartole (Bartolus de Saxoferrato), qui eurent le souci d’adapter le droit romain aux nécessités contemporaines. Abandonnant la glose, ils multiplièrent les traités avec une prolixité non moindre, alignant d’interminables colonnes d’arguments contraires. Au XVIe siècle enfin, les humanistes, revenant aux sources de la langue, de la littérature et de la culture antiques, donnèrent naissance à une nouvelle école dite historique, menée par Jacques Cujas, elle-même féconde en nouvelles et impressionnantes publications. Celle de Denis Godefroy (Gothofredus), parue à Lyon en 1583 en quatre volumes in-4° chez Barthélemy Honorat, devait faire date sous le titre général de Corpus juris civilis, lequel titre devait désormais être définitivement retenu pour désigner l’ensemble du droit civil romain, textes originaux et compléments divers. Ce droit romain, considéré comme droit commun, s’appliquait directement dans les territoires du Saint-Empire romain germanique, l’Italie et la partie méridionale de la France, immense zone de diffusion qui suffit à elle seule à expliquer la supériorité en ce domaine des presses étrangères…
Quant au droit canonique, il avait aussi le statut de droit universel en s’appliquant à tous les fidèles de l’Église romaine. Il concernait non seulement les matières spirituelles à proprement parler, mais toute matière touchant de près ou de loin à la morale, dont le droit de la famille, qui reposait sur le mariage défini comme sacrement. Le droit canonique, largement influencé par le droit romain dont il avait adopté, voire perfectionné, nombre de solutions techniques, notamment celles issues du droit des obligations, avait pour sources les Saintes Écritures, les canons des conciles et les décrétales pontificales. Mis en ordre au XIIe siècle à la suite de la réforme grégorienne, une vaste compilation en fut présentée sous forme raisonnée dans le Concordia discordantium canonum ou Décret de Gratien, qui devint dès lors le manuel de base de l’enseignement du droit canonique d’abord à Bologne, puis dans toutes autres universités20 (Cf. pl. 4). Cela lui valut abondance de gloses et quantité d’éditions. L’activité législative de l’Église se poursuivant, les décrétales postérieures firent l’objet de nouvelles compilations que le pape Grégoire IX rendit caduques en 1234 en donnant une collection unique, divisée en cinq livres, de tous les textes qui n’étaient pas au Décret. En 1298 Boniface VIII la revit et la compléta, lui donnant le nom de Sexte. Clément V, en 1313, réunit en un recueil ses propres décrétales qui prirent le nom de Clémentines. Ultérieurement les décrétales qui ne figuraient pas dans ces différents recueils, ou Extravagantes, furent fixées en 1500 par l’éditeur français Jean Chappuis. Cette suite de cinq grands textes fut, comme le Corpus juris civilis, réunie en un ensemble désormais immuable, qualifié de Corpus juris canonici et présenté de la même façon, avec gloses marginales accompagnant le texte principal, généralement publié en trois volumes in-folio. Ses éditeurs, ses techniques de publication et sa diffusion ne différèrent guère de celles du droit civil21.
Le Corpus juris civilis se présente au XVIe siècle et continuera à se présenter au siècle suivant à peu près inévitablement en cinq ou six volumes in-folio, les trois premiers pour le Digeste divisé en trois parties : le Digestum vetus, l’Infortiatum22 et le Digestum novum, le quatrième pour le Codex, les cinquième et sixième pour les Institutes, les Novelles, les Authentiques, le Livre des fiefs et certaines Constitutions d’empereurs allemands, le tout agrémenté de gloses, relativement stables dans leur présentation, mais aussi de notes et de commentaires qui ne cesseront de grossir les éditions successives (plus, éventuellement, un volume de tables générales). Comme les hommes de loi sont, à l’égard du droit romain, d’une inépuisable curiosité doublée d’une grande prolixité, les presses vont en profiter à plein et multiplier à plaisir les éditions.
La plupart de celles-ci, comportant plusieurs milliers de pages à multiples colonnes d’inégale importance, alternant gros et petits caractères, lettres italiques et romaines23, encres rouges et noires, voire initiales coloriées, constituent d’étonnants chefs-d’œuvre de l’art typographique qui n’ont pas d’équivalent dans d’autres domaines, si l’on excepte bien entendu les livres d’heures dans lesquels l’aspect esthétique était volontairement cultivé. Ce sont d’ailleurs les rares ouvrages juridiques capables d’émouvoir les anciens collectionneurs et bibliophiles, notamment la superbe édition avec le commentaire d’Accurse donnée à Paris en 1576 par Sébastien Nivelle, classée par Brunet au rang des chefs-d’œuvre de la typographie française24.
Certains éditeurs s’étaient même cantonnés dans les grands formats juridiques à la quasi-exclusion de toute autre production, pourtant plus facile. Ce fut le cas de l’imprimeur lyonnais d’origine poitevine François Fradin, qui se spécialisa à tel point dans l’impression de volumineux corpus et autres livres de jurisprudence que le qualificatif de « fradins » fut attribué à tous les ouvrages de droit de format in-folio et conservé à Lyon pendant plusieurs siècles (Cf. pl. 1). Sa production, d’une remarquable qualité formelle et qui fut répandue sur tous les marchés de l’Europe, est en effet stupéfiante. Entre 1509 et 1521, puis 1527 et 1537, il ne se passe pas d’année sans qu’il imprime un Corpus juris canonici en trois volumes in-folio ou un Corpus juris civilis en six volumes in-folio, voire les deux à la fois25.
2) Les pratiques éditoriales
Des initiatives comme celles de Fradin ne pouvaient néanmoins se multiplier sans difficulté ni péril en raison des investissements considérables à engager. Comme d’autre part l’inépuisable fécondité qui caractérisait la jurisprudence entraînait la nécessité de publier des ouvrages de plus en plus gros et à la tomaison de plus en plus abondante, les libraires durent par la force des choses mettre leurs ressources en commun, à la fois pour augmenter leurs capacités et diminuer leurs risques. Tout au long du XVIe siècle, les associations les plus variées et les plus fluctuantes allaient se multiplier. Généralement deux ou trois libraires s’associaient pour publier et commercialiser ensemble tel ou tel ouvrage, pour une durée limitée qui n’excédait pas quelques années. Mais quand l’entreprise était particulièrement importante, le groupement devait être à la mesure du but à atteindre et pouvait comprendre de nombreux associés, concerner un ensemble considérable d’ouvrages et s’étendre sur des années, voire des décennies. C’est ce qui allait se produire à Lyon avec de grands regroupements aboutissant à la Compagnie des libraires de Lyon, laquelle, pendant tout le siècle, se donnera pour mission principale d’éditer des livres de jurisprudence – et ceci justifie que nous nous étendions un peu sur son histoire26.
La première grande association, qui regroupe Jacques Saccon, Aymon de La Porte, Simon Vincent, Jean et Jacques Huguetan et Martin Boillon, publie entre 1509 et 1519 au moins quinze éditions représentant une quarantaine de volumes, la plupart in-folio. À deux exceptions près, toutes traitent de droit, essentiellement des Corpus juris civilis et des Corpus juris canonici enrichis de commentaires principalement italiens, ce qui semble au départ destiner avant tout cette production à la clientèle du Midi et de la péninsule. Par la suite, tout en conservant une solide base italienne, la palette d’auteurs et de commentateurs s’étendra, marquant une volonté d’élargissement de la diffusion.
En 1520, une seconde compagnie remplace la précédente et comprend Aymon de La Porte, Luxembourg de Gabiano, Antoine Vincent, Jacques Giunta, Vincent de Portonariis. Elle se subdivise en deux sociétés, l’une dite des Lectures, spécialisée dans la publication des commentaires, l’autre dite des Textes. De 1519 à 1542, ces deux compagnies jumelles produisent au moins trente éditions représentant cent huit volumes ; comme précédemment, romanistes et canonistes sont à la source de la majorité de ces éditions. En 1541, la Compagnie des lectures est dissoute et reconstituée aussitôt avec des statuts renouvelés pour donner naissance à la troisième Compagnie des libraires, dite Grande Compagnie. Elle se réserve le monopole de l’impression et de la vente de certains ouvrages, généralement du droit et plus spécialement des commentaires. Ce faisant, chaque associé s’engage à ne pas mettre sous presse pour son compte personnel les mêmes textes que la Compagnie et à ne pas favoriser leur impression par des tiers. De tels engagements sont dictés par un évident réalisme, le succès commercial de ce genre d’entreprise passant aussi par l’élimination de la concurrence. C’est ainsi que la Compagnie cherche les moyens de lutter contre les frères Senneton qui éditent les mêmes textes, et qu’elle ne trouve finalement pas de meilleur moyen de résoudre ce problème qu’en les intégrant en son sein.
En revanche, l’un des plus importants libraires lyonnais, Guillaume Rouillé, lui-même très gros producteur d’ouvrages juridiques, réussit avec succès à faire front. Ayant succédé à Dominique de Portonariis, son beau-père, il essaye en vain de prendre la suite, au sein de la Compagnie, du frère de ce dernier, Vincent, qui en fut l’un des fondateurs. N’y parvenant pas, il entre en concurrence avec la Compagnie en employant la même méthode, celle de l’association. Il partage avec ses confrères un grand nombre de publications et se trouve lui-même au centre de nombreuses petites associations destinées à partager les risques commerciaux. Les guerres de Religion lui permettent même de triompher un temps par suite du départ, pour cause d’hérésie, d’une partie des membres de la Compagnie des libraires. Rouillé peut alors se lancer seul dans la publication de grands ouvrages de jurisprudence, achetant plusieurs privilèges accordés aux Senneton passés à Genève, dont ceux d’auteurs alors aussi fameux qu’André Tiraqueau et Jacques Rebuffi27. Ce triomphe est cependant sans lendemain durable car la lutte se termine finalement par la faillite des successeurs de Rouillé et l’absorption, au XVIIe siècle, de leur fonds par la puissante Compagnie des libraires.
Une quatrième Compagnie est formée en 1560. Entre 1560 et 1585, elle produit soixante-dix-sept volumes correspondant à vingt-deux éditions différentes, avec des orientations renouvelées. Elle publie par exemple un auteur novateur, André Alciat, qui s’efforce d’éclairer l’étude du droit par celle de l’histoire des langues et des institutions des Anciens, mais elle publie aussi des instruments de travail généraux comme le Trésor de la langue latine de Robert Estienne ou le Dictionnaire d’Ambroise Calepin. Elle sort encore de son domaine habituel pour éditer les Pères de l’Église, entreprise qui promettait d’être également considérable. Sans doute faut-il voir dans ce dernier fait le désir de concurrencer la librairie parisienne, plus spécialisée dans l’édition de textes de ce genre, mais qui se montrait de plus en plus offensive en matière d’édition juridique. Dès le début la Compagnie des libraires de Lyon avait adopté une méthode de travail qui perdurera et rendra bien difficile l’identification de toutes ses productions. Elle utilisait en fonction des besoins, soit les presses de ses propres membres, soit celles des typographes les plus divers, ce qui fait que plusieurs volumes d’un même ouvrage pouvaient être imprimés par des ateliers différents. Les bois, caractères et ornements divers passaient sans difficulté d’un atelier à un autre, chacun prêtant à son associé ce dont il pouvait avoir besoin pour réaliser l’œuvre commune. Comme l’adresse de la Compagnie ne figurait nulle part, on ne peut identifier sa production que par la présence de sa marque, laquelle peut être accompagnée non seulement de celle de l’imprimeur mais aussi de celle de l’associé qui a commercialisé l’exemplaire.
L’une de ces marques, la plus connue et la plus durable, est celle du lion dressé sur un semis d’abeilles adoptée en 1548 et utilisée, sous une forme ou sous une autre, jusqu’au XVIIIe siècle. C’est notamment celle qui orne le titre des nombreuses éditions successives du Corpus juris civilis, qui furent sans doute les plus répandues de toutes et qui pour cette raison sont dites au « Lion moucheté » (Cf. pl. 2). Si cette marque fait allusion au lieu géographique de l’édition, une autre marque en rapport avec la nature principale des éditions de la Compagnie des libraires est aussi utilisée, un encadrement chantourné au frontispice duquel règne une Justice trônant sur un nuage, épée à la main droite, balance à la main gauche. Le centre de l’encadrement, évidé, permet au typographe de placer, au choix, la figure du lion local ou les propres armes du membre concerné de la Compagnie. S’il est difficile de faire le point sur les diverses sociétés lyonnaises ayant constitué les compagnies de libraires successives, il convient de retenir que, pendant tout le XVIe siècle et au-delà, un groupe de libraires, parmi les meilleurs d’un des plus importants centres d’édition européens, développa suffisamment de puissance commerciale pour s’assurer le monopole de fait de l’édition des grands traités de droit romain et canon, dominant en ce domaine le marché du livre français mais aussi les marchés italien et espagnol tout en pénétrant en Allemagne. À son actif, outre une foule de Speculum, Lectura ou Consilia de multiples auteurs, des monuments in-folio aux multiples éditions comme les commentaires de Paul de Castro en huit volumes, ceux de Bartole en douze tomes ou le Tractatus ex variis juris interpretibus en pas moins de dix-sept volumes. L’exemple des Lyonnais fut imité par les Parisiens, notamment les libraires établis au Palais, que nous évoquerons plus loin, qui se regroupaient volontiers et continueront à le faire jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, soit de façon ponctuelle, soit de façon plus institutionnelle, la mention « chez les Associez » devenant une constante d’une certaine catégorie de publications législatives à caractère officiel. De même pour ceux du troisième ou deuxième centre de production français au XVIIe siècle, Rouen28.
Nous avons surtout évoqué jusqu’ici les ouvrages de grands et gros formats, notamment issus des deux Corpus, parce que les plus nombreux et les plus importants au XVIe siècle. Un sort particulier est toutefois réservé aux Institutes. Ouvrage élémentaire destiné à donner les bases du droit, il est fréquemment publié à part et accède rapidement à la qualité de vade-mecum avec de nombreuses éditions de poche au format in-16, voire in-32 (Cf. pl. 3). Sur le modèle des Institutes, certains professeurs conçoivent également, à l’usage des étudiants, des manuels réduits qui font le point sur tout ce qu’il est nécessaire de savoir pour disposer des connaissances juridiques élémentaires. C’est le cas du Strasbourgeois Sébastien Brant, enseignant à Bâle, plus connu pour ses qualités de poète satirique que pour ses ouvrages juridiques (il est l’auteur de la fameuse Nef des fous). On a de lui des Expositiones, imprimées à Lyon en 1526 par Jean Crespin où, dans un petit in-8° de cent trente-sept feuillets, il donne un résumé des divers livres du Corpus juris civilis et des Décrétales, concluant sa synthèse par un très pédagogique Modus studendi in utroque jure. Ce précis devait connaître de multiples éditions pendant tout le XVIe siècle.
La tendance à la diversification et à l’adoption de formats plus commodes et moins coûteux ne pouvait en effet que se développer pour satisfaire une nouvelle clientèle. Hugues de La Porte, l’un des fondateurs de la puissante Compagnie des libraires de Lyon, produisit ainsi, au format in-4°, des Corpus juris civilis et des Corpus juris canonici, ainsi que quelques autres volumineux ouvrages de droit jusque-là publiés au format grand in-folio, sans changer le nombre de volumes mais en diminuant le corps des caractères. Pour cela, il fonda une société particulière avec un de ses associés de la Compagnie des libraires, Antoine Vincent. L’entreprise connut un grand succès et eut sa marque particulière29. Mieux encore, Guillaume Rouillé publia en 1550-1551 un Corpus juris civilis en douze volumes in-16, réédité en treize puis quatorze volumes30. De telles pratiques se développèrent dans tous les centres d’impression. Par exemple à Paris où Robert Ier Estienne et Claude Chevallon, fait alors assez inhabituel, avaient publié en 1527 un Corpus juris civilis en huit volumes in-8°31. Quoi qu’il soit de leur rivalité commerciale, Lyon et Paris dominent au XVIe siècle l’impression française de livres juridiques. Hors de ces deux centres, la seule ville où l’activité éditoriale en matière de droit romain soit notable est Toulouse. Cependant, il ne s’agit pas de grands textes mais de commentaires et de cours des professeurs locaux.
3) La diffusion des diverses catégories de livres juridiques
Les grands catalogues et les bibliographies, en permettant de repérer la fréquence du nom des auteurs et des titres de leurs œuvres, le rythme et la longévité de leurs éditions, le nombre d’éditeurs qui les produisent, pourraient aider à se faire une idée plus précise de la diffusion des livres de droit en fonction de leur nature. Mais ce travail fastidieux reste à entreprendre. À défaut, il est un autre moyen de se faire une première idée de la diffusion des diverses catégories : ce sont les inventaires de succession. Parmi les inventaires disponibles du XVIe siècle, ceux notamment de Paris32, Amiens33 et Angers34 ont été soigneusement étudiés et tous permettent d’aboutir à des conclusions concordantes. Les sources anciennes romaines et canoniques viennent en tête, les écrits contemporains – ordonnances, coutumiers, pratiques judiciaires, recueils d’arrêts – nettement en seconde position, et à Paris plus qu’ailleurs. Ce sont ces dernières matières, relativement négligées au cours de la première moitié du XVIe siècle par de nombreux praticiens, qui tendront à prendre le relais au cours de la seconde moitié du siècle, pour dominer au XVIIe. Mais il faudra attendre que les hommes de loi aient acquis, par achat, reprise ou succession, un fonds suffisamment riche de corpus, souvent en plusieurs éditions différentes, ainsi que de commentaires savants, pour commencer à garnir plus volontiers leurs tablettes de nombreux livres de procédure et de droit français. Les inventaires nous enseignent aussi que les ouvrages juridiques sont de loin les plus coûteux de tous et, même lorsqu’ils ne constituent pas en nombre la section la plus importante de la bibliothèque, ils en forment toujours (hors les Heures) la part la plus onéreuse. Imprimeurs et libraires sont donc économiquement fondés à ne pas négliger ce domaine, même s’il est numériquement minoritaire, voire à s’en faire une spécialité. C’est d’ailleurs un secteur qui va notablement se diversifier en développant de nouveaux pôles d’intérêt, en même temps que se multiplient les juridictions et leur personnel.
IV. DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU MARCHÉ LOCAL À PARTIR DU MILIEU DU XVIe SIÈCLE : CELUI DES COUTUMIERS
1) La rédaction des coutumes et leurs commentaires
Si les droits romain et canonique ont la faveur des jurisconsultes les plus lettrés, il n’en reste pas moins que le droit coutumier constitue le droit commun qu’il faut appliquer, en priorité dans la France septentrionale, accessoirement dans la France méridionale. À l’heure où l’imprimerie devient le support obligé de toute connaissance, on ne peut se contenter, pour lutter contre l’arbitraire judiciaire, ni de l’oralité, empreinte d’incertitude, ni de recueils manuscrits privés, incomplets et sans autorité suffisante.
Cette raison de fond, appuyée par le fait que l’énorme production de droit savant pendant plus d’un siècle devait nécessairement aboutir à un certain tassement de la demande, allait entraîner des changements essentiels dans la physionomie et la géographie de l’édition juridique. La publication de coutumiers, puis dans la foulée, de traités de droit français, en ouvrant un nouveau et immense champ aux presses, allait d’abord permettre à Paris de s’imposer dans ce domaine comme dans le domaine religieux et de supplanter définitivement Lyon. Pour cette dernière place en effet, dès la fin du XVIe siècle, et en tout cas au début du XVIIe, la grande époque de la production savante latine est passée, les troubles dus à la partition religieuse ayant eu en ce domaine des effets négatifs décisifs. Dans le même temps la langue française, dûment réglée par les grammairiens et exploitée avec talent par une pléiade de littérateurs, accède au rang de langue de culture. S’affirme alors la fortune des presses parisiennes qui s’appuient sur une langue tendant à l’universalité et dont l’hégémonie ne cessera de progresser. Cette évolution, confortée par la présence à Paris du pouvoir politique et du pouvoir judiciaire suprême, fait désormais de la capitale le premier centre français de production du livre juridique. On peut en effet trouver des signes évidents que Paris a toujours lutté pour ne pas se laisser distancer, ne laissant pas Lyon jouir longtemps seul d’un bon titre. Témoin le Guidon des praticiens dont Étienne Dolet dirige la publication, d’abord à Lyon en 1538 par Scipion de Gabiano, réimprimé la même année à Paris chez les L’Angelier et qui, dès l’année suivante, fait l’objet de nombreuses autres éditions parisiennes, chez Jean Ruelle, Denis Janot, Jean Foucher ou Jean Petit.
Mais contrairement à ce qui s’était passé à Lyon en matière de droit savant, les presses parisiennes ne vont pas pouvoir devenir hégémoniques en matière de droit français, notamment à cause du droit coutumier. C’est par lui que les autres cités réussissent d’abord à avoir accès à l’édition juridique. Par exemple Rouen, qui est alors le troisième centre d’impression français et qui n’a pu avoir accès au marché de la grande édition juridique, a été amené à se spécialiser dans le droit local, publiant force coutumiers normands et anglo-normands35. Il en ira de même pour de nombreuses autres villes d’imprimerie secondaires.
Imposée par l’ordonnance de Montil-lès-Tours en 1454, la rédaction officielle des coutumes ne fut véritablement entreprise qu’à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, après qu’eut été décidée une procédure rationnelle. Elle allait battre son plein au cours de la première moitié du XVIe siècle. La réformation des coutumes va en prolonger l’effet tout au long du siècle et doter l’offre éditoriale nationale d’une source d’activité nouvelle et bientôt inépuisable. Non seulement ce mouvement fournit le marché parisien et national en coutumiers généraux mais, surtout, les coutumes se comptant par centaines, les presses régionales de chaque petite capitale coutumière y trouvent matière à s’employer, sans préjudice pour les presses étrangères d’attirer les plus en vue de leurs commentateurs. Dûment munis des textes coutumiers de référence, les hommes de loi locaux vont, à l’égard de leur coutume, jouer d’abord le rôle des glossateurs, puis celui d’Accurse : dans un premier temps commenter puis, dans un second temps, réunir les opinions des autres commentateurs, d’où autant d’éditions différentes de la même coutume qu’il peut y avoir de savants locaux en droit coutumier. Grâce à la Bibliographie des coutumes de France, on est en mesure de prendre conscience de l’intérêt que ce domaine particulier du droit a dû présenter pour les éditeurs locaux. Il n’est en effet guère de villes, et certaines fort modestes, qui n’aient eu leur quote-part des quelque 2161 éditions recensées36. Poussons-en le détail.
L’édition coutumière se répartit en deux grandes catégories d’inégale importance numérique : les coutumiers généraux et les coutumiers locaux. Les coutumiers généraux, qui compilent dans un même corps de texte le plus grand nombre possible de coutumes distinctes, compensent leur petit nombre, au total une trentaine d’éditions seulement, par leur masse individuelle. Quasi toujours parisiens et au format in-folio, ils ne cessent de grossir, depuis le premier, publié en 1517 en quatre cent trente feuillets, jusqu’à l’ultime et monumental Nouveau Coutumier général… donné par Charles-Antoine Bourdot de Richebourg en 1724 et qui compte cinq mille cent dix pages en quatre volumes in-folio (Cf. pl. 8, fig. 14 et 16). Considérablement augmenté par rapport aux précédents, il connut trois éditions la même année, mais une seule ultérieurement, en 1729. Il est vrai qu’il visait à remplacer le prestigieux Grand coutumier général donné par Charles Du Moulin en deux volumes in-folio qui, ayant eu treize éditions entre 1567 et 1681, se trouvait de ce fait déjà dans la plupart des bibliothèques de praticiens et pouvait leur suffire.
À ces coutumiers généraux, il convient d’ajouter cent trente éditions de commentaires et de traités généraux émanés d’une vingtaine d’auteurs différents qui s’efforcent peu ou prou de réaliser une synthèse, ou du moins de faire des comparaisons entre solutions de droit romain et pratiques coutumières. Nourris de droit romain, des auteurs comme Charles Du Moulin ou André Tiraqueau contribuent largement à réaliser un alliage entre droits savants et droit coutumier, ce qui rehausse ce dernier et forme l’assise du futur droit civil français. En 1687 Claude de Ferrière publie un ouvrage dont le titre même démontre sans équivoque ce qu’il en est à cet égard : Les Institutes du droit françois, contenant l’application du droit françois aux Institutes du droit romain, qui est la synthèse de trois autres ouvrages dont il est aussi l’auteur : La Jurisprudence du Digeste (1677), … du Code (1684), … des Novelles (1688), conférée avec les ordonnances royaux, les coutumes de France et les décisions des cours souveraines. Dans cette nouvelle optique, les hommes de loi vont donc pouvoir garnir sans complexe leur bibliothèque d’ouvrages de droit coutumier, non seulement pour répondre directement à leurs besoins pratiques, mais aussi pour se livrer à l’étude.
Les éditions de coutumiers particuliers, qui ne concernent qu’un seul ressort, ou qu’un petit groupe de coutumes voisines et apparentées, au nombre d’environ deux mille, constituent l’essentiel de l’activité éditoriale locale. Leur production commence plus ou moins tôt et se lance plus ou moins rapidement selon les localisations. C’est l’ensemble de l’Ouest (Normandie, Bretagne, pays de Loire et Poitou) qui manifeste d’abord la plus grande vitalité, la production de ces régions occupant presque les trois quarts de la production française jusqu’en 1510 et continuant à occuper jusqu’à la fin la première place au sein des autres grands groupes. Cela tient évidemment à l’ancienneté de leur rédaction mais aussi à l’ancienneté et au sérieux des presses installées dans cette zone. Les coutumes communes à l’Anjou et au Maine37 connaissent la plus belle série d’incunables coutumiers qui soit avec dix éditions entre 1476 et 1500 et une ultime en 1503. Le Poitou, qui bénéficie à la fois des presses prestigieuses des de Marnef ou des Bouchet et de commentateurs de renom avec André Tiraqueau, Pierre Rat et Nicolas Théveneau, connaîtra un véritable âge d’or au cours du XVIe siècle avec une bonne cinquantaine d’éditions de ses coutumes, soit un volume supérieur à n’importe quel autre ressort du royaume. Par la suite cette proportion s’effondrera et ne cessera de diminuer encore au cours du XVIIIe siècle. En revanche, ceci compensant cela, si les premiers coutumiers parisiens paraissent relativement tard (le premier date de 1511), à partir de la fin du XVIe siècle le développement de leur production est fulgurant et les place en tête de toutes les autres coutumes françaises, talonnés cependant par les coutumes normandes.
Aller au-delà de ces quelques constatations nous ferait sortir du cadre de notre propos, car le foisonnement que l’on observe dès le milieu du XVIe siècle rend bien difficile une perception claire de ce phénomène sans entrer dans le détail. En effet, le nombre des éditions et des tirages est bien différent d’un ressort coutumier à un autre ou d’un groupe coutumier à un autre, ainsi que d’une période à une autre. Toute analyse quantitative ne peut passer que par l’examen détaillé de la production précise de chaque secteur à un moment donné, ce qui a été tenté par l’un des coauteurs de la Bibliographie des coutumes de France38. Contentons-nous pour notre part de quelques constatations plus directement en rapport avec le phénomène éditorial.
2) Les facteurs de succès de l’édition des coutumes
Remarquons d’abord que le succès d’une coutume tient autant à l’importance de son ressort qu’à la personnalité de ses éditeurs ou de ses commentateurs. Une famille d’éditeurs comme les Millanges domine le marché des coutumiers pendant un siècle dans le ressort du parlement de Bordeaux. Sur les douze coutumiers de Bordeaux publiés entre 1574 et 1667, deux seulement portent une autre adresse. Il est évident que cet intérêt, et le suivi qu’il emporte, ne peut qu’être favorable à la qualité des éditions et à leur plus large diffusion.
Certains commentateurs, plus particulièrement estimés, pèsent également d’un poids très lourd dans le succès de telle coutume, succès qui à l’évidence eût été bien moindre sans eux. Non seulement un Bertrand d’Argentré est à l’origine de pas moins de vingt-cinq éditions différentes de la coutume de Bretagne, mais ses éditions commentées intéressent les presses de lieux aussi divers que Rouen, Rennes, Paris (Cf. pl. 7), Amsterdam, Bruxelles, Nantes et Angers. Quel contraste avec la même coutume, commentée par Pierre Hévin, qui ne connaît que neuf éditions, dont huit imprimées à Rennes et la neuvième à Nantes. Tiraqueau, pour la coutume de Poitou, provoque un engouement éditorial identique. Si cette coutume compte le nombre respectable de seize commentateurs différents à l’origine de soixante-trois éditions distinctes, Tiraqueau à lui seul est à l’origine de vingt-huit, publiées à Paris, Lyon, Bâle, Venise et Francfort, alors que son concurrent le plus sérieux, Théveneau, ne donne lieu qu’à neuf éditions, toutes de Poitiers et de Niort. Des remarques identiques pourraient être faites avec Barthélemy de Chasseneuz pour la Bourgogne, Nicolas Bohier pour le Berry ou François Dunod de Charnage pour la Franche-Comté.
Si les ressorts coutumiers importants et les commentateurs prestigieux obligent les éditeurs locaux à partager le gâteau avec leurs homologues parisiens et étrangers – inconvénient toutefois compensé par le grand nombre d’éditions que le marché peut absorber –, les premiers conservent toutes leurs chances dans les ressorts plus modestes ou avec des commentateurs moins estimés (Cf. pl. 5). Par exemple la petite coutume de Saintonge et sa plus modeste encore sous-coutume de Saint-Jean-d’Angély sont à l’origine, à elles deux, avec quatre commentateurs différents, de pas moins de dix-neuf éditions entre 1576 et 1722. Une seule est parisienne, huit sont publiées dans de grandes villes de provinces limitrophes, Niort et Bordeaux, les autres, soit les deux tiers, sont purement locales, imprimées soit à Saintes soit à Saint-Jean-d’Angély. Il faut croire que de telles éditions restent rentables, car on voit l’éditeur de Saintes, Jean Bichon, qui a publié en 1633 une Usance de Saintonge commentée par Cosme Béchet, récidiver cinq ans plus tard avec un autre commentaire de la même coutume, qui plus est en latin, par Jacques Vigne. Si cette dernière édition reste unique, celle de Béchet connaît une deuxième édition chez le même éditeur en 1647, une troisième en 1701 à Bordeaux chez Simon Boé et enfin une quatrième, en 1715, de nouveau à Saintes, chez Théodore Delpech…
Outre les commentateurs à succès, se révèlent aussi des auteurs à succès. Le plus étonnant d’entre eux est sans conteste Jean Boutillier, lieutenant du bailli de Tournai de 1384 à 1395, avec son inclassable Somme rural, qui offre une sorte de synthèse entre droit romain, droit canon, jurisprudence et coutumiers du nord de la France. Son œuvre connaît un tel succès auprès des praticiens qu’il ne s’en donne pas moins de dix-sept éditions entre 1479 et 1539, puis, telle la Belle au Bois Dormant, après une longue période de sommeil, elle est réveillée par un prince charmant du nom de Loys Charondas Le Caron, lequel est à l’origine de six nouvelles éditions commentées entre 1603 et 1621 (Cf. pl. 13, fig. 27). Soit vingt-trois éditions sur un siècle et demi, sans compter les six éditions en néerlandais entre 1483 et 1550. Bel exemple de longévité éditoriale pour un livre d’usage professionnel, mais exemple qui n’est pas unique car un Jean Masuer, avec sa Pratique selon la Coustume du Hault et Bas pays d’Auvergne, qui connaît vingt-six éditions entre 1510 et 1610 (Cf. pl. 13, fig. 28) ou, à l’époque suivante, un Antoine Loisel, dont les Institutions coutumières eurent quatorze éditions entre 1607 et 1783, obtiennent également sur la longueur de fort jolis succès de librairie (Cf. pl. 13, fig. 29).
Cette longévité, bien conforme à la nature du droit coutumier, ancré sur ses bases et qui n’évolue que lentement, donne à ce domaine une véritable originalité littéraire qui, toutes proportions gardées, prend le relais de celle de l’inusable droit romain. Car c’est bien un même texte, qui plonge dans les racines de notre histoire juridique nationale, même s’il se présente sous des formes rédactionnelles différentes, qui va faire l’objet d’une demande continue sur trois siècles. Le droit coutumier constitue donc pour les éditeurs une valeur sûre, même si ses éditions sont susceptibles de connaître des périodes de pause ou d’accélération inattendues. Ce domaine est tellement porteur qu’il reste possible de l’exploiter même en présence de la pire concurrence. On voit ainsi un libraire d’Angoulême prendre le risque de publier en 1586 une Coutume de Poitou malgré l’existence de toutes les autres éditions, en y joignant, pour la rendre attractive et faire d’une pierre deux coups, la Coutume de Paris. Astuce commerciale ou, déjà, conscience du caractère dominateur et unificateur de cette dernière ? Sans doute les deux à la fois. Toujours est-il que son exemple n’est pas oublié. En 1772, période de récession pour la coutume de Poitou, l’éditeur Jean-Félix Faulcon joint à la sienne, à l’instar de son prédécesseur, non seulement le texte de celle de Paris, mais aussi le commentaire de Gabriel Hullin sur les Usages des marches separantes les provinces de Poitou, Bretagne et Anjou.
Tout ceci démontre suffisamment qu’à défaut de pouvoir produire, faute de capacités financières et de diffusion, les grands textes juridiques d’intérêt national et international, les éditeurs locaux ont pu trouver le moyen, grâce à la coutume, de toucher directement le nombreux personnel des instances locales. De là l’idée a pu venir à beaucoup de poursuivre dans cette voie et de se faire les éditeurs des auteurs qui fréquentaient leurs boutiques.
V. L’ESSOR DU DROIT PRIVÉ NATIONAL AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES
Si les ouvrages de droit canon et ceux de droit romain continuent à sortir nombreux des presses au cours du XVIIe siècle, notamment grâce aux continuateurs de l’humanisme juridique issus de l’école de Cujas, le droit français va prendre son essor et supplanter le droit romain qui entre en décadence. Paris, siège du pouvoir royal et du premier parlement de France, centre d’un important mouvement d’unification du droit, va dépasser Lyon et jouer le rôle prépondérant. L’attraction de ce centre éditorial est si forte que son action se fait même sentir en matière d’édition coutumière. On y imprime non seulement les coutumiers voisins de Paris mais aussi, sous l’effet de la centralisation juridique parlementaire, ceux de provinces plus éloignées, et ce d’autant plus volontiers que leurs commentateurs sont plus estimés.
1) Les factums et autres feuilles volantes
L’activité judiciaire va désormais fournir un fort contingent de publications d’un type nouveau. Recueils d’arrêts, styles et autres traités de procédure vont se multiplier ainsi que des ouvrages plus modestes mais innombrables. C’est le cas des « factums » ou plaidoyers imprimés, généralement rédigés par les avocats ou procureurs, qui portent les titres divers de Mémoires, Consultations, Déclarations, etc., qu’il est devenu habituel de répandre pour convaincre les juges et se concilier la faveur du public. Ces pièces judiciaires, de quelques pages à quelques dizaines de pages, se comptent par centaines de milliers. Il en est de même pour les édits, ordonnances et arrêts qui, imprimés à part, circulent largement dans les milieux concernés par leur contenu précis (Cf. pl. 16 & 17). Certes ces publications, souvent dévalorisées par les bibliographes sous la qualification de « pièces », dont beaucoup ont été perdues et qu’on a généralement négligé de répertorier systématiquement, sont apparemment sans commune mesure avec les in-folio ou in-quarto de plusieurs centaines de pages. Mais leur grand nombre et le rythme soutenu de leur parution compensent leur modestie et contribuent non seulement à alimenter largement l’essor de la littérature juridique, mais parfois aussi à alimenter, au sens premier du terme, de nombreux imprimeurs que la concurrence des grands centres prive de moyens d’existence plus substantiels39.
2) Les grandes compilations d’ordonnances
La nécessité de connaître le droit allant de pair avec le développement de l’activité judiciaire poussera très vite les auteurs à entreprendre des compilations d’arrêts et d’ordonnances qui aboutiront au XVIIIe siècle à d’impressionnantes collections. Déjà le pape Grégoire XIII avait innové en se lançant, sans réussir à la mener à terme, dans l’immense entreprise d’un Tractatus universi juris publié à Venise de 1583 à 1586 en vingt-neuf volumes in-folio. Les débuts des collections françaises sont moins spectaculaires (Cf. pl. 9, fig. 18). Pierre de Rebuffi fait paraître un premier grand recueil des Ordonnances, loix, statutz et edictz royaux de tous les roys de France, depuis le regne de sainct Loys jusques au roy Henry, second… en 1574, suivi par Antoine Fontanon en 1585, Barnabé Brisson en 1587, lequel choisit d’attribuer à son œuvre le nom de Code du roy Henri III (Cf. pl. 9, fig. 19), et Pierre Guenois en 1593, qui lui donne la forme d’une Conference des ordonnances royaux, méthode qu’il renouvelle en 1596 au profit d’une Conference des coustumes (Cf. pl. 8, fig. 15). Tous ces recueils, de un à trois volumes in-folio, seront réédités de nombreuses fois, au besoin après avoir été revus et complétés, notamment par Loys Charondas Le Caron ou Gabriel-Michel de La Roche Maillet. Celui de Guenois connaît, entre 1596 et 1678, au moins dix éditions, toutes parisiennes, à l’exception d’une seule de Bourg-en-Bresse, 1627. À l’imitation du Code du roy Henri III, on a aussi un Code du roy Henri IV, donné à Lyon par Thomas Cormier en 1603, et un Code Louis XIII, donné par Jacques Corbin à Paris en 1628. Le mouvement ne s’arrêtera plus, couronné par la monumentale publication des Ordonnances des rois de France de la troisième race, entreprise en 1723 par Eusèbe de Laurière, qui usera de nombreux autres directeurs de publication et qui en sera à son quatorzième volume in-folio en 179040.
3) La naissance et le développement d’un nouveau genre : le « code »
Évoquer les compilations d’ordonnances royales qualifiées, à l’imitation de celles des constitutions des empereurs romains, de « codes », nous conduit à dresser le constat que ce mot connaît dès lors un rapide glissement de sens qui va présider à la naissance d’un nouveau genre juridique. De recueil de lois les plus diverses réunies sous un prince déterminé ou émanées de celui-ci, il tend à désigner de plus en plus volontiers un ensemble de lois concernant un domaine particulier, jusqu’à ce que les grandes codifications napoléoniennes ne fassent sa fortune définitive. Ce sens nouveau est attesté par Antoine Furetière qui, dans son Dictionnaire universel contenant generalement tous les mots françois tant vieux que modernes, après avoir défini les codes romains, puis évoqué les Code Henry, poursuit :
On a appellé le Code Michault, une ordonnance du roy Louis XIII (…). On appelle aussi par excellence, Code Louis, les ordonnances faites par Louis XIV sur la réformation de la justice civile & criminelle, de la marchandise, &c. Le Code civil, le Code criminel, ont été vérifiez en 1667, & c’est ce qu’on appelle encore la Nouvelle Ordonnance. Il y a encore le Code marchand qui regle la marchandise. Le Code ou les ordonnances de la Marine, le Code des Eaux & Forests, &c.
Ce sont en effet les grandes ordonnances de Louis XIV qui vont le plus contribuer à populariser ce mot. Si elles continuent à porter le titre traditionnel d’Ordonnance et si les pages de titre de leur publication ne font pas encore mention du mot code, il ne fait pas de doute qu’elles sont ainsi qualifiées par les praticiens et les libraires. En témoignent les pièces de titre appliquées au dos des reliures de leurs éditions qui fréquemment sont libellées Code civil, Code criminel ou Code pénal pour les ordonnances civiles et criminelles de 1667 et 1670 (Cf. pl. 18 & 19, fig. 44-51).
Hors des exemples précités le mot, dans son acception nouvelle, semble faire une première apparition, alors isolée, avec le Code des commensaux publié en 1646. Les grandes ordonnances de Louis XIV constituent son véritable point de départ comme nouveau concept sémantique et formel désormais généralement admis. Si l’on continue toujours à publier des Recueils d’édits ou d’ordonnances, cette qualification est dès lors sérieusement concurrencée par celle de Code, dont les plus divers sont publiés, de plus en plus nombreux au fur et à mesure que le siècle s’écoule. On voit ainsi apparaître successivement, toutes origines confondues, qu’il s’agisse de compilations particulières d’auteurs ou de publications officielles, des : Code des monnoyeurs (1720), Code noir (1742), Code de la librairie et imprimerie de Paris (1744), Code militaire (1749), Code de la voirie (1753), Code municipal (1760), Code des terriers (1761), Code des tailles (1761), Code voiturin (1763), Code pénal (1765), Code des chasses (1765), Code de la police (1767), Code matrimonial (1770), Code rural (1774), Nouveau Code des curés (1780), Code des prises (1784), etc. Tous sont des recueils de textes de lois, commentés ou non, destinés à répondre aux besoins particuliers des divers secteurs juridiques. Dans ce contexte, le Code des seigneurs haut-justiciers, paru en 1771, qui, au lieu d’aligner des textes, énonce sous forme de demandes et de réponses des définitions et des maximes tirées des textes, paraît insolite et reste marginal. Cette originalité tient vraisemblablement davantage au désir de l’auteur, Henriquez, d’utiliser à des fins commerciales un nouveau vocable accrocheur qu’à une quelconque incertitude sur sa signification exacte.
4) Les arrêtistes
Même inflation de compilations pour les arrêts notables des cours souveraines. Au XVIe siècle déjà, deux recueils d’arrêts du parlement de Paris avaient été donnés, en 1553 par Jean Lucius (alias Du Luc) et en 1596 par Anne Robert. Tous les deux en latin, ils connurent plusieurs éditions. À partir des premières années du XVIIe siècle, de nouveaux recueils ne vont cesser de se succéder à un rythme soutenu. Des dizaines d’auteurs, dont les plus notables sont Georges Louet (Cf. pl. 11), Claude Le Prestre, Jean Chenu, Jacques de Montholon, M.-François Desmaisons, Jean Bouguier, y vont de leur propre anthologie. Leurs ouvrages sont sans cesse réédités, revus et complétés par de nouveaux arrêtistes qui, à défaut de vouloir ou de pouvoir produire leur propre recueil, rajeunissent ceux des anciens. Modestes au départ, en un seul volume in-quarto ou in-folio, ils prennent de l’importance au cours du temps jusqu’à atteindre, comme le Journal des audiences du parlement de Paris de Jean Dufresne, les sept volumes in-folio lors de la réédition effectuée en 1751-1757 par ses continuateurs.
Les autres parlements, quoique moins productifs et importants sur le plan doctrinal, n’en donnent pas moins lieu, eux aussi, à des recueils identiques : celui de Toulouse avec le recueil de Bernard de La Roche-Flavin dont la première édition est de 1617 et la dernière de 1745 ; celui de Grenoble avec Guy Pape (Guido Papae ou Guidon de la Pape), dont l’édition in-8° gothique donnée à Lyon en 1528 est suivie d’une multitude d’autres éditions in-folio tant lyonnaises, grenobloises que genevoises, toutes en latin, jusqu’à celle, traduite et augmentée par Nicolas Chorier, donnée à Lyon en 1692 et encore rééditée à Grenoble en 1769 ; ceux de Bordeaux et de Provence avec chacun au moins huit compilateurs ; de Bretagne avec une première compilation dès 1581, soit moins de trente ans après l’établissement du siège, suivie d’une dizaine d’autres ; ceux de Dijon, de Rouen, de Metz, de Flandre, d’Alsace, qui sont tous à l’origine de multiples recueils aux multiples éditions. Avec parfois des tentatives de conférences entre parlements comme ces Décisions sommaires du palais, et arrêts de la cour de parlement de Bordeaux, illustrés de notes et d’arrêts de la cour de parlement de Grenoble, donnés en 1675 par Abraham La Peyrère, qui eurent un beau destin éditorial puisque leur dernière édition date de 1808.
Tous ces arrêts ne pouvaient faire que l’objet de synthèses, soit imposantes comme le Dictionnaire des arrests de Pierre-Jacques Brillon, publié en 1711 en trois volumes in-folio et qui grossira à six volumes de même format dans son édition de 1727, soit plus succinctes et plus maniables comme la très répandue Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence donnée par Jean-Baptiste Denisart en 1754-1756, d’abord en six volumes in-8°, puis en trois et enfin quatre volumes in-4°, qui connut au moins sept éditions successives sans compter les contrefaçons (Cf. pl. 21), avant que Camus n’entreprenne d’en donner une nouvelle rajeunie et très augmentée en 1783, qui en était à son neuvième volume en 1790. L’abrogation de l’ancienne législation n’empêcha pas le collaborateur de Camus, Jean-Baptiste-François Bayard, d’annoncer « que ces changemens pourraient ne point apporter d’obstacle à la suite de la collection ». Elle fut poursuivie jusqu’en 1807 et s’arrêta finalement au premier fascicule du tome XIV41.
Plus heureux fut le sort du Répertoire universel et raisonné de jurisprudence… de Joseph-Nicolas Guyot, dont l’édition de 1784-1785 en dix-sept volumes in-4° survécut à la Révolution. Le titre, racheté par Philippe-Antoine Merlin, bénéficia d’une troisième édition donnée en treize volumes in-4° à partir de 1807 et dans laquelle fut intercalé le droit nouveau. Dans sa préface, l’éditeur précise que deux motifs l’ont déterminé à reprendre cette collection : les changements de la législation mais aussi le fait que, l’ouvrage ne se trouvant plus dans le commerce, le prix des exemplaires s’élevait dans les ventes publiques à des cotes bien au-dessus de leur première valeur42. Ce signe certain d’une demande pressante avait dû peser son poids dans la décision de poursuivre la publication de Guyot. Une quatrième édition suivit, de 1812 à 1826, et enfin une cinquième avec les suppléments refondus en 1827-1828. Cette conjonction d’un intérêt commercial correctement apprécié et des talents d’un des meilleurs jurisconsultes du temps nous vaut un précieux témoignage du passage de l’ancienne législation à la nouvelle et rend cette série des plus précieuses pour tout historien du droit. Cette œuvre connut même, à partir de 1825, un important prolongement européen avec la Jurisprudence du XIXe siècle ou Recueil des arrêts et décisions de France et des Pays-Bas (…) rédigée par Sirey, pour la partie de France ; par J. Plaisant et Th. Van de Mons, pour la partie des Pays-Bas ; et enrichie de questions de droit inédites que présentent les Arrêts des cours belges par M. Merlin, Bruxelles, H. Tarlier, éditeur des œuvres de Merlin.
5) Causes célèbres et causes intéressantes ou curieuses
L’activité judiciaire, qui ne manquait pas d’avoir des côtés plaisants, convainquit également les éditeurs qu’il pouvait y avoir un filon ludique à exploiter, d’où l’édition, élargie à un public de simples curieux, des Causes célèbres et intéressantes par François Gayot de Pitaval et divers autres continuateurs, en vingt volumes in-12, l’éditeur parisien Robert (IV) Estienne affichant même sans complexe le côté avant tout distrayant du sujet en plaçant ce type de publication sous le titre de Causes amusantes. Ce dernier ouvrage allait jusqu’à prendre la forme du genre roman illustré, alors en vogue, en renforçant son côté attractif par la présence de vignettes hors texte, en-têtes et culs-de-lampe43. Un des avantages de ce genre de publication était de donner une pâture régulière aux presses, le premier volume de Gayot de Pitaval ayant paru en 1734 et le dernier en 1748, ses diverses éditions ultérieures continuées s’échelonnant également sur une dizaine d’années. Le procédé fut renouvelé par l’avocat François Richer avec un premier volume en 1773 et un vingt-deuxième en 1792. Le summum du genre fut atteint par Nicolas Lemoyne, dit Desessarts, ancien avocat devenu libraire et éditeur, qui donna des Causes célèbres, curieuses et intéressantes de toutes les cours souveraines du royaume… Commencées en 1773, elles se terminèrent sur un cent quatre-vingt-seizième volume en 1789 ! Qui aurait cru qu’une science aussi sévère que la jurisprudence allait faire basculer le droit dans le genre feuilleton ? À n’en pas douter le filon était bon car le même inépuisable Desessarts écrivit et publia en même temps, de 1778 à 1784, un Essai sur l’histoire générale des tribunaux des peuples tant anciens que modernes, ou Dictionnaire historique et judiciaire, contenant les anecdotes piquantes et les jugements fameux des tribunaux de tous les temps et de toutes les nations, en neuf volumes in-8°, doublé d’une série de Procès fameux, en dix volumes in-12 qui s’augmentèrent, après la Révolution, de dix autres volumes contenant les grands procès de cette période.
Remarquons toutefois que le genre, qui trouve son plein développement au XVIIIe siècle, avait de lointaines racines. Lorsque, en 1728, reparaissent les Arrests d’amours, les lecteurs curieux peuvent redécouvrir le principal précurseur du genre : Martial de Paris dit d’Auvergne. Celui-ci, procureur au parlement de Paris et notaire au Châtelet à la fin du XIVe siècle, s’était amusé à publier un recueil de cinquante et une espèces fictives galantes, sous le titre d’Arresta amorum. Il s’agissait, grâce à un procédé littéraire particulièrement séduisant, de mettre à la portée d’un large public non spécialisé les subtilités de la procédure et les grands principes du droit. Cet ouvrage, qui connut une première édition vers 1508, fut abondamment réédité tout au long du XVIe siècle, de nombreuses éditions étant agrémentées de jolis frontispices ou titres ornés évocateurs44. Le grave romaniste Bartole lui-même, dans son Processus Satanae contra Virginem coram judice Jesu, avait cédé à l’idée, sous couvert de faire connaître l’ordre et marche de la procédure, d’imaginer un procès entre la Vierge et le Diable dont Jésus est constitué juge. Nous laissons le lecteur deviner qui perdit le procès ! Il y eut là une veine littéraire juridique aujourd’hui bien oubliée, mais qui mériterait d’être explorée car, comme généralement tout récit reposant sur des situations fictives, elle permet à l’auteur de faire passer des idées moins conventionnelles que celles communément admises dans des écrits « sérieux », voire de sérieuses critiques contre le système judiciaire. Témoin la curieuse Gente Poitevinrie, recueil imprimé à Poitiers en 1572, comprenant neuf pièces écrites en dialecte poitevin, dont cinq sont des procès fictifs consacrés aux démêlés des paysans poitevins avec la justice. D’auteurs inconnus, mais à coup sûr émanés du cercle qui gravitait autour de l’avocat et poète Jean Boiceau de La Borderie, l’un des commentateurs de la coutume de Poitou et de son ami l’imprimeur Guillaume Bouchet, auteur des truculentes Sérées, ces procès tournent en dérision aussi bien le caractère procédurier des paysans que la vanité, le ridicule et la cupidité des avocats qui attisent les chicanes45. Rabelais, avec le juge Bridoye, maniaque de la procédure qui joue les jugements aux dés, avait déjà exploité le procédé, suivi par Racine avec le plaideur Chicaneau, et bien d’autres encore. Et s’il faut remonter plus loin la généalogie de ce procédé littéraire, on en trouvera des ancêtres prestigieux dans le procès aux multiples et extravagants rebondissements qui forme la trame du Roman de Renart et dans la non moins satirique Farce de maître Pathelin46.
6) Mémoires judiciaires et plaidoyers
Outre arrêts et règlements, cours et tribunaux produisaient force mémoires et force plaidoyers qui tendaient à devenir un genre littéraire aussi apprécié des lecteurs, et donc des éditeurs, que les sermons et oraisons funèbres. Pour le XVIe siècle, nous ne trouvons guère à citer que ceux d’un certain Dumesnil en 1544 en un modeste in-8°. Le mouvement de publication des plaidoyers débuta véritablement dans les années 1620. Ceux de Louis Servin, publiés à Paris et à Rouen, s’épaississent du format petit in-8° en 1612 à l’in-4° en 1629 pour atteindre l’in-folio en 1640. Suivront ceux de Jean Gauthier, qui fut surnommé Gaultier la Gueule, et que Boileau brocarda dans ces vers :
Dans vos discours chagrins, plus aigre et plus mordant / Qu’une femme en furie, ou Gaultier plaidant.
Puis ceux d’Olivier Patru, qui fut aussi à l’origine des discours prononcés par les récipiendaires de l’Académie française ; ceux d’Antoine Lemestre qui attirait un public prodigieux et au premier rang les plus fameux prédicateurs, lesquels demandaient la permission de ne point prêcher ces jours-là afin de pouvoir assister à ses plaidoyers ; ceux de Pierre Ayrault, d’Omer et de Denis Talon, du chancelier d’Aguesseau, de Mathieu Terrasson, et d’une bonne dizaine d’autres moins notables… Généralement individuels et tout entiers voués à la gloire d’un illustre verbe, les recueils sont parfois collectifs comme le Recueil des plaidoyers, harangues, memoires de plusieurs fameux avocats du parlement de Paris, paru en 1618. Ils finissent par atteindre une dimension plus que respectable tels ceux d’Henri Cochin, publiés à Paris en 1751 en six volumes in-4°, dont le succès appela non seulement plusieurs éditions successives mais aussi des extraits sous forme d’Œuvres choisies en deux volumes in-12 dans une édition de 1773 (Cf. pl. 12, fig. 26). Cette inflation de compilations de décisions judiciaires et de plaidoyers est soulignée par Jean-François Fournel dans son Histoire des avocats au parlement de Paris, parue en 1813, qui, abordant le XVIIe siècle, affirme :
Il paraît que le goût dominant de cette époque se tourna vers les compilations d’arrêts, et les recueils de plaidoyers. C’est dans ce siècle qu’on trouve cette foule d’arrêtistes qui encombrent les bibliothèques de jurisprudence.
Cette forte demande ne pouvait qu’aiguiser le zèle des éditeurs et partant susciter la jalousie des auteurs d’autres branches du savoir qui s’en trouvaient délaissés. Philippe-Jacques de Maussac, l’un des plus savants hellénistes de son temps, dans une note de son édition du Lexique grec des dix orateurs d’Harpocration, publié en 1614, se plaint que l’art de l’imprimerie semble alors exclusivement réservé aux futiles chimères (nugae et somnia) des collecteurs d’arrêts, tandis que les doctes élucubrations des savants sont dédaignées par des typographes avaricieux en ce siècle d’impéritie. De fait, en faisant le compte des arrestographes, Antoine-François Prost de Royer, dans une ultime édition du Dictionnaire des arrêts de Brillon donnée en 1781, en fournit une liste, qu’il avoue incomplète, de cent dix-huit noms, rangés sous chaque parlement, dont quarante-trois pour le seul parlement de Paris47.
De ces quelques exemples, qui pourraient être multipliés à loisir – nous pourrions aussi évoquer d’autres genres tout aussi féconds, tels que les Pratiques judiciaires ou Manuel de procédure – et qui ne veulent qu’illustrer l’évidente vitalité du domaine législatif et judiciaire, producteur de centaines de gros volumes, il ressort que l’édition juridique poursuit une florissante carrière. La multitude des hommes de robe qui gravitent autour des nombreuses juridictions semble se montrer de plus en plus avide de science juridique, d’où la prolifération de publications de valeur intellectuelle fort inégale, mais aussi de qualité formelle parfois médiocre, surtout s’agissant des multiples contrefaçons que nous évoquerons plus loin.
7) Doctrine
Cette vitalité est non moins évidente si l’on regarde du côté de la doctrine. Elle trouve ses racines au XVIe siècle avec les romanistes, auxquels succèdent les commentateurs de droit coutumier. La renommée et l’autorité de certains, Jacques Cujas, Charles Dumoulin, Guy Coquille ou Antoine Loisel, font multiplier d’abord les éditions de leurs travaux48. Ils inaugurent la série des grands noms de la doctrine : Jean Domat ou Guillaume de Lamoignon pour le XVIIe siècle, Henri-François d’Aguesseau, Robert-Joseph Pothier ou Charles de Secondat de Montesquieu au XVIIIe siècle, pour ne citer que ceux dont les œuvres devaient impérativement se trouver dans toute bibliothèque.
Les éditeurs cherchaient d’ailleurs par tous les moyens à tirer le meilleur parti de ce succès. Les célébrissimes et si répandues Lois civiles dans leur ordre naturel de Domat, véritable préface du Code civil, où pour la première fois un auteur instituait des généralités, parues d’abord en cinq volumes in-4° en 1689, furent éditées à partir de 1702 en un fort volume in-folio et connurent, jusqu’en 1777, une bonne dizaine d’éditions, sans compter les non moins nombreuses contrefaçons. Le succès de la formule amena d’autres auteurs à en imiter la forme et les éditeurs à produire ces nouveaux textes sous le même aspect. Avec les Loix ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel par Louis de Héricourt, parues en 1756, et les Lois criminelles de France dans leur ordre naturel de Pierre-François Muyart de Vouglans, parues en 1780, les acheteurs ne pouvaient être que tentés d’acquérir les trois volumes à la fois pour posséder la collection complète d’une publication qui avait toutes les apparences d’une série homogène (Cf. pl. 19, fig. 53-55). Hélas pour les amateurs d’aujourd’hui, les Lois criminelles parurent trop tard pour que leurs tirages puissent rattraper ceux de leurs devancières et leur relative rareté prive beaucoup de bibliothèques de la possibilité de posséder, complète, cette belle et indispensable trilogie.
L’édit d’avril 1679 ayant organisé dans les universités l’enseignement des principes de la jurisprudence française, c’est-à-dire du droit coutumier, alors en recherche d’unification, il faut joindre aux grands noms de la doctrine ceux des professeurs qui publient également de nombreux ouvrages en ce domaine. Parmi les plus notables : François de Boutaric à Toulouse, dont la volonté pédagogique est si évidente que la plupart de ses ouvrages sont intitulés Explication de… ; Claude Serres à Montpellier, qui donne de tout aussi pédagogiques Institutions du droit français… ; Augustin-Marie Poullain Du Parc, à Rennes, auteur de Principes du droit français, suivant les maximes de Bretagne, en douze volumes in-12, qu’il destine aux « commençans » ; François-Ignace Dunod de Charnage à Besançon, etc. Tous ces auteurs provinciaux produisent quantité d’ouvrages et donnent le plus souvent la préférence aux presses locales. Pour Paris, citons François de Launay, spécialiste du droit de la chasse, qui fut le premier à occuper la chaire de droit français érigée en l’université de Paris par l’arrêt du Conseil d’État du 26 novembre 1680 et qui, dans sa leçon inaugurale, soutint, sous les applaudissements, que « le droit romain n’était pas le droit commun de la France »49.
VI. MÉFIANCE DU POUVOIR ENVERS LA LITTÉRATURE À IMPLICATION POLITIQUE ET ENVERS LE DROIT PUBLIC DES NATIONS
1) L’essor de la science politique
Si l’édition juridique se concentre, du XVIe au XVIIIe siècle, sur les matières de droit privé, ce domaine n’est pas le seul, loin de là, à intéresser les juristes. Un autre secteur va s’ouvrir largement dès le XVIe siècle, qu’on peut qualifier, pour simplifier, de droit public, ou politique, et qui tourne autour de la question du pouvoir, de ses attributs et de ses modalités d’exercice. Annonçons déjà que ce secteur, propre à susciter bien des inquiétudes de la part d’un pouvoir en progression irrésistible vers l’absolutisme, sera nettement moins favorable aux presses françaises que le précédent. En tout cas, la matière est déjà assez développée pour que le savant bibliographe Gabriel Naudé, qui avait réuni en faveur de Mazarin une fabuleuse bibliothèque de quarante mille volumes, publie en 1633 une Bibliographia politica où il passait en revue, de Platon à Jean Bodin, tous les ouvrages de base qu’il convenait de connaître pour s’initier à la chose politique50.
À vrai dire cette préoccupation n’était guère nouvelle, le rôle et la place de l’État ou de son représentant ayant de longue date suscité une multitude d’écrits et même donné naissance à un genre littéraire fécond, celui des Miroirs des princes consacrés à l’instruction et à l’édification des puissants. Thomas d’Aquin devait au XIIIe siècle, avec son De regimine principum, en donner une sorte de synthèse combinant les idées développées par la pensée antique aristotélicienne et par la pensée théocratique médiévale. Mais tous ces textes, bien que révélant de profondes inquiétudes politiques de la part de l’élite intellectuelle du temps, se situaient bien au-delà des préoccupations d’un plus large public pour lequel la soumission aux enseignements de l’Église et aux ordres du roi était chose naturelle, et ils ne connaissaient donc qu’une diffusion limitée.
Ce sont les troubles politico-religieux du XVIe siècle qui vont véritablement faire exploser la matière, provoquant, autour de la théorie du pouvoir, de vastes et interminables débats et polémiques propres à passionner non seulement les juristes stricto sensu, mais aussi tous moralistes, historiens ou philosophes, et finalement à lancer la littérature politique dans une voie dangereuse qu’elle ne quittera plus, celle au mieux de la contestation, au pire de l’opposition. Remarquons d’ailleurs que, de même que le droit privé français resta longtemps inséparable du droit romain et du droit canonique, le droit public et les idées politiques demeurèrent en grande partie, avec le gallicanisme, la Réforme, le jansénisme, les Lumières, etc., inséparables des débats théologiques. Immense domaine, qui sera exploité par une multitude d’auteurs, domaine si varié et si complexe que nous ne pouvons qu’en souligner certains aspects en évoquant quelques textes plus connus et plus fréquemment édités, excluant volontairement des succès de librairie aujourd’hui peu évocateurs, telle la correspondance diplomatique du cardinal d’Ossat. Au chapitre des best-sellers citons d’abord les œuvres de Machiavel qui, malgré leur caractère sulfureux, connaissent au cours de la première moitié du XVIIe siècle de nombreuses éditions parisiennes, parues il est vrai sans privilège. Ce succès est attesté par l’une des plus célèbres estampes d’Abraham Bosse figurant l’une des boutiques du Palais de la Cité. On y voit des panonceaux proposant les livres à la mode. Seul de tous les auteurs ayant un rapport avec les sciences juridiques ou politiques y figure le nom de Machiavel, aux côtés de ceux de Godeau, Boccace, Cicéron, Rabelais, d’Urfé, etc.51
Si le Florentin Machiavel, à l’universelle renommée, compte à l’évidence de nombreux admirateurs en France, Jean Bodin, considéré traditionnellement comme « le plus illustre de nos écrivains de droit public »52, connaît lui aussi un succès qui dépasse ses propres frontières nationales. Ses Six livres de la République, parus en 1576 en un volume in-folio, connaissent dès leur parution de multiples éditions, tant parisiennes que lyonnaises, mais aussi suisses. Ils paraissent en format portatif in-8° dès 1577 à Lausanne et suscitent de nombreuses éditions genevoises. Leur diffusion internationale est facilitée par la traduction latine qu’en fait l’auteur lui-même, traduction publiée en 1586 en un volume in-folio et qui a connu elle-même nombre de rééditions. Au milieu du XVIIIe siècle, l’intérêt renouvelé pour la science politique fait remettre au goût du jour la République de Bodin, qui donne lieu à nouveau à plusieurs éditions. En 1755, Jean-Charles de Lavie, président au parlement de Bordeaux, en donne anonymement un Abrégé en deux volumes in-12 qui est refondu et reproduit en 1764 sous le nouveau titre Des corps politiques et de leur gouvernement et, en 1768, sous le titre encore renouvelé De la législation ou du gouvernement politique des empires, extrait de Bodin. En 1756 une autre édition arrangée par le maître des requêtes Charles-Armand L’Escalopier de Nourar est également mise sur le marché. Jean Bodin bénéficiait alors largement de la mode philosophique qui, après avoir affirmé la production de l’école du droit naturel, assurait un immense succès à l’Esprit des lois de Montesquieu. Ce succès de deux siècles s’inscrivait dans le droit fil du titre même de République, volontairement choisi par son auteur après l’avoir été par Platon et Cicéron dont les République successives avaient elles-mêmes été abondamment éditées et commentées à travers les siècles. Sans préjudice de l’intérêt de fond que ces ouvrages présentaient, le titre même, si évocateur pour un public tant soit peu lettré et donc si commercialement porteur, ne pouvait qu’inciter libraires et éditeurs à en exploiter le filon dès que la conjoncture intellectuelle s’y prêtait.
Si Bodin se détache largement du groupe des divers auteurs politiques des XVIe et XVIIe siècles, de nombreux autres théoriciens donnent alors des œuvres importantes dont l’esprit est largement influencé par leur opposition aux thèses des monarchomaques protestants, lesquels, ayant eu à souffrir de l’absolutisme monarchique, développaient des arguments propres à limiter l’autorité royale. Citons Guy Coquille, avec son Institution au droict des François (1595), Charles Loyseau avec son Traité de la seigneurie (1614), Cardin Le Bret avec son Traité de la souveraineté du roi (1632), ou, moins juridiques et plus directement affectés par les passions politiques qui se déchaînaient autour de la personnalité de Richelieu, Le Prince de Jean-Louis Guez de Balzac ou le Ministre d’Estat de Jean de Silhon parus à Paris en 1631. Ces divers ouvrages sur la théorie du pouvoir royal, pourtant fort estimés des juristes et assez souvent réédités, ne connaîtront cependant jamais un succès de librairie comparable à celui des Six livres de la République. Leur contenu restant nettement franco-français et fort orthodoxe, ce sont surtout les presses françaises qui les produisent. Néanmoins certains, tel celui de Silhon, ont fait l’objet de plusieurs éditions étrangères, annonçant la prédominance des presses étrangères, notamment celles d’Amsterdam, qui va bientôt se manifester en matière de littérature juridico-politique.
2) La fuite à l’étranger des écrits des penseurs
Au XVIIe siècle, l’imagination politique semble déserter les plumes de nos écrivains et donc les presses nationales. Car de nombreux exemples ont montré qu’il ne faisait pas bon hasarder des idées non conformistes au temps de l’absolutisme triomphant, fussent-elles mises au service de la cause monarchique elle-même, témoin les écrits économiques du maréchal de Vauban ou de Pierre de Boisguilbert. Paru sans nom d’auteur ni de lieu en 1707, imprimé sans permission ni privilège, le Projet d’une dîme royale, qui mettait à mal le système fiscal français, à la fois profondément injuste et peu rentable, est prohibé et condamné à l’entière destruction par arrêt du Conseil privé de Louis XIV. Cette décision ayant eu, bien évidemment, l’effet mécanique de piquer la curiosité publique et de susciter aussitôt sa réimpression, un second arrêt en confirme un mois plus tard l’interdiction (Cf. pl. 15, fig. 34). Dans le même temps, les mêmes causes ayant le même effet, le Factum de la France de Boisguilbert est également condamné. À en croire le duc de Saint-Simon, Vauban en mourut de chagrin. Quant à Boisguilbert, il fut exilé à Brive-la-Gaillarde. Il n’est pas jusqu’aux bien innocentes Aventures de Télémaque de Fénelon qui n’aient provoqué l’ire du grand roi, au prétexte de quelques portraits à clef, malgré l’évidente fidélité de son auteur. Il est vrai que le précepteur du duc de Bourgogne, qu’il éduquait en vue d’en faire un monarque réformateur, avait des idées, en matière de gouvernement, qui s’éloignaient largement de la ligne officielle, notamment de celle tracée par le chantre de la monarchie de droit divin, son rival Bossuet.
Aussi ne faut-il point s’étonner que la pensée politique se soit réfugiée naturellement là où elle pouvait s’exprimer librement, phénomène aussi grave au point de vue intellectuel qu’au point de vue économique, privant durablement les presses françaises des bénéfices premiers d’un secteur qui allait connaître une expansion continue jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Si le hasard seul fait donner en 1625 par le Hollandais Hugo Grotius, réfugié en France, la primeur de son De Jure belli ac pacis à un éditeur parisien, sa mise à l’Index en 1627 le fait désormais réimprimer à Francfort-sur-le-Main ou à Amsterdam. Plusieurs autres textes essentiels pour le développement des idées politiques sont également d’origine étrangère et sans exemple dans la production française : le De Cive (1642) et le Léviathan (1651) de l’Anglais Thomas Hobbes, le Tractatus theologico-politicus (1670) et le Tractatus politicus (1670) du Juif hollandais Baruch Spinoza, le De Jure naturae et gentium du Saxon Samuel von Pufendorf, l’Essai sur le gouvernement civil (1690) de l’Anglais John Locke, pour n’en citer que quelques-uns. Publiés en latin à Amsterdam, Londres ou Bâle, ces travaux ont un énorme retentissement dans toute l’Europe savante et sont bientôt traduits, commentés et adaptés à l’usage des lecteurs français.
D’origine méridionale, mais obligé en raison de sa qualité de calviniste de faire carrière en Allemagne et en Suisse, Jean Barbeyrac traduit le Traité du droit de la guerre et de la paix de Grotius (1724) comme le traité du Droit de la nature et des gens de Pufendorf (1734) ou le Traité philosophique des loix naturelles de Richard Cumberland (1744). Quant au Genevois Jean-Jacques Burlamaqui, auteur des Principes du droit politique (1751), de ceux du droit naturel et politique (1763) et de ceux du droit de la nature et des gens (1766), il se comporte moins en traducteur qu’en vulgarisateur, réduisant en principes faciles les développements théoriques de ses prédécesseurs de l’école de droit naturel. Toutes ces traductions et adaptations, comme leurs originaux, sont éditées et maintes fois rééditées sur les presses étrangères mais largement diffusées en France. Contrairement au droit positif qui, quel que soit son lieu d’édition, n’avait guère que des lecteurs nationaux, ces œuvres, fortement imprégnées des grands principes du droit naturel, prennent valeur universelle. On en revient, comme au temps du droit romain triomphant, à la réalité d’une édition européenne qui ne connaît plus de frontières. D’ailleurs, tous, auteurs et traducteurs, finissent par faire oublier leur nationalité à la faveur d’incessants déplacements à travers l’Europe, comme par l’occupation d’emplois officiels dans des États dont ils ne sont pas ressortissants.
Servant toutefois de terreau à une pensée politique française renouvelée, les écrits de l’école de droit naturel et des écoles voisines débouchent au XVIIIe siècle sur une véritable école philosophique nationale. Mais, signe des temps, les blessures nées des guerres de Religion qui ont jeté dans l’opposition de grands intellectuels protestants, ainsi que les irrépressibles frayeurs du pouvoir à l’égard de toute idée hétérodoxe, dissuadent désormais les auteurs de se tourner vers l’édition parisienne. Peut-être l’habitude s’en était-elle perdue pour les ouvrages de cette nature, ou bien les éditeurs étrangers, s’en étant fait une spécialité, sollicitaient-ils avec plus de conviction leurs auteurs que leurs concurrents français. Toujours est-il que le couronnement de la pensée politique française, constituée par l’œuvre de l’ancien parlementaire bordelais Charles de Secondat de Montesquieu, l’Esprit des lois, est publié anonymement en 1748 à Genève, réimprimé en 1749 à Amsterdam, à Édimbourg et à Londres en 1750. Certes, on trouve bien des tirages de la même année réalisés à Paris chez Pierre Prault, mais toujours placés sous l’enseigne du même éditeur genevois qui continue à réimprimer force éditions les années suivantes. L’originale du non moins fameux Contrat social ou Principes du droit politique de Jean-Jacques Rousseau paraît en 1762 à Amsterdam chez Marc Michel Rey. Plusieurs éditions en seront données par cet éditeur la même année.
On sait les difficultés qu’ont connues les éditeurs de l’Encyclopédie à poursuivre leur entreprise, surtout coupable de bousculer les idées reçues. Un arrêt du Conseil du 7 février 1752 condamne ainsi les deux premiers volumes pour
plusieurs maximes tendant à détruire l’autorité royale, à établir l’esprit d’indépendance et de révolte et, sous des termes obscurs et équivoques, à élever les fondements de l’erreur…53
Il n’est pas un seul ouvrage de science politique qui n’ait été susceptible d’encourir pareille condamnation de la part de toute autorité respectueuse de l’ordre établi. Aussi la simple prudence ne pouvait que pousser les auteurs à rechercher plus volontiers les éditeurs étrangers que leurs homologues français, quitte à user parfois de différents subterfuges pour que leurs ouvrages, néanmoins imprimés en France, paraissent venus d’ailleurs, ou bien encore pour que le manuscrit, prétendument volé, semble avoir été imprimé à leur insu en des termes infidèles54. Paradoxe, le pouvoir est alors lui-même conscient du caractère dommageable de ce phénomène et cherche parfois à l’atténuer. Le chancelier d’Aguesseau, sensible en l’occasion au manque à gagner des presses parisiennes, avait toléré qu’une édition fût donnée à Paris de l’Esprit des lois. Pour ce faire, il avait octroyé non pas un privilège, mais une « permission tacite », à condition que sa responsabilité fût dégagée et que le nom d’une ville étrangère figurât au titre…55
Là réside toute la différence, au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, entre l’édition de droit privé, d’abord française et éventuellement étrangère si le texte est suffisamment estimé pour recevoir une diffusion européenne, et l’édition de droit public, d’abord étrangère et qui, en cas de succès bien établi, peut devenir française en prenant le risque d’affronter ou de contourner Censure, Sorbonne ou Parlement. Ce qui fit dire à Voltaire que « les libraires hollandais gagnent un million par an parce que les Français ont eu de l’esprit ». Il aurait pu ajouter : « et parce que les gens de robe et de pouvoir en ont manqué ». Aussi ne doit-on point s’étonner que, comme les célèbres traités de Rousseau et de Montesquieu, le Droit public de l’Europe (1746), les Observations sur le gouvernement et les loix des États-Unis d’Amérique (1784) ainsi que le Principe des lois (1776) de l’abbé de Mably paraissent à La Haye, Genève ou Amsterdam, ou que L’Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, par Pierre-Paul-F.-J.-H. Le Mercier de La Rivière, soit publié sous l’adresse fictive de Londres en 1767, etc. Loin de nuire à leur diffusion, cette clandestinité augmentait encore l’attrait de tels ouvrages, malgré leur caractère parfois bien aride, dès qu’ils touchaient un sujet sensible. Pour ne citer qu’un seul exemple, la Théorie de l’impôt du marquis Victor de Mirabeau, parue anonymement en 1760, simultanément au format in-12 et in-4°, connut aussitôt un tel engouement que six éditions se succédèrent au cours de l’année 1761, soit localisées à Amsterdam, soit le plus souvent sans lieu, avec une page de titre parfois réduite à la plus simple expression d’un faux-titre (Cf. pl. 15, fig. 37).
VII. LE LIVRE JURIDIQUE DANS LA PRODUCTION FRANÇAISE
1) Un secteur étroit mais commercialement attractif
A priori la part, en nombre de publications, de la production juridique ne peut être que fort modeste par rapport à la totalité de la production éditoriale française. Si le nombre des auteurs de livres de droit reçus en France sous l’Ancien Régime peut raisonnablement être estimé autour de deux mille56, ce chiffre est dérisoire par rapport à la foule des auteurs anciens et modernes des autres disciplines : religion, belles-lettres, histoire, arts et sciences qui se comptent, eux, par dizaines de milliers. Mais, à l’examen, il semble bien que la proportion des livres publiés et de leurs tirages successifs, soit sensiblement supérieure à la proportion impliquée par le nombre d’auteurs, ce qui révèle un secteur plus attractif pour l’édition que la constatation de départ le laisserait penser57. On pourrait trouver, sinon la preuve, du moins une bonne indication de ce phénomène dans les propos de Collantine, personnage du Roman bourgeois de Furetière. Elle lance à Charoselles, qui court en vain après la gloire littéraire :
Vous m’avez fait cent fois la mesme plainte de vos libraires : pourquoy les voudriez-vous obliger à imprimer vos livres, si le débit n’en est pas heureux ? Que ne les faites-vous imprimer à vos frais… Ou plustost, que ne quittez-vous tout ce fatras de compositions philosophiques, historiques et romanesques pour compiler des arrests, des plaidoyers ou des maximes de droit ? Dame ! Ce sont des livres qu’on achète toujours quels qu’ils soient et il n’y a point de libraire qui n’en fust aussi friand que des Heures à la Chancelliere…58
Ce propos d’humour littéraire de celui qui fut aussi avocat et procureur fiscal, avant de devenir le savant lexicographe que chacun connaît, rejoint étrangement les plaintes de cet autre savant, Jacques de Maussac, cité plus haut. À cet état de choses, il y a plusieurs explications possibles. Non seulement un même titre juridique bénéficie souvent d’un grand nombre d’éditions et de retirages, mais il peut continuer à être produit pendant des décennies, voire un siècle ou deux. Il y a là matière à moins s’inquiéter du poids mort d’un stock à débit lent. D’autre part, les auteurs ne sont que pour partie à l’origine des ouvrages à produire. Il faut aussi compter textes législatifs et actes divers du pouvoir exécutif, véritable manne intarissable dont la production ne fera qu’enfler au cours du temps. Autre élément d’importance : alors que dans les autres domaines les formats sont, à partir du XVIIe siècle et en tout cas au XVIIIe, majoritairement in-8° ou in-12, en droit les formats in-folio ou pour le moins in-4° restent jusqu’à la Révolution couramment utilisés et achetés, quoique fort cher, par les plus fortunés des gens de robe, qui sont nombreux, sans empêcher que les mêmes textes puissent connaître, au bénéfice d’autres clients moins aisés, des éditions plus modestes59.
Toutefois, même s’il s’avère que le livre juridique constitue un domaine fort rentable pour une maison d’édition, reste à déterminer si ce type d’édition répond ou non à une véritable spécialisation. Cette question se pose surtout pour les principaux centres d’édition, Paris, Lyon et Rouen, car dans les centres secondaires chaque libraire a vocation naturelle à publier, s’il éprouve des affinités pour le sujet en raison de la spécificité de sa clientèle, le coutumier de sa province ou les écrits des juristes locaux. C’est même parfois le seul moyen pour lui de produire, hors les factums, alphabets, livrets de piété ou de colportage, de véritables livres propres à valoriser son travail. Si les presses du Languedoc, notamment les plus importantes situées à Toulouse, Montpellier ou Pézenas, ne peuvent imprimer que fort peu d’ouvrages littéraires qui viennent en abondance d’ailleurs, elles publient en revanche quantité d’ouvrages juridiques car leur province possède de nombreux juristes de qualité, résidant localement et ayant leurs lecteurs: les Astruc, Boutaric (Cf. pl. 14, fig. 30), Cambolas, Catelan, Furgole, Olive, Serres, etc.60 Autrement dit, dans les plus grandes villes, où les éditeurs peuvent se compter par dizaines, certains se spécialisent-ils en droit ou au contraire négligent-ils totalement ce domaine ?
Pour le déterminer avec quelque précision, il faudrait disposer préalablement de la liste de tout ce qui a été publié par chaque éditeur, et se donner les moyens d’exploiter statistiquement ces informations, ce qui semble aujourd’hui difficilement réalisable61. Le nombre des dépouillements et des inventaires déjà réalisé étant trop faible pour tirer des conclusions générales sûres, on doit se contenter de conjectures partielles, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elles ne soient pas vraisemblables. Tout semble indiquer qu’un éditeur, même menant une politique éditoriale apparemment fort éloignée du domaine juridique, ne néglige point, si l’occasion se présente, d’inscrire des livres juridiques à son catalogue, ce qui peut s’expliquer facilement par le fait que la sociologie des différents lecteurs ne crée pas de différences telles qu’un type de clientèle soit irréductible à un autre. Quand on produit des livres religieux ou des traductions d’auteurs antiques pour une clientèle déterminée, celle-ci reste ouverte et on a aussi des juristes parmi ses clients.
2) L’importance de la localisation et des relations directes auteurs-éditeurs
Un des critères de choix qui entre en ligne de compte est bien évidemment l’emplacement commercial. Les libraires de villes sièges d’une faculté de droit ou d’un parlement cherchent naturellement davantage à satisfaire la clientèle des gens de justice que ceux des villes qui en sont dépourvues. Une famille de libraires comme les Rouzeau-Montaut d’Orléans, au XVIIIe siècle, sait par exemple saisir la chance d’éditer les multiples et fort estimés travaux des magistrats orléanais R.-J. Pothier et Daniel Jousse (Cf. pl. 14, fig. 32). À Rouen, on voit les professionnels du livre s’installer en masse autour du parlement de Normandie et dans son enclos, les gens de justice et tous ceux qui gravitent autour se révélant particulièrement affamés de livres. Une vingtaine de libraires et d’imprimeurs sont établis autour du Palais en 1600, et cent cinquante s’y fixeront jusqu’en 167062. À Paris même, le lieu privilégié par excellence est le Palais, où siègent non seulement le Parlement, mais aussi la Cour des aides, la Cour des comptes, la Cour des monnaies, à proximité immédiate du Châtelet. Or au cœur même du Palais la grande salle est devenue au cours du Moyen Âge une véritable galerie marchande investie d’abord par les merciers et les marchands de modes. Les libraires s’y installent à leur tour pour proposer à un public mondain les nouveautés littéraires63 mais aussi, grâce à la spécificité de nombre de ses chalands, peu ou prou, des ouvrages de droit (Cf. pl. 10, fig. 20). Cette localisation présente en effet de nombreux avantages : le libraire y est en contact direct non seulement avec les praticiens et le public des justiciables qui consomment les textes juridiques, mais aussi avec ceux qui les produisent. Des liens auteurs-éditeurs s’y nouent naturellement. Le libraire a également à sa main les juridictions qui accordent les privilèges et peut accomplir plus aisément les formalités aboutissant à leur attribution. Enfin il y trouve un vivier de collaborateurs pour travailler à la mise au point des textes dont les originaux, s’ils émanent de l’autorité, sont immédiatement à portée et aussitôt consultables.
Ce sont de telles opportunités que saura saisir un Galliot Du Pré pour se spécialiser dans un domaine qui lui était jusque-là étranger. Ce libraire parisien, l’un des plus notables du XVIe siècle, qui va poursuivre de 1512 à 1561 une carrière d’une longévité remarquable, profite en effet de l’acquisition en 1512 d’une boutique dans la grande salle du Palais pour réorienter largement sa production vers le droit. Alors qu’à la suite de son père, l’imprimeur Jean Du Pré, il avait commencé sa carrière en publiant surtout livres liturgiques, romans de chevalerie et traductions d’auteurs antiques, il abandonne presque totalement la liturgie et consacre 42% de sa production à la jurisprudence, donnant des styles, des protocoles, des traités de Tiraqueau ou de Dumoulin, des textes comme la Pragmatique Sanction et les édits et ordonnances royaux, de nombreuses coutumes des environs de Paris, etc.64 Ce redéploiement de son activité lui vaut de nombreux succès éditoriaux, notamment celui constitué par l’édition de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539, dont six éditions en divers formats, de l’in-folio à l’in-8°, sont données avant la fin même de l’année. Exploitant au maximum le filon, il cède l’exploitation de son privilège à de nombreux libraires de province : Clermont-Ferrand, Rennes, Rouen, Toulouse, Lyon, au fur et à mesure de la publication de l’ordonnance dans leur ressort parlementaire. Vingt ans plus tard, ce texte, sans cesse réédité, se vend encore fort bien. L’état des stocks de Du Pré et donc de ses invendus, révélé par son inventaire de succession, démontre le bien-fondé de ses choix éditoriaux : on y apprend que la production de droit et d’histoire s’est fortement débitée alors que le répertoire littéraire lui a ménagé au contraire de sévères échecs.
Profil inverse que celui d’un autre libraire du Palais, Vincent Sertenas, actif de 1534 à 1562, qui se spécialise dans la production littéraire et ne consacre au droit qu’une part très réduite de son activité. Néanmoins si, par goût personnel, il préfère de loin éditer des littérateurs contemporains ou des traductions de classiques de l’Antiquité, il ne néglige pas de publier de temps à autre des ouvrages de droit, mais toujours d’auteurs français contemporains : Antoine Couillard, Jean Imbert, Pierre Lizet, etc. Il semble même avoir trouvé dans la publication d’ordonnances et autres actes royaux, dont il obtient à partir de 1554 un monopole d’édition, une source de revenu si importante qu’elle lui donne la possibilité de mener une politique éditoriale littéraire d’envergure, sa véritable vocation65. Deux siècles plus tard, un des plus notables éditeurs parisiens, Debure, sera dans une situation identique. À la tête d’un important fonds d’érudition à faible tirage, mais dont le sérieux garantit la rentabilité sur le long terme, il n’y fait place au droit que pour Jousse et Pothier qu’il s’est attachés et qu’il édite en collaboration avec les libraires orléanais Rouzeau-Montaut66. Mais ces deux auteurs de traités à succès sont pour lui une bénédiction car, parfaitement désintéressés, ils en laissent le profit à leur éditeur qui convient lui-même « que c’était surtout au don généreux que Jousse et Pothier lui avaient fait de leur production qu’il devait le succès de son établissement »67.
Devenus nombreux, les libraires et les éditeurs qui tiennent boutique au Palais vont, pour se signaler précisément, non seulement utiliser leur enseigne propre, mais se localiser par rapport à un élément architectural ou un emplacement déterminé : « au premier pilier de la Grand’Salle du Palais »68 ; « au troisième pilier de la Grand’Salle du Palais, à l’Esperance & à l’L couronnée »69 ; « au Palais, en la gallerie des Prisonniers »70 ; « Au pilier des Consultations », etc. Cette proximité de libraires concurrents, qui devait sans doute engendrer de nombreuses rivalités, aboutissait parfois à des accords confraternels qui, en divisant les charges d’édition et en multipliant les possibilités de diffusion, traduisaient une bonne intelligence commerciale. Ainsi une édition de l’estimé Recueil de jurisprudence de Guy Du Rousseaud de La Combe de 1746, d’abord publié par le seul imprimeur Pierre-Augustin Paulus-Du-Mesnil, paraît ultérieurement, dans une autre édition de 1746, en collaboration avec trois autres confrères, tous « libraires de la Grand-Salle » et qui figurent conjointement à l’adresse71.
3) Les imprimeurs officiels du Roi
Nous venons d’illustrer là un phénomène naturel d’attraction ratione loci. Le cas de Sertenas nous amène à évoquer aussi le phénomène de spécialisation ratione personæ. Nous avons déjà souligné, comme facteur non négligeable de développement de l’activité éditoriale juridique, l’existence de pièces imprimées donnant connaissance au public concerné de telle ordonnance, arrêt du Conseil ou autre acte administratif ou législatif (Cf. pl. 9, fig. 17 & 18). Il était important que l’impression de ces pièces fût sévèrement contrôlée pour assurer leur parfaite conformité avec l’original et leur statut de publication officielle. Aussi le pouvoir prit-il l’habitude d’en confier l’impression à des professionnels agréés qui portèrent le titre envié d’« imprimeurs du Roi », ce qui leur donnait d’importants avantages propres à en faire de fidèles serviteurs des idées monarchiques. Un tel monopole devint fort lucratif, dans la mesure où le pouvoir allait éprouver un plus grand besoin d’informer ses agents de ses décisions pour application et achetait d’avance une partie des exemplaires à distribuer, tandis que le public, avide d’informations concernant l’exacte conduite qu’il devait tenir, ne tardait pas à acheter le reste. Cette politique de monopole allait contribuer à constituer de puissants groupes de libraires, d’autant plus disposés à ne diffuser que de saines doctrines que celles-ci assuraient leur prospérité. Certains grands corps – cours des monnaies, Châtelet, cours souveraines, mais aussi évêques, clergé, chapitres, ordres religieux – ont de la même façon des imprimeurs privilégiés, qui pouvaient ainsi se tailler à leur tour un pré carré en raison de cette spécialisation (Cf. pl. 17).
L’institution des imprimeurs du Roi ne fait que se développer, notamment grâce à la série des grandes ordonnances produites sous Louis XIV, lesquelles reçoivent la plus large diffusion et continuent à être imperturbablement éditées un siècle plus tard. De tels ouvrages sont immédiatement identifiables comme éditions à caractère officiel, à la fois par une vignette aux armes royales qui orne la page de titre, et par le libellé de la suscription, placé sous cette vignette : « A Paris chez les Associez choisis par ordre de Sa Majesté pour l’impression de ses nouvelles ordonnances »72 (Cf. pl. 10, fig. 21) ; ou encore : « A Paris, chez les Associez choisis par ordre de Sa Majesté pour l’impression des stiles et formules, suivant les nouvelles ordonnances »73, etc. Ce monopole de la publication des ordonnances n’empêchait pas l’existence de certains monopoles particuliers liés à telle ou telle branche de l’administration. À Paris, par exemple, un Pierre Prault ou un Martin-Georges Jouvenel publient force textes fiscaux en leur qualité d’« imprimeurs des fermes du Roy »74. Les imprimeurs bénéficiaires de telles préférences y gagnaient une prospérité qui pouvait tourner à l’avantage d’autres travaux. Comme le libraire Sertenas précité, l’imprimeur du Roi Antoine II Maurry, qui en 1700 partage à Rouen avec Jacques III Besongne la publication des déclarations, ordonnances et arrêts royaux, met à profit cette manne juridique pour cultiver d’autres centres d’intérêt. Elle lui permet notamment d’entreprendre des réalisations de grande envergure, comme l’Histoire de Normandie de Louis Le Vavasseur de Masseville, en six volumes75.
4) Les contrefaçons
À ce monopole spécialisé dans un domaine particulier s’ajoutait un système général d’autorisation d’imprimer. L’importance de l’imprimerie pour la diffusion des idées et son influence sur l’opinion publique avaient été mises en pleine lumière dès le début du XVIe siècle, notamment avec les écrits de Luther puis de Calvin, et confirmées lors des guerres de Religion avec une multitude de publications antimonarchiques. L’article 78 de l’ordonnance de Moulins (février 1566) systématisa donc le système du privilège qui interdisait d’éditer tout ouvrage nouveau sans l’autorisation royale et sans indication de lieu76. En conséquence l’éditeur autorisé disposait d’un monopole du titre couvert par le privilège qu’il avait obtenu. Sans entrer dans le détail du régime juridique de l’édition, qui sort de notre propos77, contentons-nous d’évoquer quelques errements qui ne furent pas sans conséquences sur l’édition des livres juridiques.
Privés de la possibilité légale d’imprimer des livres dont le succès se prolongeait sur une longue période par suite de la continuation du privilège en faveur de leur éditeur d’origine ou de ses ayants droit, qui bénéficiaient ainsi d’un monopole de droit comme de fait quasi illimité, ses concurrents n’avaient d’autre ressource que d’en réaliser des contrefaçons occultes. Celles-ci étaient fréquemment le fait d’éditeurs provinciaux travaillant au préjudice de l’édition parisienne, un centre comme Avignon, situé hors du royaume, s’en étant même fait une spécialité. Rouen, qui tenait en importance, par le nombre des presses, la deuxième ou la troisième place après Paris et Lyon, fut aussi un centre très actif de contrefaçon, aidé en cela par ses relations constantes avec les Pays-Bas et l’Angleterre78. Bénéficiant de la proximité du centre du mouvement intellectuel et de décisions administratives favorables, les libraires parisiens obtenaient en priorité les manuscrits et se faisaient délivrer plus facilement et plus vite les privilèges, poussant de ce fait leurs homologues provinciaux à se livrer à la contrefaçon sur une vaste échelle, pour pouvoir subsister.
D’autre part, les auteurs qui refusaient de voir infléchir ou censurer leur pensée n’avaient d’autre ressource que de se faire éditer sans privilège à l’étranger ou de se faire imprimer clandestinement en France sous une adresse fictive. Et tous, loin de là, n’étaient pas de dangereux trublions. Un des cas exemplaires est constitué par les Mémoires du grand Sully. L’ancien ministre d’Henri IV, qui tenait à l’intégrité de son œuvre, y compris dans ses passages polémiques, fit transporter des presses dans son château et y fit imprimer en dix-sept mois, sous sa surveillance directe, les deux volumes in-folio de ses Mémoires des sages et royales œconomies d’Estat. L’ouvrage parut sans date sous l’adresse fictive de deux imprimeurs d’Amsterdam qui fleurait bon la mystification : Aléthinosgraphe de Cléatinelee et Graphexecon de Pistaviste. Sans privilège et donc non protégé, son ouvrage fut bien entendu contrefait. Mais l’essentiel n’était pas là, ce qui importait à l’auteur était sa diffusion. Or, loin de nuire à un ouvrage de ce type, sa clandestinité ou sa contrefaçon, bien au contraire, favorisaient sa vente car une fois qu’un livre existait physiquement et avait été introduit en France, il trouvait toujours, malgré les règlements et les dispositions pénales, généralement inefficaces, des libraires pour le vendre et des clients d’autant plus désireux de l’acquérir qu’il avait le goût du fruit défendu (Cf. pl. 22).
5) Les tirages
Quant à la question du tirage des éditions en général et de celui des ouvrages juridiques en particulier, qui suscite toujours bien des interrogations, elle est quelque peu embarrassante, du moins en apparence. Elle dépend bien entendu comme aujourd’hui à la fois des coûts de fabrication et du succès de l’ouvrage, mais dans un contexte technique bien différent. Aujourd’hui le coût de la main-d’œuvre spécialisée et l’utilisation de machines hautement perfectionnées est très élevé, ce qui oblige l’éditeur à réaliser du premier coup un tirage suffisant, voire excessif, quitte, ultérieurement, sans inconvénient majeur pour lui, à solder ou à envoyer au pilon les surplus. Dans le cadre artisanal ancien, la situation est quasiment inverse. Le papier est excessivement cher, la main-d’œuvre et la mise sous presse peu coûteuses. L’éditeur préfère donc, pour ne pas risquer de stériliser inutilement ses capitaux, tirer faiblement, quitte à remettre sous presse, au fur et à mesure des besoins.
La confrontation d’exemplaires différents des mêmes textes parus aux mêmes dates permet parfois de déceler de tels retirages. Nous disposons de deux exemplaires de la Conférence des coutumes de Pierre Guenois portant le même achevé d’imprimer du 20 août 1596, mais avec des différences notables qui dénotent un retirage et valent d’être détaillées comme exemple des difficultés que peuvent rencontrer les bibliographes pour établir des descriptions précises. Le premier exemplaire qui a toutes les apparences de l’édition princeps débute par six feuillets contenant : la page de titre (a 1), la dédicace au baron de La Châtre, gouverneur de Berry (a 2), la préface (a 3-5), l’annonce du renvoi du privilège à la fin de l’index (a 6). Le second exemplaire, dans sa reliure du temps, réduit ces six premiers feuillets à deux contenant le titre et la dédicace. Le dédicataire originel a changé. Il ne s’agit plus du baron de La Châtre, devenu sans doute entre temps persona non grata en raison de sa position dans les troubles religieux du temps, mais des procureurs généraux au parlement de Paris Antoine Séguier et Jacob La Guesle. La signature du feuillet n’est plus a 2 mais Ee 4, ce qui ne correspond ici à rien : cette dédicace ne peut venir que d’un autre ouvrage.
D’autre part l’édition originale possède, à la suite des six premiers feuillets, cinquante-trois feuillets d’une table des titres et rubriques comparés, désignés par leurs seules numérotations alignées sur neuf colonnes, dont l’utilisation n’est guère aisée. Le retirage la supprime et passe directement à la table suivante, des principales matières, amplement suffisante. La page de titre, qui est renouvelée, prend acte de cette suppression en ne mentionnant plus de table des titres79. Il paraît naturel que l’éditeur de cet énorme ouvrage de neuf cent soixante-trois feuillets n’ait pas du premier coup jugé bon d’investir dans un trop grand nombre d’exemplaires, attendant que le chiffre des ventes justifie une remise sous presse. Celle-ci survenant, il en a profité pour alléger l’ouvrage d’une table dont le rapport utilité-coût était douteux (Cf. pl. 8, fig. 15).
Il semble bien, de façon générale, que le tirage original des livres de fond ait oscillé entre cinq cents et mille exemplaires, le tirage global, fonction du succès, dépendant du nombre des retirages soit à l’identique soit, fréquemment, revus et corrigés, si ce n’est augmentés. On a, pour le XVIIe siècle, mais transposable au siècle précédent et au suivant, une excellente indication donnée par Gabriel Naudé dans son Jugement de tout ce qui a été imprimé contre le cardinal Mazarin :
Si un libraire fait imprimer quelque bon livre de philosophie, quelque démonstration de mathématique, quelque discours solide qui soit dans l’approbation de tous les doctes, il n’en fera tirer que cinq cens exemplaires, ou sept cens & demi tout au plus ; là où il est question d’un roman, de quelque méditation creuse, ou d’un livre de devinettes, de contes, de balivernes, il ne s’en fera pas moins d’un labeur entier, qui est de quinze cens ou de trois mille, & encore faut-il bien souvent les rimprimer… de là vient que [les libraires Toussaint] Du Bray, [Nicolas du] Fossé, & la veuve [de Charles] Chastelain, qui n’imprimoient que de cette première sorte de livres estoient devenus plus riches que ceux qui fesoient tout leur pouvoir pour n’imprimer rien que de bon80.
Ces chiffres correspondent à des habitudes imposées par les conditions propres au travail artisanal, qui ne semblent guère avoir évolué jusqu’au début du XIXe siècle, les ouvrages de fond continuant à ne connaître que des tirages de quelques centaines d’exemplaires à mille cinq cents au plus81. Ces chiffres sont quasi imposés par la notion de « labeur », qui est le rendement journalier d’une presse à bras, et par la nécessité de sortir les ouvrages dans un délai raisonnable82. On sait, par un mémoire de 1777, que le libraire parisien Debure, dont le fonds était constitué principalement d’ouvrages de pédagogie, de droit, de médecine et d’histoire, tirait en moyenne de mille à quinze cents exemplaires, les tirages de deux à trois mille restant exceptionnels et ne concernant que des valeurs aussi sûres que le fameux Dictionnaire de Trévoux. Le Traité de la justice criminelle de Jousse en quatre volumes in-4° et son Traité de l’administration de la justice en deux volumes in-4° furent tirés en 1771 à quinze cents exemplaires. Il en restait douze cents en 1777, soit une vente moyenne de cinquante par an, ce qui faisait dire à Debure :
Quoique ces deux ouvrages soient excellents et parce qu’ils sont considérables, ils sont lents au débit.
Mais la vente de tels ouvrages était régulière et se prolongeait sur vingt ou trente ans83.
À supposer même que l’on connaisse exactement le nombre des tirages successifs et la quantité d’exemplaires produits chaque fois, cela ne suffit pas encore pour évaluer le nombre total d’exemplaires diffusés d’un même titre, car la question se complique du fait des contrefaçons. Dès qu’un ouvrage parisien ou lyonnais, donc de large diffusion potentielle, connaît quelque succès, il est immédiatement mis sous presse clandestinement par divers éditeurs des centres secondaires. L’absence de risque éditorial joue alors évidemment sur le tirage, plus élevé que pour les originaux. Les éditions réalisées à Avignon au cours du XVIIIe siècle, qui sont le plus souvent des contrefaçons, sont tirées en moyenne à deux mille exemplaires. On voit par exemple le Dictionnaire de droit canonique de Pierre-Toussaint Durand de Maillane y être tiré à trois mille. On aboutit donc à deux modèles de tirage : les éditions originales, lancées par le titulaire du privilège, de qualité, vendues cher à une clientèle d’élite, et les contrefaçons, assez souvent bien moins soignées car imprimées aussitôt sur papier médiocre, composées rapidement et plus ou moins fautives, souvent antidatées et pourvues de fausses adresses, destinées à une large clientèle peu fortunée ou indifférente à la qualité formelle84. Ce phénomène corrige notablement la faiblesse des tirages et retirages initiaux, pouvant transformer un ouvrage de fonds renommé en un véritable best-seller qui ne le cède en rien, en nombre d’exemplaires, aux romans à succès, et ce d’autant moins qu’avec le temps l’intérêt pour le roman s’émoussera jusqu’à s’épuiser alors qu’au contraire l’ouvrage juridique, revu, complété et doté de nouveaux commentaires retrouvera une nouvelle vigueur.
Le très célèbre Dictionnaire de droit et de pratique de Claude-Joseph de Ferrière illustre parfaitement l’hypothèse du livre juridique à succès. Le père de l’auteur, Claude de Ferrière, professeur de droit à Paris puis à Reims, avait publié en 1679 une Introduction à la pratique contenant l’explication des principaux termes de pratique et de coutume en un petit manuel in-16, qui connut plusieurs éditions successives données soit par lui-même soit, après sa mort, par son fils, également professeur de droit à Paris, sous le titre de Nouvelle Introduction à la pratique… en deux volumes in-12 (Cf. pl. 20, fig. 56). Ce succès avait incité Claude-Joseph de Ferrière à en reprendre totalement la matière et à lui donner, en 1734, la forme d’un ouvrage plus important : le Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances, de coutumes et de pratique, en deux volumes in-4°. Ces deux titres, qui paraissaient concurremment, s’adressaient à un public différent : le premier, à « ceux qui ne font que commencer à s’appliquer à la jurisprudence et à la pratique », le second à « ceux qui ont déjà fait quelque progrès »85. Le succès du Dictionnaire de droit allait égaler et bientôt dépasser celui de l’ouvrage paternel. Il connut, jusqu’à la Révolution, un grand nombre d’éditions parisiennes et provinciales et, comme il se doit, nombre de contrefaçons. Toutes éditions confondues, il fut certainement tiré à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires (Cf. pl. 20, fig. 58 & 59). Un de ses éditeurs, le libraire de Toulouse Jean Dupleix, obtint en 1779 la permission d’en faire une édition de deux mille exemplaires à charge pour lui qu’elle fût « absolument conforme à celle de Paris ». Pour se démarquer de la concurrence, il en vante les mérites propres dans un avertissement :
Depuis cette époque [1734] il en a paru dans les provinces diverses éditions, dont la plupart sont mauvaises, très défectueuses, et toutes d’un caractère fort menu. La dernière édition de cet ouvrage, plus ample et plus correcte, a été faite à Paris en 1771, avec des augmentations considérables ; et c’est cette édition que nous avons exactement suivie dans celle-ci. Les augmentations qui s’y trouvent ajoutées vont à près de 300 articles…
Or nous avons entre les mains deux éditions différentes portant même adresse et même date : Toulouse, Dupleix, 1779, toutes deux avec le même avertissement, mais l’une sans le privilège. Cette dernière, à l’évidence une contrefaçon, qui comporte sept cent huit et sept cent quarante pages, est imprimée sur un papier médiocre, de façon compacte, dans un caractère et une typographie qui démentent son avertissement. L’autre, qui est l’authentique, de huit cent vingt-neuf et huit cent quatre-vingt-quatre pages, est imprimée de façon aérée, sur papier de qualité et avec un plus gros caractère. Elle est dûment précédée en tête du tome II, contrairement à la contrefaçon, de la « permission simple », donnée par le directeur de la Librairie François-C.-M.-B. Le Camus de Néville, de faire une édition tirée à deux mille exemplaires.
Même aventure pour la non moins célèbre Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle de Jean-Baptiste Denisart, dont la septième édition donnée à Paris chez la veuve de Nicolas Desaint en 1771, édition de référence, fut contrefaite. Son éditeur, pour en détourner les acheteurs, publie une feuille volante dont les termes peuvent être généralisés à toutes ces sortes de publications :
Il est de l’intérêt du public d’être averti qu’on a contrefait la collection de jurisprudence de Me Denisart & que cette contrefaction est incomplète & remplie de fautes essentielles (…). La hardiesse & la fraude du contrefacteur ont été jusqu’au point d’annoncer cette édition comme la huitième, revue & considérablement augmentée, & se vendant chez la veuve Desaint, Paris 1773, lorsqu’il est notoire qu’il n’y a pas d’autre édition actuelle que la septième, donnée au public en 1771, avec le privilège à la fin du quatrième volume, privilège omis prudemment dans la contrefaction. Observons encore qu’il s’y trouve plus de 400 pages de moins que dans la véritable édition de 1771, ce qui provient de la finesse du caractère imprimé très blanc, & par là très fatigant pour les yeux, des défauts si marqués doivent bien suffire pour faire rejetter cette contrefaction… (Cf. pl. 21)86.
On comprend l’irritation des éditeurs spoliés par ces éditions pirates nonobstant leurs privilèges. Au préjudice financier s’ajoutait également, à l’égard des auteurs, un préjudice moral et intellectuel tout aussi irritant, car la contrefaçon les privait de la possibilité de contrôler la qualité de textes qui avaient sans cesse besoin d’être revus, corrigés et augmentés. S’agissant par exemple d’auteurs aussi féconds et aussi demandés que les de Ferrière père et fils précités, le problème se trouvait multiplié par le nombre de leurs titres qui étaient conjointement disponibles sur le marché. Aussi Claude-Joseph de Ferrière allait-il obtenir du roi, en janvier 1721, un privilège général protégeant la douzaine d’ouvrages produits par son père et par lui-même, lui permettant de les
faire imprimer et réimprimer par tels libraires ou imprimeurs qu’il choisira (…) en tels volumes, forme, marge, caractère, conjointement ou séparément, et autant que bon lui semblera, et de les faire vendre et débiter par tout notre royaume, pendant le temps et espace de vingt-cinq années consécutives, [interdisant] à toutes sortes de personnes (…) d’en introduire d’impression étrangère dans aucun lieu (…) comme aussi à tous libraires, imprimeurs et autres d’imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire aucun desdits livres ci-dessus spécifiés, en tout ni en partie, ni d’en faire aucuns extraits, sous quelque prétexte que ce soit, d’augmentation, correction, changement de titre, même de traduction etrangère ou autrement, sans la permission expresse et par écrit dudit exposant (…) à la charge (…) que l’impression de ces livres sera faite dans notre royaume et non ailleurs, en beau papier et en beaux caractères, conformément aux règlemens de la librairie, et qu’avant de les exposer en vente, les manuscrits ou imprimés qui auront servi de copie desdits livres seront remis dans le même état où les approbations auront été données…
Au-delà du caractère répétitif et convenu de ces formules de protection, subsiste bien dans ce cas particulier une double réalité, que le privilège de Ferrière développe en première partie. Ses ouvrages de jurisprudence ont fait l’objet d’augmentations et de corrections continuelles et il importe « qu’aucun ne fût réimprimé sans quelques augmentations qui peuvent être nécessaires pour les amener à leur perfection ». Ses travaux sont le fruit de son « application continuelle à l’étude de la jurisprudence » et de ses « veilles » ; si d’autres les imprimaient, cela « lui causerait un préjudice considérable et le pourrait priver du fruit de ses travaux » (Cf. pl. 21)87. Seule une longue enquête dans les bibliothèques locales permettrait de savoir combien les différentes éditions parisiennes de référence ont pu connaître d’éditions provinciales autorisées, et combien les unes et les autres ont pu susciter d’éditions clandestines.
6) La clientèle des livres de droit
Examinons maintenant la nature du public propre à acquérir des livres juridiques. On sait que, dès le XVIe siècle, époque où pourtant ce type de littérature est loin de tendre encore à la vulgarisation, il dépasse largement la clientèle des gens de loi stricto sensu. Les inventaires de succession des bibliothèques particulières parisiennes permettent de constater qu’elles contiennent presque toutes un fonds de droit, ce qui n’a rien d’étonnant s’agissant de celles d’hommes de loi, mais paraît plus surprenant lorsqu’on a affaire à des gens qui a priori devraient être indifférents à cette spécialité, tels qu’un orfèvre, un meunier ou un apothicaire, sans compter de nombreux ecclésiastiques qui, à côté des nécessaires livres de droit canon, achètent aussi du droit civil88. Les ex-libris peuvent également constituer en ce domaine une source annexe de renseignements. Nous en avons fréquemment rencontré, et certains fort bavards, qui nous enseignent que le possesseur de l’ouvrage n’a que de lointains rapports avec la carrière juridique.
Cette généralisation de l’intérêt pour les sciences juridiques ne fera que s’accentuer du fait que toute famille bourgeoise qui se respecte met à profit la fortune acquise dans le négoce pour pousser les plus prometteurs de ses membres à s’élever socialement par l’achat d’offices. À partir du XVIIe siècle, il n’y a guère de famille notable qui ne soit de près ou de loin en rapport avec la basoche et n’ait pour ses besoins l’occasion d’acquérir des ouvrages de nature juridique. Cette élévation sociale va de pair avec l’élévation intellectuelle, et toute bonne famille se doit de posséder une bibliothèque garnie de toutes sortes d’ouvrages, religieux, littéraires ou historiques – ce qui est déjà habituel –, mais aussi juridiques grâce à l’adoption, pour ce secteur, des formats portatifs. En effet si les austères in-folio demeurent la base de tout cabinet de travail sérieux, les éditeurs comprennent vite que l’élargissement de leur clientèle, condition du développement de leur activité, passe par la diversification des formats. L’idée du format portatif vade-mecum, qui remonte au XVIe siècle et fait plus tard la fortune d’une dynastie hollandaise comme celle des Elzevier, ne s’impose vraiment dans notre domaine qu’au XVIIe siècle pour se généraliser au XVIIIe. S’il présente bien des avantages – moins coûteux à l’achat pour le client, il reste rentable pour le libraire, qui voit sa clientèle se multiplier, et il est plus maniable –, le livre portatif a aussi ses inconvénients, dont celui de disperser l’information. Il exige également, pour être utilisé commodément, de nombreux mètres linéaires de rayonnages, ce qui n’est pas le cas des in-folio qui se contentent habituellement des bas d’armoires ou des placards. Si les formats in-8° ou in-12 se conçoivent bien pour servir de support à des travaux isolés qui n’exigent que peu de volumes, le format in-4° reste l’idéal (et aujourd’hui encore : témoin les recueils périodiques de jurisprudence et autres Jurisclasseurs) pour consulter confortablement les travaux plus substantiels.
Si on peut s’étonner que la première édition du Répertoire universel et raisonné de jurisprudence de Guyot, dont nous avons évoqué plus haut l’intéressant destin, ait étalé entre 1775 et 1783 ses soixante-quatre volumes in-8°, les faisant suivre de dix-sept volumes de supplément jusqu’en 1786, au rythme de six à huit par an, on comprend parfaitement que la seconde édition de 1784 en soit revenue plus sagement à dix-sept volumes in-4°. C’est que désormais se combinent deux facteurs, l’un économique, l’autre psychologique. Un libraire, qui hésite à s’engager dans une opération coûteuse et aléatoire, lance une formule d’abonnement qui lui permet, grâce aux avances des acheteurs, de couvrir les frais d’impression au fur et à mesure de l’avancement de la série. L’acheteur, quant à lui, se procure, volume par volume, année par année, comme sans s’en apercevoir, une œuvre d’importance dont il aurait eu du mal à acquérir d’un seul coup la totalité et qui même ne serait jamais parue sans cette astuce commerciale promise à un bel avenir. La formule était d’ailleurs susceptible de nombreux aménagements attractifs. Charles-Joseph Panckoucke, dynamique entrepreneur de l’immense Encyclopédie méthodique, annonce, en éditant le répertoire précité de Guyot, qu’
il ne sera fait aucune avance d’argent par les souscripteurs, il suffira qu’ils payent chaque volume en le retirant.
Bien plus, il autorise chaque souscripteur à rapporter dans les trois mois son exemplaire pour être remboursé s’il en est mécontent, ce qui est sans doute excellent en termes publicitaires, mais ne l’engage pas à grand chose car on voit mal l’ancien acheteur du tome 59, qui se termine sur la section XXVI de l’article « Substitution », refuser par humeur le tome 60 qui débute par la section XXVII du même article. Enfin, argument supplémentaire pour inciter son client à tenir sur la longueur, il offre gratuitement les trois derniers volumes89. Outre l’aspect financier, l’aspect mondain n’est pas indifférent. Au siècle des Lumières, posséder une bibliothèque encyclopédique bien garnie de toutes sortes d’ouvrages affirme un statut social. Des boiseries tapissées de nombreuses rangées d’in-12 ou d’in-8° aux dos rutilants de fleurons dorés honorent les nobles hôtels de ceux qui tiennent à faire valoir leur qualité d’amateurs éclairés. De nombreuses séries juridiques y contribuent au même titre et peut-être plus encore que les œuvres complètes des gloires littéraires. En effet le caractère purement intellectuel des livres juridiques est patent, car rien dans leur conception ne sacrifie à la frivolité. La meilleure preuve en est que le livre de droit illustré est un genre qui n’a jamais réussi à se développer, singularité qui suffirait à elle seule à distinguer ce domaine de tous les autres.
VIII. UN GENRE MORT-NÉ : LE LIVRE DE DROIT ILLUSTRÉ
Développée notamment en Italie au cours des deux dernières décennies du XVe siècle, l’illustration du livre va rapidement se répandre. Au milieu du XVIe siècle, les livres illustrés se comptent déjà par milliers et aucun domaine des sciences, des lettres et des arts n’échappe à un phénomène qui va persister, voire progresser aux siècles suivants, sauf en ce qui concerne le droit. Si l’on peut compter au plus quelques dizaines de livres de droit historiés pour le XVIe siècle, on ne rencontre ensuite pratiquement plus de livre juridique illustré, singularité qui s’est perpétuée jusqu’à nos jours et qui n’a, à notre connaissance, donné lieu à aucune étude de la part des historiens du livre90. Nous allons, en conclusion de cette rapide excursion historique au pays de Thémis, porter notre attention sur ce phénomène et tenter d’en esquisser la philosophie.
L’« exception juridique » ne relève pourtant nullement de la fatalité. Dans la première moitié du XVIe siècle, période au cours de laquelle l’illustration prend véritablement son essor, il n’y a aucune raison pour que le domaine juridique échappe au talent des tailleurs d’images. Pour ceux-ci en effet, évoquer les différentes phases de la procédure ou les attitudes des juges et des plaideurs ne présentait pas de difficulté particulière, encore moins lorsqu’il s’agissait de décrire délits et crimes, peines et supplices, sujets particulièrement stimulants. Aussi allait-on naturellement user, comme pour toutes les autres catégories du savoir, d’un certain nombre de vignettes de convention, en les adaptant au contexte juridique, mais aussi tenter des essais plus importants, tant en matière de droit canonique que de droit romain ou de droit criminel, aboutissant à des programmes de plusieurs dizaines de vignettes, voire dépassant parfois largement la centaine. Les gravures isolées, notamment vignettes de titre et frontispices se perpétueront, au contraire des suites d’illustration.
1) Titres ornés, frontispices et vignettes isolées
Le manuscrit et la sculpture avaient popularisé l’image de l’auteur assis à son pupitre, en train de rédiger ou de mettre au net son œuvre. Une image semblable allait ouvrir, à l’époque des impressions gothiques, nombre de traités de droit (et aussi de théologie) : celle du maître en chaire, enseignant un auditoire. Ce pouvait être une grande capitale liminaire historiée, l’espace restreint qui lui est imparti obligeant le graveur à des prodiges d’habileté pour loger cinq ou six têtes d’écoliers sommairement esquissées, groupées autour d’une figure de maître coincée dans le jambage de la lettre, comme dans ce I orné pris dans la première colonne d’une édition des Décisions de Guy Pape (Cf. pl. 23, fig. 63)91. Ce peut être aussi, venant d’un éditeur plus raffiné, un véritable en-tête sur deux colonnes où un graveur talentueux a pu librement disposer sur des bancs tout un auditoire d’une douzaine d’étudiants à bonnet face au maître, assis sur un beau fauteuil sculpté d’une sphyngesse, levant l’index de la main droite pour appuyer le commentaire qu’il fait du livre ouvert qu’il tient de la main gauche (Cf. pl. 23, fig. 65). Le visage de ce professeur, en l’occurrence Tiraqueau, avec sa longue barbe pointue, son nez aquilin, ses traits émaciés, n’est plus ici une simple figure de convention, mais a toutes les apparences d’un portrait qui se veut ressemblant92. On passe là de l’ancienne figuration médiévale abstraite et purement symbolique du Maître, à la figuration réaliste de tel maître, qui trouvera son aboutissement avec l’usage du portrait-frontispice. Mais alors l’image liminaire se détachera du texte pour prendre une place entière et séparée, hors du texte, non plus pour agrémenter et introduire le début d’un livre ou d’un chapitre, mais afin de donner un sens à l’œuvre entière.
Invention vénitienne qui remontait au dernier quart du XVe siècle, le titre-frontispice93 avait permis de disposer, dans un cartouche gravé sur bois et plus ou moins ornementé, diverses indications permettant au lecteur de prendre connaissance au premier coup d’œil du contenu, de l’auteur ou du libraire. Le bon sens commercial allait faire comprendre aux éditeurs tout le parti qu’ils pouvaient tirer de cette possibilité d’ornementation, certains n’ayant d’autre ambition que décorative, d’autres, plus fins, y symbolisant la nature de l’ouvrage ou l’esprit qui y présidait. Ce fut pour les juristes, grands amateurs de gloses, l’occasion de placer leurs travaux sous les auspices des anciens docteurs qui faisaient autorité et dont ils rapportaient les opinions. Les frontispices allaient pouvoir devenir de véritables galeries de portraits, évidemment différents s’il s’agissait d’un canoniste, d’un romaniste ou d’un commentateur de coutume, nous permettant de situer la popularité des anciens auteurs. Certains, dont la gloire est aujourd’hui bien ternie, sont parfois fort difficiles à identifier, du fait de l’utilisation de leur seul prénom ou de leur nom abrégé, ou de leur seul gentilé, difficulté que renforcent encore de nombreuses homonymies. L’éditeur vénitien Batista de Torta utilise ainsi en 1523 et 1524, sur trois ouvrages juridiques successifs94, un encadrement dans lequel figurent latéralement dix personnages désignés comme étant Abbas [Siculus, Nicolas Tedeschi (ou Tudeschis, dit aussi Panormita)], Jo[annis] de Imola, A. Debutric [Antonius de Butrigariis ou Bottigari], C. Zabarella, O. Andree (?), Bartholu[s de Saxoferrato], Baldus [de Ubaldis], Alexander [de Alexandro], P[aulus] de Castro et Ason [Andreas de Soncino ?]. À la partie supérieure, un bandeau représente une allégorie de la Justice avec à sa droite le pape suivi d’un groupe de clercs et à sa gauche l’empereur suivi d’un groupe de soldats. À la partie inférieure est figuré l’auteur en chaire encadré de deux groupes d’écoliers assis sur leurs bancs.
Les imprimeurs lyonnais et parisiens vont reprendre le procédé. Un commentaire du Code par Bartole (de Saxoferrato), imprimé à Lyon en 1526 par Jacques Mareschal, est orné d’un titre-frontispice à encadrement, au décor Renaissance fleuri particulièrement chargé, qui ne laisse qu’une place réduite au texte, pourtant développé, qui en forme le titre. En tête, dans un fronton, est figuré l’empereur trônant, entouré de conseillers et d’hommes en armes ; en pied, Bartole, en chaire, enseigne un groupe de seize élèves répartis de part et d’autre sur quatre bancs ; latéralement, sous les blasons des villes de Paris et de Lyon sont figurés les six docteurs suivants : Alexa[nder] de imo[la], And[reas] de Poma[te], Jason de May[no], And[reas] Barba, Benedic[tus], Vad[dus] et Ange[lus] de Peru[sio] ; au centre enfin, la marque de l’imprimeur, au lion et à la rose. Cette édition a en outre l’intérêt de révéler l’existence d’un consortium. En effet, ce frontispice, dessiné par Guillaume Le Roy pour l’éditeur parisien Jean Petit et ses associés, Jacques Bouys et Charles de Bougne, est destiné aux impressions qui sont réalisées à Lyon. La marque, qui est nouvelle, est celle de ce consortium95. Comme de tels encadrements passaient fréquemment d’un atelier à un autre, on trouve celui-ci réutilisé, mais sans les blasons et avec les cartouches patronymiques restés blancs, en tête des Consilia de Ludovicus Romanus, publiés en 1533 par l’éditeur lyonnais Vincent I de Portonariis, dont la marque remplace celle de Jean Petit96.
Ce caractère passe-partout du frontispice, déjà mis en lumière avec l’exemple de Batista de Torta cité plus haut, est le signe que cet art n’en est encore qu’à un stade peu avancé de son développement. Les pieds des figures sont en effet creusés de réserves destinées à recevoir des caractères mobiles qui permettent à l’imprimeur de nommer les personnages à son gré, selon les auteurs qu’il imprime. Baudrier reproduit un encadrement-frontispice à quinze personnages dessiné par Guillaume Le Roy pour Simon Vincent. Il est utilisé en 1520 par l’imprimeur de Lyon Jacques Mareschal pour les œuvres du bénédictin poitevin Pierre Bertoricus. Tous les cartouches sont laissés muets sauf celui de la figure centrale où est indiqué « Petrus Bertho. Pictavie. »97. Nous avons retrouvé le même encadrement utilisé sur les Traités de Barthélemy Ceppolla, imprimés à Lyon en 1511 pour Simon Vincent par Bernard Rosier et Jean Thomas. Seul le personnage principal est nommé : « Ceppola », mais en tête de la colonne des personnages de gauche est indiqué : « advocati », et en tête de celle de droite : « procuratores ». Cet encadrement est encore utilisé sur les Décisions de Guy Pape données par le même en 1520, avec en tête de colonne la mention « senatores » et les cartouches également muets98.
Un superbe frontispice du Décret de Gratien publié à Paris en 1561 par trois libraires associés, Guillaume Merlin, Guillaume Desbois et Sébastien Nivelle, place l’auteur au centre d’un décor gothique raffiné, écrivant dans un cabinet encombré de livres et d’objets divers, la tête tournée vers une troupe de docteurs au premier rang desquels figure un trio constitué d’un pape, d’un cardinal et d’un évêque, chacun lui montrant un livre ouvert. Tout autour, dans un encadrement figurent, logés dans des niches, quatorze personnages tenant également chacun un livre ouvert. Cinq auteurs appartiennent à l’Ancien Testament : Moïse, Job, David, Isaïe et Jérémie ; cinq au Nouveau Testament : Jean, Matthieu, Luc, Marc et Paul ; enfin trois Pères de l’Église : saint Jérôme, saint Augustin, saint Ambroise et le pape saint Grégoire (Cf. pl. 4)99. L’éditeur parisien François Regnault place également le Grand Coutumier de Bourgogne, qu’il édite en 1534, sous les auspices d’un certain nombre d’anciens jurisconsultes100. De part et d’autre s’alignent, dans une succession de dix cadres limités par des colonnes, les docteurs suivants : Bartholus [de Saxoferrato], Baldus [de Ubaldis], Pau[lus] de Cast[ro], Salicet[us], Alexander [de Alexandro], Jason [de Mayno], Panormita (Nicolas Tedeschi), Celinus (?), Philip[pus] Deci[us], et De Tur[re]cre[mata Johannes]. Aucun de ces auteurs n’est français et n’a le moindre rapport avec le droit coutumier. On reste encore, même s’agissant de l’édition d’un texte de droit français, sous l’influence du droit romain, influence d’autant plus manifeste ici que dans le bandeau supérieur de l’encadrement trône l’empereur. En pied, assez insolite dans ce contexte, l’éléphant chargé d’un château qui est la pittoresque marque de l’éditeur101.
Tout autre est l’esprit qui préside, trente ans plus tard, au dessin ornant l’entête des coutumes de Bourges, Orléans et Tours commentées par Nicolas Bohier, publiées en 1575 à Francfort par Nikolaus Basse102. Dans une vaste salle aux larges arcades ouvertes sur une campagne semée de bourgades, un docte personnage debout, drapé dans un grand manteau de brocart, présente son œuvre à un groupe de gentilshommes assis dans l’attitude de l’attente, élégamment vêtus d’habits à la mode. Certes la conception et le style de cette scène se ressentent de son origine germanique, mais il n’en reste pas moins qu’elle cherche délibérement à situer l’édition de ce coutumier dans un contexte strictement contemporain, hors de toute référence romaine, et à signifier par là qu’on est en présence d’un droit qui ne tire son autorité que de sa seule origine nationale.
Désormais, oublieux du passé romanisant, les frontispices pourront sans ambages affirmer le caractère français, voire provincial, du droit civil. C’est le cas de ce titre-frontispice au dessin un peu naïf du commentaire de Jacques Barraud de la coutume de Poitou publiée à Poitiers en 1625 par Julien Thoreau, où règnent les allégories de la Prudence, du Commerce, du Temps et de l’Harmonie, placées sous celle d’une Justice aux seins généreux enserrant un blason fleurdelysé entre ses jambes écartées (Cf. pl. 6). C’est encore le cas de cet autre superbe titre-frontispice, œuvre du talentueux et fécond graveur Léonard Gaultier103, sur le commentaire de la coutume de Bretagne édité à Paris en 1646 par Nicolas Buon, où l’on voit un portique accoté des statues de l’Histoire et de la Justice au fronton duquel règne un blason à semis d’hermines (Cf. pl. 7). Plus locale encore, cette vignette de titre agreste figurant une vache, clochette au cou, et un petit veau, qui orne le titre des Fors et costumas de Bearn édités à Lescar en 1625 par Joan de Saride, sans doute en guise d’évocation du blason de la province « à deux vaches passant »104.
Si les frontispices de coutumiers sont assez peu nombreux105, ceux des divers autres traités de droit français sont plus fréquents, sans l’être toutefois autant, et de loin, que dans les autres domaines. Ils privilégient désormais l’allégorie et surtout le portrait (Cf. pl. 26 & 27). Ces derniers se comptent par dizaines et, s’ils sont quasi inévitables pour certaines sommités, telles que Tiraqueau106, Cujas ou plus tard Pothier, ils ne semblent pas avoir toutefois de rapport direct avec la célébrité de l’auteur, mais procéder plutôt de l’initiative de l’éditeur qui, par goût ou par calcul commercial, fait l’effort, qui sort de la compétence habituelle des typographes (du moins après que le procédé de la gravure sur bois est tombé en désaffection), de faire graver et tirer spécialement un cuivre. Citons un peu au hasard ceux de : Charles Du Moulin (Tractatus de origine (…) regni & monarchiæ Francorum…, Lyon, Claude Senneton, 1564)107 ; Louis Dorléans (Ouvertures des parlements faictes par les roys de France, tenant leur lict de justice, Paris, Guillaume Des Rues, 1612) ; Gauret (Le Vray style pour procéder au Châtelet de Paris…, Paris, Pierre Rocolet, Pierre Lamy et Jean Guignard, 1658) ; Jacques Cujas (Opera omnia…, Paris, Société typographique, 1658) ; Jean Boiceau de La Borderie (Responsa (…) ad varias questiones (…) in consuetudine Pictonum…, Poitiers, Jean Fleuriau, 1659), Jean-Guy Basset (Plaidoyers et arrests de la cour de parlement (…) de Dauphiné, Paris, Jacques Collombat, 1695) ; Antoine Bruneau (Nouveau Traité des criées, Paris, Jacques Le Febvre, 1704) ; Jacques Savary (Le Parfait Négociant…, Paris, Veuve de Jacques I Estienne, 1736) ; Henri Cochin (Œuvres, Paris, Jean-Jacques de Nully, 1751) (Cf. pl. 12, fig. 26)108 ; Robert-Joseph Pothier (Traité sur différentes matières de droit civil, Paris, Debure, 1773), etc.
Parfois, le portrait n’est pas destiné à célébrer l’auteur, mais à honorer le grand personnage auquel l’auteur dédie son travail. Ainsi, la troisième édition du Journal du Palais… par Claude Blondeau et Gabriel Guéret est-elle ornée du portrait de Jean-Antoine de Mesmes, comte d’Avaux, premier président au Parlement (Paris, Michel Guignard, 1713) (Cf. pl. 12, fig. 25), et le Coutumier général de Poitou par Jacques Boucheul de celui du comte de Laval (Poitiers, Faulcon, 1728).
Assez fréquents sont les portraits du roi ou les représentations de la Majesté royale en sa qualité de souverain maître de la justice, bien propres à rappeler que les magistrats des cours souveraines et a fortiori ceux des juridictions inférieures ne sont que ses délégataires. Les Ordonnances royaux (Paris, 1644) figurent le jeune Louis XIV assis sur les genoux de sa mère Anne d’Autriche, souriant aux échevins dont le visage traduit le plus profond respect, tandis que Les Ordonnances royaux sur le faict et jurisdiction de la prévosté des marchands et eschevinage de la ville de Paris (Paris, 1695) montrent une réception des échevins par Henri IV109. Les Loix criminelles de France dans leur ordre naturel données par Muyart de Vouglans en 1780 sont ornées d’un bandeau figurant le médaillon de Louis XVI, appuyé sur une corne d’abondance, couronné par la Justice, tandis que le texte débute par une grande capitale ornée de la devise « Nec pluribus impar » sur fond de soleil rayonnant (Cf. pl. 19, fig. 52). De telles images ne sont pas rares mais d’autant plus nombreuses que l’on glisse du pur domaine juridique au domaine politique ou événementiel : entrées solennelles, conquêtes de nouveaux pays ou réduction à l’obéissance d’une ville telle que La Rochelle fournissant un sujet d’inspiration inépuisable. Contentons-nous dans cet ordre d’idées de citer la spectaculaire gravure qui orne La Recherche des droits et prétentions du Roy et de la couronne de France sur les royaulmes, comtés, villes et païs occupés par les princes estrangers (Paris, François Pomeray, 1632), où la personne de Louis XIII, en habit de grand apparat, assis sur son trône sous un dais fleurdelysé, occupe tout le tiers supérieur, tandis que sur les plis et replis du drap du dais qui se répand sur le reste de la surface de la page sont alignés les blasons de la douzaine de pays concernés.
Quant aux allégories et figures symboliques, la plus habituelle est, bien entendu, celle de la Justice, représentée sous les traits d’une figure féminine debout, tenant le plus fréquemment d’une main une balance aux plateaux équilibrés, signifiant l’équité, et de l’autre une épée, symbolisant la force mise au service de la justice. Cette figuration, qui allait devenir classique et continue à être employée aujourd’hui, avait subi quelques variations. La Justice fut aussi figurée quelquefois les yeux bandés, pour signifier son impartialité, parfois un sein découvert pour signifier sa générosité, parfois tenant un faisceau de verges symbolisant le châtiment, parfois encore les mains cachées, pour éviter la tentation de les tendre vers les écus des justiciables, etc. Le frontispice de L’Art de procéder… de L. Lasserré (Paris, Nicolas Le Gras, 1680) montre par exemple une justice assise sous un dais et couronnée de feuillages, les yeux bandés, les bras posés sur les genoux, mains entrées dans les manches et portant une balance (Cf. pl. 33, fig. 86). Même lorsque son image se fut fixée de façon immuable, certains graveurs laissèrent libre cours à leur imagination. Une vignette des Œuvres posthumes de Pothier (Orléans, Massot, 1778) montre ainsi une allégorie de la Justice assise, contemplant nostalgiquement un portrait de l’auteur, tandis qu’un génie, juché sur une pile de ses œuvres, lui présente un livre ouvert (Cf. pl. 14, fig. 33). Citons enfin l’une des plus remarquables de toutes, et par son symbolisme et par sa grande qualité artistique, cette scène à multiples personnages où l’on voit, sur le parvis du parlement de Rennes, une allégorie de la Justice accompagnée d’une allégorie de la Bretagne s’incliner devant le roi de France derrière lequel sont placés les représentants des ordres de l’État110. C’est bien la preuve que si les juristes ne s’étaient pas montrés si iconophobes, comme nous le confirmerons plus loin, le talent des artistes eût pu s’exercer avec succès en ce domaine comme en tous les autres (Cf. pl. 34).
Fort rares sont les frontispices parlants donnant lieu à des représentations réalistes en rapport direct avec le contenu du livre. L’un des plus remarquables est celui du Parfait Négociant de Jacques Savary (nelle éd., Avignon, Pierre Delaire, 1763), qui présente une série de scènes sur fond de port où manœuvrent des bateaux et où s’affairent des portefaix : financier acceptant un billet qu’on lui présente, groupe de marchands en fin de discussion concluant d’une paumée un contrat, marchand de tissus présentant une étoffe à une jeune femme, etc. Cette superbe eau-forte de l’édition avignonnaise a été heureusement préférée au portrait qui orne les éditions parisiennes antérieures ; elle est manifestement propre à satisfaire au mieux une clientèle maritime. Citons encore ce pêcheur et ce chasseur qui encadrent le titre d’un code des Eaux et Forêts111. Plus directement juridique, mais d’origine étrangère, cette véritable scène judiciaire qui orne le titre des œuvres complètes de J. et F. de Sande (Anvers, M. Parys, 1674) : on y voit une cour de justice avec avocats en train de plaider, bancs garnis de prévenus et au premier plan la pittoresque animation du « carreau » où gambade un chien entre des groupes de personnages vacant à toutes sortes d’affaires, dont un colporteur de factums et une mère de famille faisant admirer son bambin (Cf. pl. 31, fig. 80).
Deux types de figurations spécifiques, bien conformes aux préoccupations propres des juristes, vont toutefois se présenter régulièrement dans les ouvrages du XVIe siècle, avant de disparaître par la suite. La première, qui introduit fréquemment l’édition des œuvres de Justinien, a une raison historique. Elle figure l’Empereur. Un premier type est d’abord préféré par les éditions vénitiennes du début du XVIe siècle, qui mettent en avant l’activité législative ou judiciaire de l’empereur romain. C’est le cas dans un en-tête illustrant en 1522 les Commentaria de Francesco Accolti : l’empereur sur son trône, épée dressée à la main droite et index de la main gauche levé, délibère, assisté de deux groupes de guerriers et de légistes ; c’est aussi le cas en 1507, dans un Casus institutionum de Gulielmus Accursus, avec une vignette de titre montrant l’empereur sur son trône, le sceptre à la main, assisté de deux légistes, rendant justice à un homme agenouillé devant lui112.
Cette figuration paraît rapidement éclipsée par celle, beaucoup plus fréquente, de l’empereur allemand sur son trône, épée d’une main, globe terrestre surmonté de la croix de l’autre, entouré à droite de trois dignitaires ecclésiastiques et à gauche de quatre princes laïcs, qui sont les sept princes électeurs, avec le plus souvent en fond un groupe d’hommes en armes symbolisant sa force militaire mise au service de la justice et de la défense de la chrétienté. Cette image, qui traduit la primauté allemande en matière d’édition de droit romain, a été si popularisée qu’elle devient par la suite inséparable de l’édition des divers livres du Corpus, quelle que soit leur origine, et donne naissance à une multitude de copies et de versions, qui en varient le décor, mais pas la disposition des personnages. Une autre constante est la présence, devant le trône, d’un chien assis au premier plan sur le sol (plus rarement deux chiens jouant), symbole de la fidélité que les princes doivent à l’empereur113. Cette figuration, qui fait généralement l’objet d’une vignette isolée, peut aussi se contenter d’orner le fronton d’un encadrement à décor comme dans le cas du Grand Coutumier de Bourgogne évoqué précédemment (Cf. pl. 25). Il y joue le même rôle symbolique que la représentation, formellement similaire, de la Trinité encadrée d’anges adorateurs, qui orne au XVIe siècle le fronton de l’encadrement de nombreuses pages de titre d’ouvrages théologiques, mais aussi parfois de livres juridiques114.
La seconde figure spécifique assez répandue, celle des arborescences, a une explication technique. Pour des raisons morales et politiques qui lui sont propres, l’Église, qui a réussi à se faire attribuer l’exclusivité de la législation matrimoniale, a imposé une stricte exogamie qui oblige à connaître exactement les degrés de parenté les plus lointains possible pour détecter les empêchements à mariage. Il en dérive une telle complexité qu’un tableau des degrés de parenté devient nécessaire. L’arbre de parenté prend alors la forme imagée d’un arbre de consanguinité, fréquemment anthropomorphe, un vieillard dressé sur le tronc en tenant deux branches chargées de fruits, les autres rameaux semblant sortir de son corps (Cf. pl. 30, fig. 78). À cet arbre de la parenté par le sang se joint parfois un arbre de l’affinité ou parenté par alliance, elle aussi génératrice d’empêchements115. Un besoin identique doit également être satisfait en matière successorale. On a alors un arbre de l’hérédité. Les trois sont parfois conjoints, comme dans un traité de Joannes Crispus de Montibus, Repetitio tituli institutionum de hereditate ab intesto, 1490. D’un personnage assis sur le sol jaillissent trois branches : la première, prolongeant son bras droit, est l’arbre d’affinité contenant dix-huit degrés de parenté, la seconde, sortant de sa tête, est l’arbre de consanguinité qui contient quarante parentés issues de sept lignes de rameaux, la dernière enfin, prolongeant son bras gauche, est l’arbre de succession qui compte deux cent deux degrés de parenté issus de vingt et une lignes de rameaux116.
Ce procédé d’arbres sera également utilisé pour illustrer d’autres questions procédurales délicates. On trouve ainsi un arbor de jure patronatus dans des Clémentines publiées à Paris en 1585, un arbor jurisdictionum dans un Infortiat publié à Lyon en 1585 par la Compagnie des libraires (lequel, fait exceptionnel pour une illustration juridique, est rehaussé de gouache), ainsi qu’un arbor exceptionum dépliant dans un Digeste publié à Lyon en 1558 par Hugues de La Porte et Antoine Vincent117. De telles figures disparaîtront à peu près totalement des ouvrages de droit postérieurs au XVIe siècle – exception faite toutefois, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, pour la plupart des nombreuses éditions des Loix civiles… de Domat (Cf. pl. 30, fig. 79) –, et si, parfois, la nécessité de tableaux se fait sentir encore en matière procédurale ou coutumière, ils ne sont plus historiés.
Enfin, pour terminer ce panorama des figures isolées, évoquons les lettres ornées, bandeaux et culs-de-lampe, souvent utilisés jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Ils sont presque toujours purement décoratifs et communs à tous les domaines, et ce n’est que par exception que les éditeurs de livres de droit en font graver qui soient adaptés à cette matière118. Astucieusement, certains éditeurs ont adopté un bandeau polyvalent, dont un dessin type est de multiples fois copié et reproduit quasi à l’identique, figurant, réparties de part et d’autre du blason royal, les sept vertus cardinales et théologales dont la Justice, qui vient en tête (Cf. pl. 34, fig. 87 & 88)119. Toutefois les factums, ordonnances et autres pièces judiciaires ornés habituellement d’un bandeau aux armes royales le sont aussi fréquemment de l’allégorie de la Justice déclinée, avec plus ou moins de talent, dans les figurations les plus variées (Cf. pl. 34, fig. 89 à 95).
2) Les programmes iconographiques et la désaffection des juristes pour l’illustration
Frontispices allégoriques, portraits et vignettes diverses, s’ils contribuent à agrémenter certains ouvrages de droit comme ceux des autres disciplines, et continueront à le faire jusqu’à la Révolution, n’en font pas pour autant des ouvrages illustrés à proprement parler. Ils tiennent de la convention typographique plus que d’une volonté d’ordre décoratif ou documentaire affirmée. Or l’ouvrage illustré soutient un propos particulier qui est de renforcer le caractère soit édifiant, soit documentaire, soit distrayant du texte. Chaque discipline, et chacune de ses sous-disciplines – théologie, histoire, belles-lettres, sciences, voyages, nature, etc. – se donnera ainsi les moyens de se mettre en valeur, non seulement en multipliant les ouvrages illustrés, mais en produisant des ouvrages susceptibles de la plus large popularité. Les ouvrages illustrés de chacune de ces sciences se comptent par milliers et les ouvrages prestigieux, connus et désirés de tous les bibliophiles, par dizaines. Même parmi les plus éclairés de ceux-ci, en est-il beaucoup qui puissent citer sur quatre siècles un seul livre juridique à figures ?
Pourtant, tout n’avait pas trop mal commencé. À Venise, capitale du livre illustré au commencement du XVIe siècle, si les possibilités d’inspiration et la qualité de la clientèle avaient plutôt privilégié textes religieux et littéraires, on n’en avait pas pour autant négligé d’illustrer les traités de droit romain et de droit canonique qui sortaient des mêmes presses, suivant en cela d’anciennes pratiques qui avaient doté d’enluminures de nombreux manuscrits juridiques médiévaux. Par chance, toute cette production a fait l’objet de la remarquable bibliographie illustrée du prince d’Essling, ce qui permet de les repérer facilement120. Nous y avons relevé au moins six ouvrages qui possèdent un programme iconographique significatif : des Consilia de Bartole de 1487 avec trente-neuf figures ou diagrammes relatifs à la mesure et à la délimitation des propriétés foncières, un Décret de Gratien de 1489 orné de cent trente vignettes, des Décrétales de Boniface VIII de 1514 ornées de soixante-seize vignettes, des Décrétales de Grégoire IX de 1514 ornées de cent quatre-vingt-deux vignettes, des Institutions au droit civil de 1538 par Sylvester Aldobrandinus, ornées de vingt-quatre vignettes, enfin des Instituta de Justinien comportant vingt-deux vignettes et un arbre121.
Précisons d’abord le contenu du plus illustré d’entre eux, les Décrétales de Boniface VIII, avec un frontispice, deux arbres de parenté à pleine page, et cent quatre-vingt-deux vignettes in-texte. À l’exception de la planche liminaire, Jésus devant Pilate, l’ensemble des autres figures est choisi pour son adéquation au texte. Elles sont de la plus grande variété. On en trouve bien évidemment de nombreuses illustrant le rituel des diverses cérémonies du culte ainsi que la procédure judiciaire, mais aussi des scènes de torture ou d’exécution des sentences et un grand nombre de petites scènes familières décrivant les faits et gestes les plus divers ayant un rapport avec la vie juridique journalière, dont de nombreuses scènes champêtres qui ne dépareraient pas un Virgile. Toutes ces vignettes, presque carrées et de dimension assez modeste, occupent environ un cinquième de page. Généralement placées en tête de chapitre, en position centrale, encadrées de gloses et coiffant deux colonnes de texte, elles mettent en scène avec une réelle efficacité de petits groupes de personnages animés, dans un décor adéquat. Le dessin quoique traité avec sobriété et presque fruste n’en demeure pas moins fort évocateur, chaque protagoniste adoptant une attitude physique et développant une gestuelle exactement adaptées au passage illustré. Ces figures, toutes théâtrales, ne sont pas sans rappeler les vignettes de mise en scène qui ornent alors de nombreuses éditions vénitiennes des pièces de Térence (Cf. pl. 28, fig. 73).
Même type d’illustration pour les Institutes122. Les vingt-deux vignettes qu’elles contiennent, oblongues, y occupent toute la largeur de la justification, gloses comprises. Elles sont caractérisées par la même sobriété, avec toutefois une inspiration naïve plus prononcée. Scènes proprement liées au droit canonique en moins, elles traitent les mêmes thèmes juridiques ou judiciaires. Par exemple, au chapitre de l’hérédité, on voit un défunt veillé dans une chambre par deux personnes tandis que, dans la pièce d’à côté, d’autres personnes fouillent un coffre d’où un protagoniste sort un testament ; au chapitre des noces, un clerc unit deux fiancés derrière lesquels se pressent invités et musiciens ; au chapitre de la loi Aquilia (responsabilité délictuelle), la vignette se décompose en trois tableaux illustrant trois hypothèses expressément prévues par le droit romain : un homme tue le porc d’autrui, un autre un chien, un troisième juché sur un arbre coupe une branche qui tue un passant, etc. (Cf. pl. 28, fig. 73).
Ces deux derniers exemples vénitiens restent empreints de l’esthétique médiévale. Deux décennies plus tard, la Renaissance a modifié le goût et le style. Elle imprègne de sa modernité ce qui constitue sans doute le plus remarquable des illustrés juridiques, la Pratique et enchiridion des causes criminelles, illustrées de plusieurs élégantes figures du jurisconsulte flamand (né à Bruges) Josse de Damhoudère. Son ouvrage, tant dans sa première version latine que dans ses traductions allemandes, néerlandaises ou françaises, connut de très nombreuses éditions au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, la plupart illustrées. Celle de Louvain, donnée en 1555 par Étienne Wauters et Jean Bathen, contient cinquante-sept figures. La réimpression d’Anvers chez Jean Bellère en 1562 en contient soixante-neuf (Cf. pl. 29). Quoique, dans le texte, ces figures occupent la majorité de l’espace de la page, les lignes de texte se réduisant, en haut, au titre, et en bas, au sommaire du chapitre. Ces illustrations, qui révèlent un talent certain, sont fort élaborées, avec de multiples personnages aux gestes éloquents, dans des décors fouillés. Beaucoup constituent de véritables petits tableaux de genre et donnent de précieux détails sur le mobilier, l’habillement, l’architecture et les mœurs. Les scènes de rue et les scènes champêtres y sont nombreuses et souvent pittoresques, les scènes de torture ou d’homicide traitées avec réalisme, crudité, ce qui est aussi le fait d’autres scènes que les bibliographes du passé qualifiaient de « licencieuses ». Par exemple au chapitre du stupre, qualifié aussi de « despucellage », on voit deux hommes culbuter gaillardement sur un lit deux filles effrayées qui s’égosillent ; à celui de la fornication, deux couples s’embrassent avec passion sous les frondaisons d’un site champêtre, sous l’égide d’un fou qui brandit sa marotte, etc. Damhoudère est également l’auteur d’une Pratique civile dont les éditions du XVIIe siècle, et au moins jusqu’en 1660, sont aussi ornées de gravures123.
Ces trois exemples de suites d’illustrations juridiques, concernant droit canonique, droit romain et droit criminel, qui ne sont certes pas les seuls mais qu’il ne serait guère facile de multiplier beaucoup, ont tous une origine étrangère. Nous n’avons jamais rencontré de livres de droit français ou d’origine française aussi illustrés que ceux-ci, pour aucune période, bien qu’il y ait eu d’importants coutumiers manuscrits enluminés124 ainsi que quelques timides tentatives des presses lyonnaises qui n’ont pas, en ce domaine, cherché vraiment à imiter les presses vénitiennes. Un Corpus juris civilis publié à Lyon en 1549-1550 par Hugues de La Porte est ainsi orné de dix-huit lettres capitales à décor judiciaire, figurant juges et plaideurs, phases de la procédure, scènes de supplice et peines125 ; l’Infortiat d’un autre, imprimé à Lyon en 1585 par la Compagnie des libraires, est orné d’une série de vignettes à décor symbolique, dans la veine des livres d’emblèmes126. Mais rien dans tout cela n’a l’envergure des exemples précédents. Ce désintérêt pour l’illustration juridique chez les praticiens et donc chez les éditeurs se révèle par exemple dans le fait que les nombreuses éditions lyonnaises des œuvres de Damhoudère ne sont pas illustrées, alors qu’il aurait paru naturel qu’elles le fussent à l’instar des éditions flamandes contemporaines, pour peu que cela eût été le gage d’une meilleure vente.
Ni les travaux de Jeanne Duportal ou des Tchémerzine pour le XVIIe siècle, ni ceux d’Henri Cohen pour le XVIIIe siècle ne signalent le moindre ouvrage de droit pur qui ait bénéficié d’illustrations allant au-delà des frontispices et vignettes isolées127. Pour en trouver au moins quelques-uns qui s’en rapprochent, il faut aller aux frontières du droit. La veine récréative des relations de procès donne une édition des Causes amusantes et connues de 1769-1770 en deux volumes in-12, illustrée de neuf figures (Cf. pl. 32, fig. 82)128, et surtout un Recueil général des pièces concernant le procès entre la Dlle Cadière de la ville de Toulon et le père Girard, Jésuite, en deux volumes in-folio, imprimé à Aix par David en 17… (sic : vers 1770) qui entrerait plutôt dans la rubrique curiosa. Qualifié de fort rare par Cohen, il contient « une suite très curieuse de 32 planches à l’eau-forte, dont quelques-unes libres »129. Se rattachant plutôt à l’histoire, on peut citer l’ouvrage de Constantin de Renneville, L’Inquisition françoise ou l’Histoire de la Bastille, édité à Amsterdam en 1724, avec ses cinquante-cinq figures130. Plus en rapport avec la célébration d’une institution prestigieuse qu’avec sa fonction, on trouve en 1685 un Panégyrique [et] Harangue prononcée en l’honneur du parlement de Paris par le jésuite Jacques de La Baune, orné d’une superbe vignette de la Justice, un en-tête figurant une assemblée solennelle du parlement dessiné par P. Sevin, diverses lettres ornées et vignettes spéciales et, dans la seconde partie, la liste de tous les présidents et conseillers depuis Philippe le Bel avec onze planches donnant leurs trois cent quatre blasons (Cf. pl. 31, fig. 81). À l’extrême fin du XVIIIe siècle, le droit public a donné (an VIII = 1799-1800) une Constitution de la République française, représentée par figures, ornée de sept planches gravées par E.-A. David, exemple suivi au début du siècle suivant avec une Charte constitutionnelle des Français illustrée de six figures de Monnet (Cf. pl. 32, fig. 83).
Bref, rien dans tout cet échantillonnage qui soit de nature à infirmer la proposition selon laquelle le livre de droit illustré n’existe pas sous l’Ancien Régime, étonnante vacuité qui se perpétue imperturbablement de nos jours. Quelle explication donner à cette singularité ? On peut avancer que les exemples vénitiens et leur ultime suite de Damhoudère, puis la disparition de cette veine, traduisent le passage d’un ancien monde médiéval où les représentations judiciaires s’inscrivent dans un contexte général qui favorise un symbolisme porteur de messages compréhensibles par tous les lettrés, à un monde classique dans lequel la justice, devenue complexe, est pure affaire de spécialistes au langage secret, quasi impénétrable par le reste des mortels. L’image qui subsiste seule, frontispice allégorique à la signification facile ou portrait, s’inscrit simplement dans le cadre d’une convention typographique générale dans laquelle le livre de droit n’a pas de place à part. Le propre du livre de droit, hors cette convention sans signification propre, est alors d’être privé de tout ce qui peut parler à l’imaginaire, ce qui classe désormais le juriste dans une catégorie bien particulière et pour tout dire unique, celle d’un lecteur obligé de rester froid et distant car rien ne doit troubler sa réflexion. Par définition, les juristes sont des gens sérieux, chargés par le souverain d’interpréter et de faire appliquer les normes de la vie sociale, rôle de plus en plus complexe et subtil, qui se joue le plus habituellement lors des moments fondamentaux de l’existence ou à l’occasion de ses accidents de parcours, ce qui exclut toute légèreté et coupe court à toute fantaisie. L’image, dont le rôle premier est de nourrir l’imagination leur est non seulement inutile, mais nocive, en les détournant de la réflexion pure et en induisant une interprétation préétablie des textes. Leur nourriture à eux se trouve dans l’arcane des textes, seules références de nature à alimenter utilement leur raisonnement. S’ils ont besoin d’illustrations, au seul sens figuré du terme, ils vont les rechercher dans la doctrine et la jurisprudence, leur unique source de réflexion. Voilà pourquoi, hors une première série de tentatives vite réprimées, le droit, et en tout cas le droit français avec lequel nous sommes plus familiarisé, va devenir et rester jusqu’à ce jour absolument iconophobe131. Seule échappera à ce naufrage l’image symbolique de la femme à la balance132.
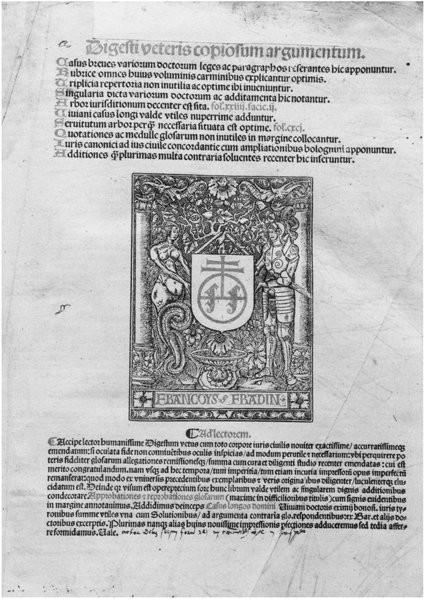
Fig. 1. Dans la première moitié du XVIe siècle, le droit romain, sous forme de volumineux in-folio, constitue l’essentiel de la production juridique. L’éditeur François Fradin s’en est fait une telle spécialité que le qualificatif de « fradins » fut donné à Lyon à tous les ouvrages de droit de ce format.

Fig. 2. L’importance quantitative de la production de droit romain nécessitant des investissements considérables, les éditeurs sont contraints de s’associer. La plus importante des associations de production et de diffusion unit un groupe de libraires lyonnais qui choisissent pour marque collective le « Lion moucheté ».
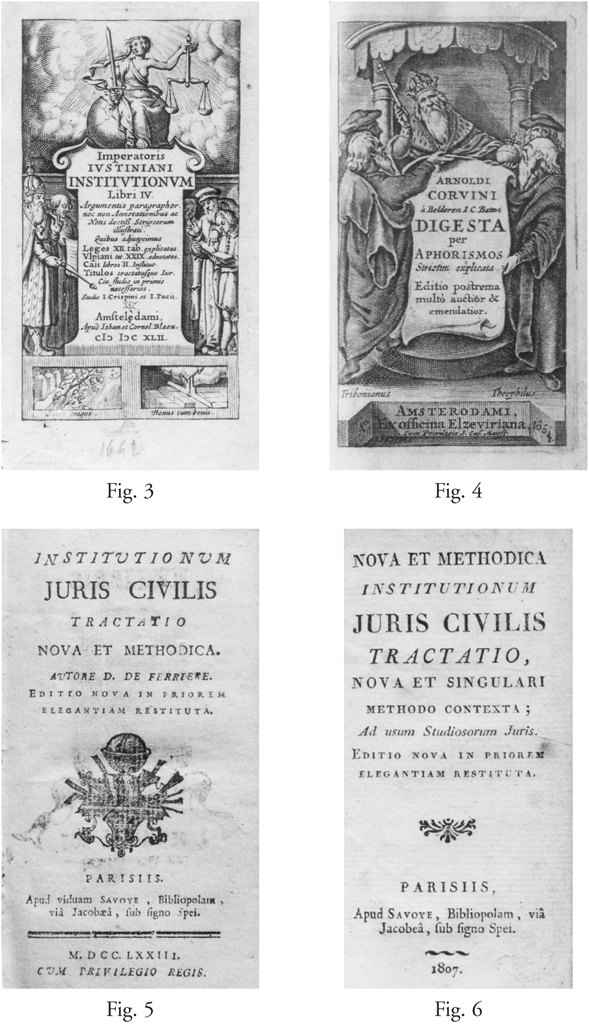
Fig. 3 à 6. Droit positif dans de nombreux pays et partout base de l’enseignement, jusques et y compris au XIXe siècle, le droit romain s’adapte aux nécessités pratiques en adoptant des formats de poche, généralement in-16, favoris des presses des Pays-Bas, notamment pour le petit manuel pédagogique que sont les Institutes.

Si Lyon maintint longtemps sa prééminence en matière d’édition de droit, Paris lui ravit rapidement le domaine théologique et partant le droit canonique qui occupait une place quasi égale au droit romain dans les bibliothèques juridiques.
Fig. 7. Frontispice du Décret de Gratien (Decretum Gratiani), le traité de base de l’enseignement du droit canonique, publié à Paris en 1561 par Guillaume Merlin, Guillaume Desbois et Sébastien Nivelle.

Plus que le droit romain et le droit canonique, dont l’édition bénéficia surtout, hors Lyon et Paris, aux presses allemandes et italiennes, c’est le droit coutumier, purement autochtone, qui allait permettre à de nombreuses petites presses françaises de se lancer vraiment dans le secteur juridique et de produire, outre les textes, force commentaires.
Fig. 8 à 11. Quatre exemples, parmi des milliers, de textes coutumiers édités par des presses locales.
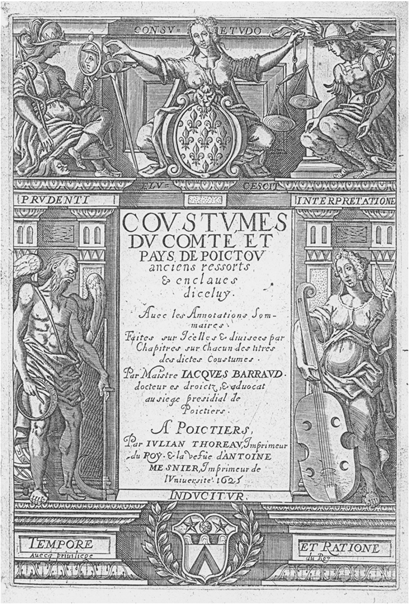
L’édition d’un texte coutumier peut parfois être jugée suffisamment gratifiante pour pousser son éditeur à lui donner une forme plus prestigieuse qu’à l’ordinaire, notamment en la dotant d’un frontispice allégorique.
Fig. 12. Le frontispice des Coustumes de Poictou, éditées par Julien Thoreau (Poitiers, 1625), multiplie les symboles : la Prudence, le Commerce, le Temps, l’Harmonie encadrent la Justice royale avec en pied le blason de l’auteur du commentaire.

Fig. 13. Le frontispice peut aussi donner l’occasion de marquer la singularité de telle province. Sur celui de la Coutume de Bretagne commentée par le célèbre Bertrand d’Argentré et éditée à Paris par Nicolas Buon en 1646, ce ne sont pas les fleurs de lys qui règnent, mais l’hermine bretonne, encadrée de deux Renommées.
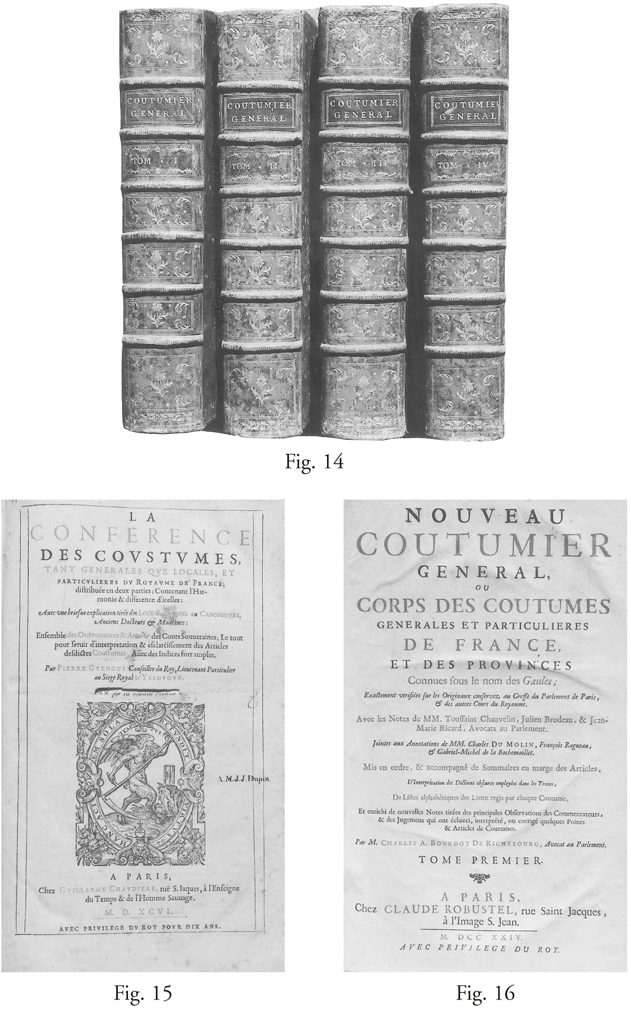
Fig. 14 à 16. Alors que les coutumiers particuliers, images de la dispersion du droit privé, sont de préférence édités localement, les coutumiers généraux, qui tendent à la synthèse, sont généralement parisiens. Celui de Pierre Guenois (fig. 15), dès 1596, s’efforce de confronter toutes les coutumes, celui de C.-A. Bourdot de Richebourg (fig. 14 et 16), le plus monumental de tous, se propose d’en publier l’inventaire exhaustif.
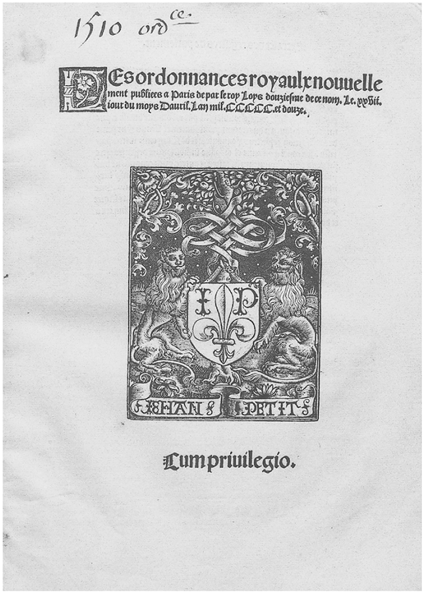
Fig. 17
Fig. 17. La nécessité de faire connaître le droit royal provoque la publication des ordonnances royales. En publiant en 1512 un récent texte de Louis XII, le libraire parisien Jean Petit profite de sa marque à la fleur de lys pour donner à sa publication un aspect officiel.

Fig. 18
Fig. 18. Les premières compilations d’ordonnances sont modestes. Celle publiée en 1527 par l’avocat Gilles d’Aurigny, « pour le bien et utilité des régnicoles de France », est de format petit in-8°. Ses 442 feuillets suffisent à faire le tour de la législation d’une dizaine de rois, de Philippe le Bel à François Ier.
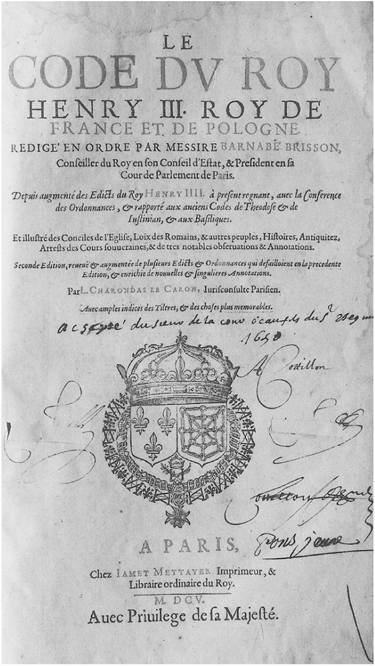
Fig. 19
Fig. 19. Le Code Henri III, compilé par Barnabé Brisson en 1587 et maintes fois réédité jusqu’au milieu du XVIIe siècle, avec son format in-folio et ses quelque 700 pages de textes mais aussi de notes, commentaires et références, constitue l’une des premières grandes tentatives raisonnées de compilation des ordonnances.
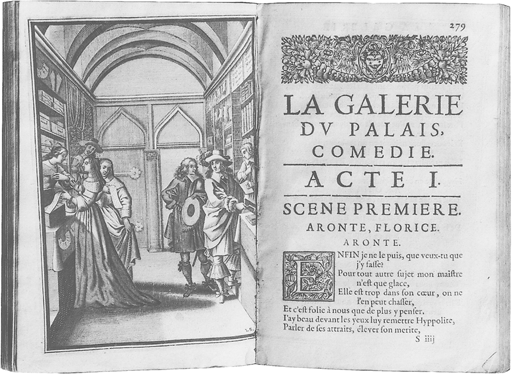
Fig. 20
Fig. 20. Le Palais développe une telle activité et entraîne un tel achalandage que ses abords deviennent un emplacement commercial de choix. Toutes sortes de commerces y prospèrent et en tout premier lieu celui de la librairie. La galerie du Palais en devient sujet d’inspiration pour écrivains et artistes, comme en témoigne cette illustration extraite des Œuvres de Pierre Corneille, Rouen, 1664.

Fig. 21
Fig. 21. La rédaction de grandes ordonnances et leur publication sont activement menées à bien sous Louis XIV. L’efficacité de leur mise en œuvre est liée à l’exactitude de leur édition. Certains libraires ou groupes de libraires obtiennent à cet effet la qualité de libraires privilégiés en échange de l’exercice d’une véritable mission de service public.
Les grandes armes royales figurant au titre et la mention « choisi(s) par ordre de Sa Majesté pour l’impression de ses nouvelles ordonnances» deviennent alors les formules qui assurent l’usager du caractère officiel du texte.
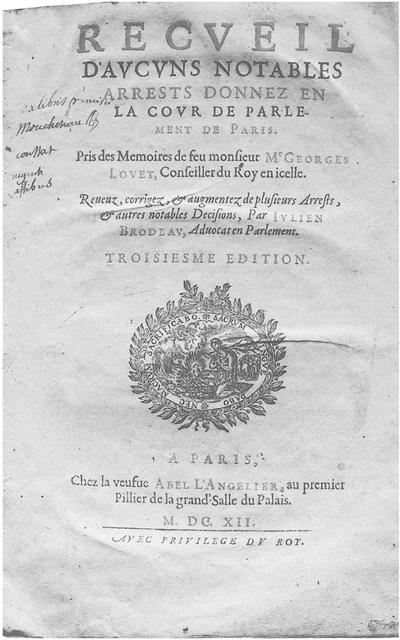
Fig. 22
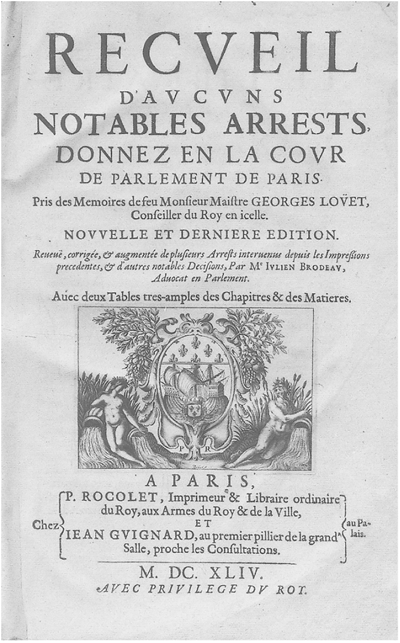
Fig. 23
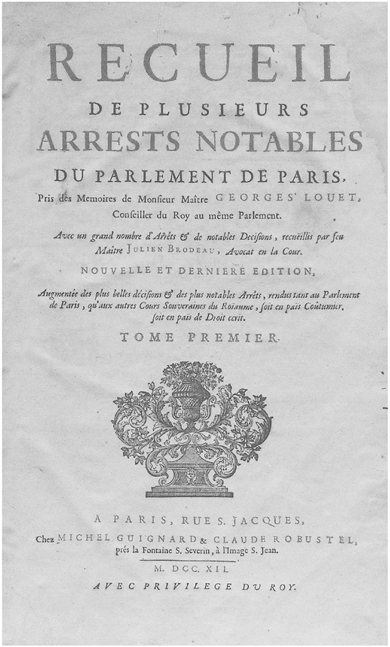
Fig. 24
Fig. 22 à 24. Comme les compilations d’ordonnances, celles des arrêts sont nombreuses et ne cessent de grossir au fil du temps. L’inventaire des éditions successives et la confrontation de leurs épaisseurs respectives constituent un bon indicateur pour juger de leur faveur. Ces trois éditions de Paris des Arrêts notables de Georges Louet qui s’étalent sur un siècle en témoignent. Le titre passe du format in-4°, de 1602 à 1612, au format in-folio à partir de 1614, puis, de 1678 à 1712, à deux volumes in-folio.

Fig. 25. Journal du Palais ou Recueil des principales décisions des parlements de France, par Claude Blondeau et Gabriel Guéret, placé sous les auspices du premier président au parlement de Paris, dont le portrait orne le frontispice (Paris, 1713).
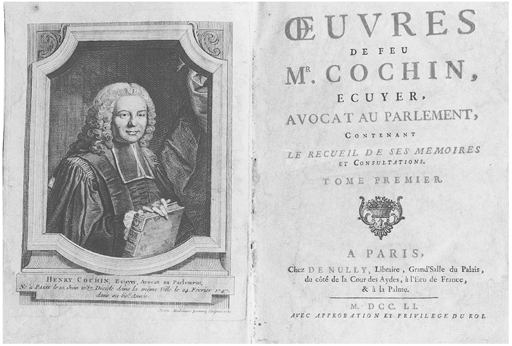
En même temps que les recueils d’arrêts se développent les recueils de plaidoyers, mémoires et consultations des auxiliaires de justice.
Fig. 26. Les Œuvres de l’avocat au Parlement Henri Cochin, parues de 1751 à 1766, sont publiées en 6 volumes in-4°.
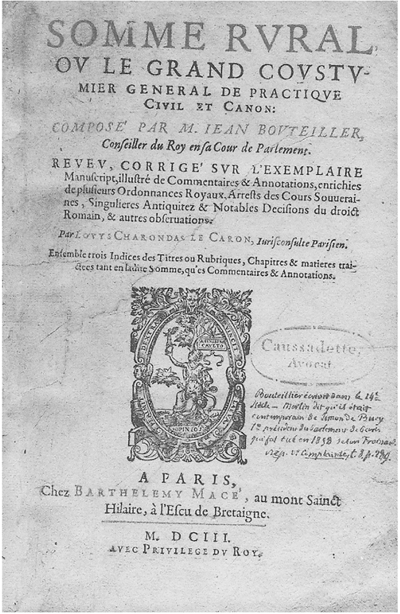
Fig. 27
Fig. 27. Le Somme rural de Jean Boutiller, lieutenant du bailli de Tournai à la fin du XIVe siècle, constitue le plus remarquable exemple de longévité avec au moins vingt-trois éditions (françaises) entre 1479 et 1621.
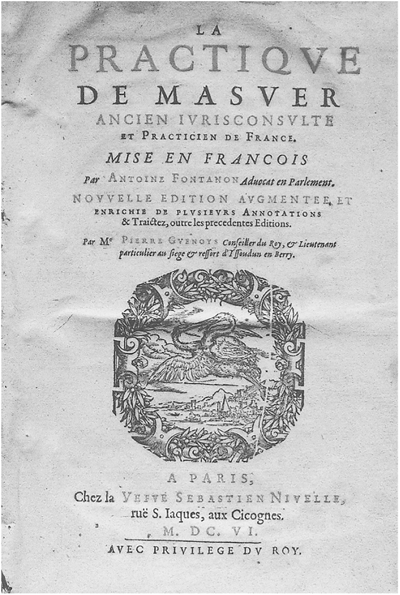
Fig. 28
Fig. 28. Une des vingt-six éditions de la Pratique de Jean Masuer publiées entre 1510 et 1610.
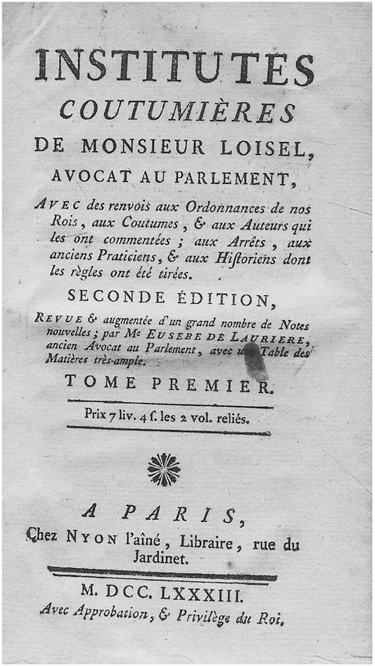
Fig. 29
Les premières tentatives de synthèse juridique ont pu conférer à leurs auteurs un prestige tel qu’il se traduit par des succès de librairie qui défient le temps.
Fig. 29. Les Institutes coutumières d’Antoine Loisel successivement données par Coquille (1607), Challine (1656) ou de Laurière (1710), furent sans cesse rééditées jusqu’en 1783 et connurent, avec chaque commentateur, un grand nombre d’éditions.
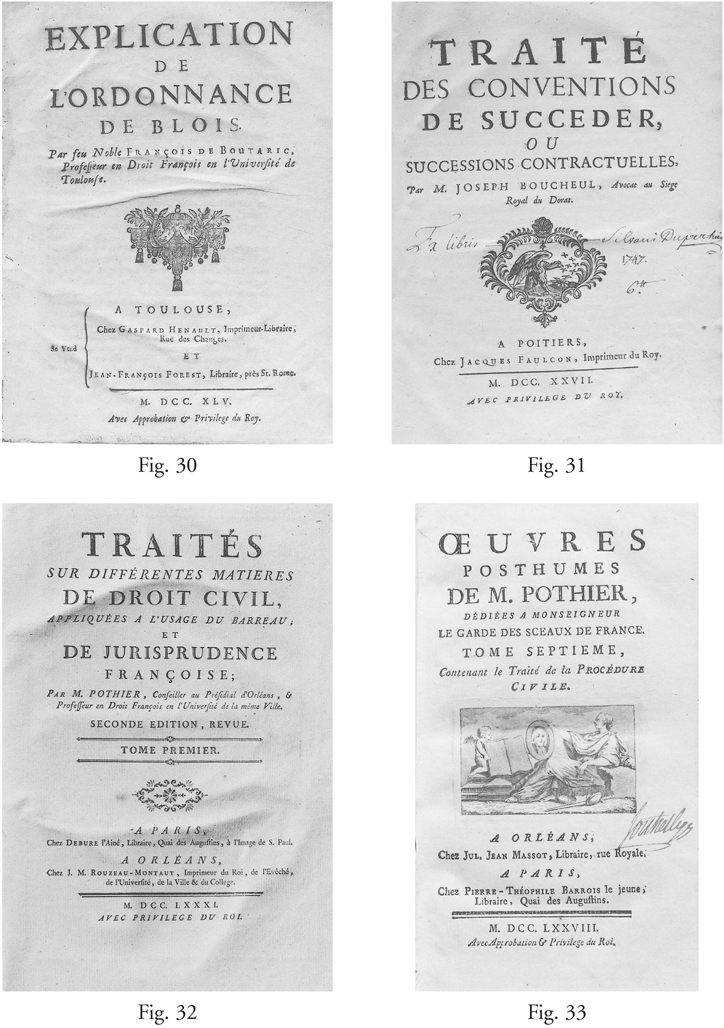
Fig. 30 à 33. La présence de professeurs ou de commentateurs estimés dans les villes universitaires ou judiciaires des provinces peut être une chance que saisissent les libraires locaux pour publier du droit. C’est le cas de François de Boutaric à Toulouse (qui est aussi publié à Nîmes), Joseph Boucheul à Poitiers ou Robert-Joseph Pothier à Orléans.
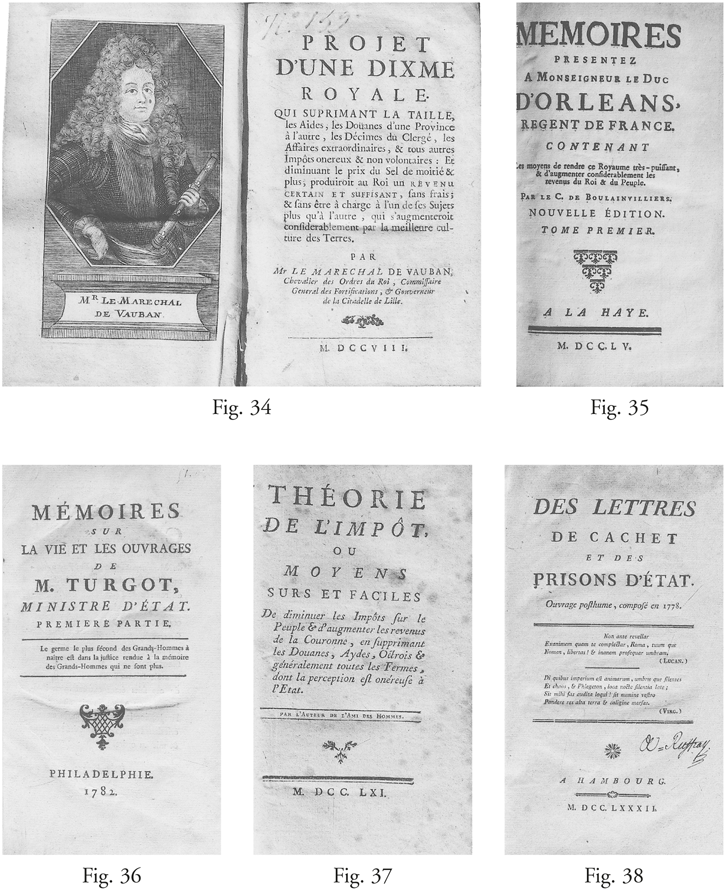
Si le pouvoir royal favorise volontiers les presses nationales en matière d’édition proprement juridique, il décourage souvent et soupçonne toujours les publications qui touchent au domaine politique ou économique. D’où la prudence des auteurs qui publient anonymement, de préférence à l’étranger, ou avec des mentions de lieu et d’éditeur absentes ou fictives.
C’est le cas pour le maréchal de Vauban (fig. 34), le comte de Boulainvilliers (fig. 35), Dupont de Nemours (fig. 36), le marquis de Mirabeau (fig. 37) ou son fils, le comte de Mirabeau (fig. 38).
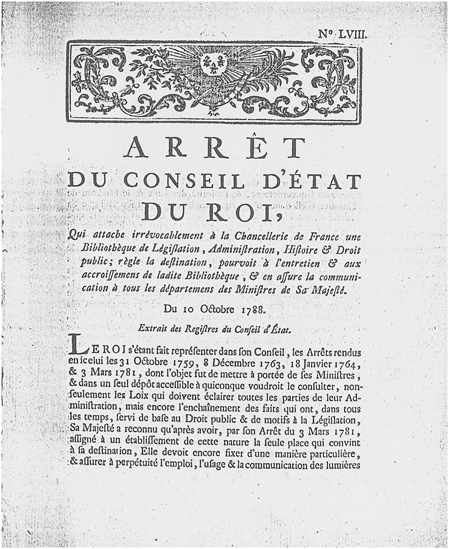
Fig. 39
Fig. 39. Arrêt du Conseil du Roi créant une bibliothèque de législation au sein de la Chancellerie ouverte à tous les membres des administrations royales, savants et jurisconsultes. Texte diffusé dans sa version imprimée à Lille par C. Péterinck-Cramé, imprimeur ordinaire du Roi, 1788.
Cette pièce de 4 feuillets est l’une des innombrables publications à caractère semi-officiel dont le pouvoir se servait pour informer les justiciables dans tous les domaines et qui, sous les noms de factums, mémoires, déclarations, arrêts, etc., fournissaient une pâture abondante aux presses locales.

Fig. 40
Fig. 40. Arrêt du 6 novembre 1688 concernant la charge d’arpenteur, pièce de 4 pages imprimée à Poitiers par Jean Fleuriau, imprimeur du roi et de l’évêque.

Fig. 41
Fig. 41. Tarif des bois et charbons de la ville de Paris établi par le prévôt des marchands en 1751, pièce de 4 pages imprimée par Pierre-Gilles Le Mercier, imprimeur ordinaire de la Ville de Paris.

Fig. 42
Fig. 42. Sentence du Châtelet de Paris contre un maître relieur ayant troublé l’office divin, pièce de 4 pages imprimée par Jean-Charles Desaint, imprimeur du Châtelet de Paris.

Fig. 43
Fig. 43. Un des nombreux mémoires judiciaires produits par Beaumarchais dans ses démêlés avec le sieur Kornmann, 81 p.
Fig. 40-43. Quatre exemples, parmi des millions, de pièces d’origine législative, réglementaire ou judiciaire.

Déjà utilisé à Rome pour désigner les compilations de constitutions impériales, le terme de Code se généralise au XVIIe siècle pour tendre désormais à désigner un ensemble de lois régissant une matière déterminée. Avant même d’être parfaitement intégré au vocabulaire juridique officiel, il est adopté par les praticiens et apparaît fréquemment sur les pièces de titre des reliures.
Fig. 44. Ordonnances de 1667 sur la procédure civile, édition originale portative in-16, Paris, chez les Libraires associés.
Fig. 45. Code pénal ou Recueil des principales ordonnances… sur les crimes et délits…, par M. D*** avocat, Paris, Nyon, 1777, in-12.
Fig. 46. Henriquez, Code des seigneurs haut-justiciers…, Paris, Nyon, 1780, in-12.
Fig. 47. Ordonnance de 1670 sur les matières criminelles, éd. originale in-4°, Paris, chez les Libraires associés.
Fig. 48. Code matrimonial, ou Recueil complet de toutes les loix canoniques et civiles… sur les questions de mariage, éd. A.-G. Camus, Paris, Hérissant fils, 1770, in-4°.
Fig. 49. Commentaire sur l’Ordonnance criminelle de 1670 par Serpillon, Lyon, Frères Périsse, 1767, 2 vol., 4°.

Fig. 50. Commentaire sur l’Ordonnance civile de 1667 par Serpillon, Paris, Delaguette, 1776, 4°.
Fig. 51. Pour la première fois, page de titre et pièce de titre s’accordent : Code civil des Français. Édition originale et seule officielle, Paris, Imprimerie de la République, an XII-1804, 4°.

Fig. 52
Fig. 52. La Justice couronnant le roi Louis XVI. En-tête ornant Les Loix criminelles.
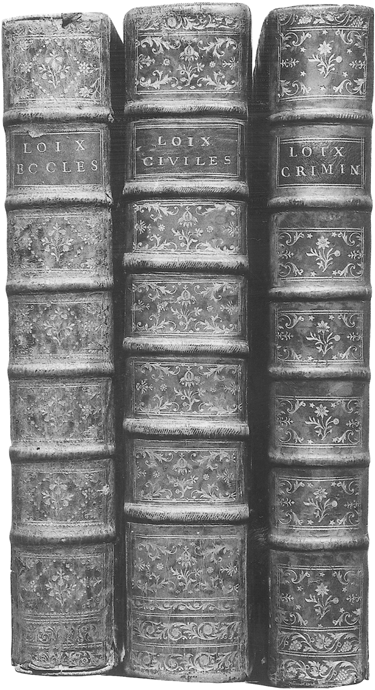
Fig. 53 à 55
Fig. 53 à 55. Une trilogie in-folio indispensable à la documentation de tout jurisconsulte de la fin de l’Ancien Régime : Les Loix… dans leur ordre naturel : ecclésiastiques par Louis de Héricourt, 1761, civiles par Jean Domat, 1777 et criminelles par P.-F. Muyart de Vouglans, 1780.
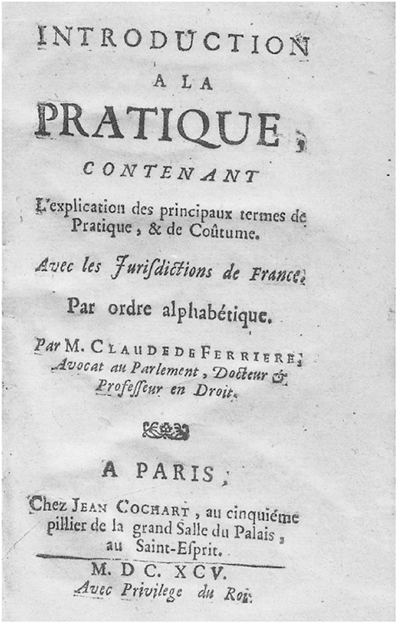
Fig. 56
Fig. 56. Petit manuel élémentaire de droit, l’Introduction à la pratique de Claude de Ferrière fut reprise et développée en 2 volumes in-4° sous le titre de Dictionnaire de droit et de pratique par son fils, Claude-Joseph de Ferrière, pour devenir un des usuels favoris des jurisconsultes. Cela lui valut, comme pour tout ouvrage à succès sous l’Ancien Régime, de nombreuses contrefaçons.
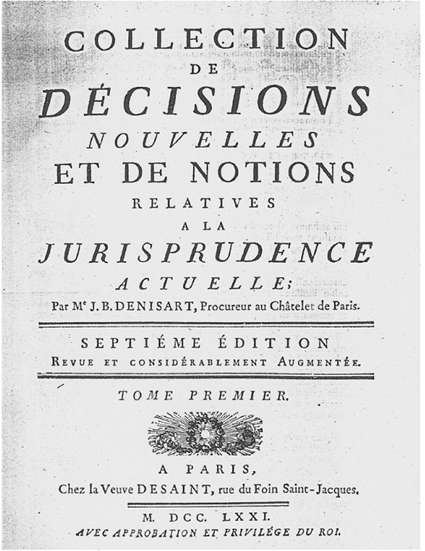
Fig. 57
Fig. 57. Un autre usuel estimé : les 4 volumes in-4° de la Jurisprudence de Jean-Baptiste Denisart.

Fig. 58

Fig. 59
Confrontation de deux éditions de Toulouse, Jean Dupleix, 1779 : celle autorisée (fig. 58), de 1713 pages, et sa contrefaçon (fig. 59), de 1448 pages.

Fig. 60. Feuille volante avertissant le public de l’existence d’une contrefaçon de la Collection de jurisprudence de J.-B. Denisart, et détaillant au verso les différences entre les deux éditions : 3296 pages en caractères de Philosophie pour l’édition autorisée, imprimée à Paris par J.-F. Chardon avec mention du privilège, 2852 pages en Petit Romain pour la contrefaçon sans mention de privilège et sans nom d’imprimeur.
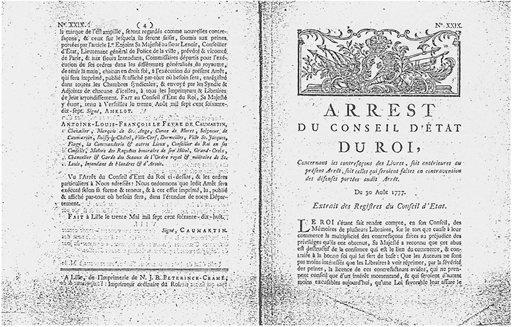
Fig. 61
Fig. 61. Pièce de 4 pages publiant le fameux arrêt du Conseil du 30 août 1777 relatif à la légitimation des contrefaçons en circulation dans le royaume, dont l’art. VII prévoit que « les possesseurs des contrefaçons antérieures au présent arrêt seront tenus de les représenter dans le délai de deux mois, à l’Inspecteur (…) pour être, la première page [de texte] estampillée …»
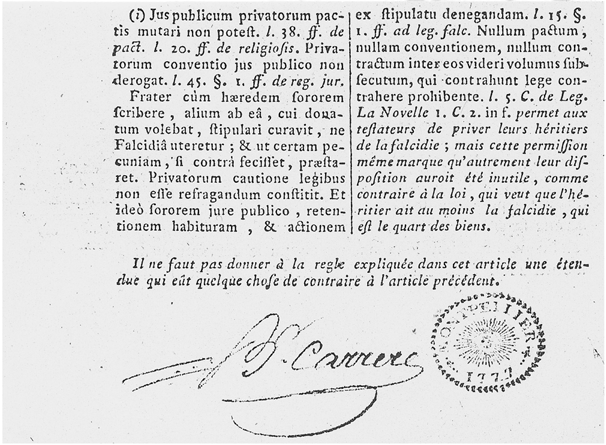
Fig. 62
Fig. 62. Reproduction de l’estampille et signature autographe de B. Carrère, inspecteur de la librairie à Montpellier, autorisant le commerce d’une contrefaçon des Loix civiles de J. Domat (éd. légitime, Paris, Durand, 1777).
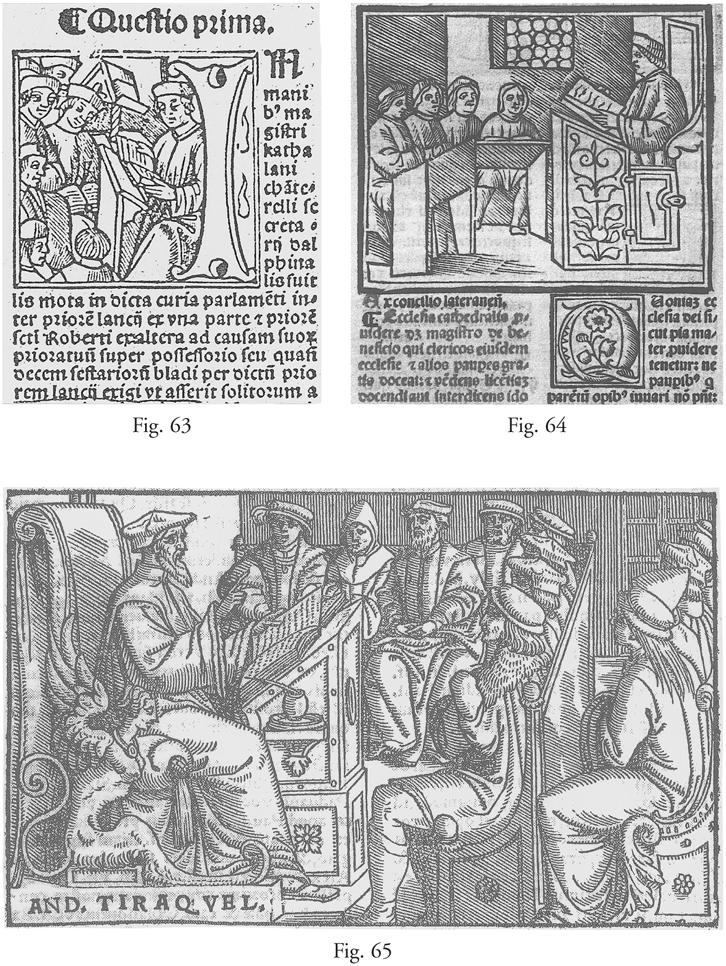
Fig. 63. Capitale ornée, en tête d’une édition des Décisions de Guy Pape imprimée à Lyon en 1520.
Fig. 64. Vignette sur deux colonnes, préfiguration du bandeau.
Fig. 65. En-tête donnant le portrait d’André Tiraqueau, sur une édition de De utroque retractatu… imprimée à Venise en 1554.
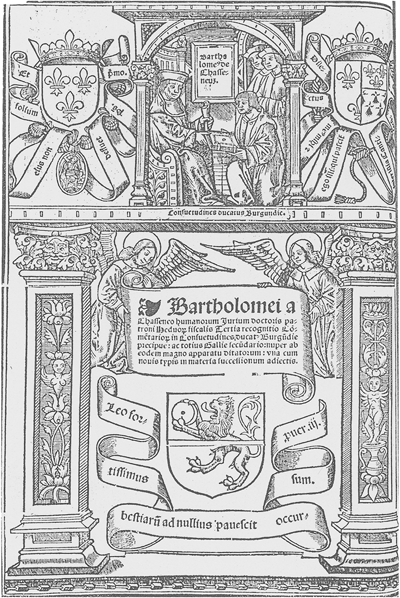
Fig. 66. L’offrande par l’auteur de son livre à quelque prince ou protecteur est également une image de convention issue des manuscrits, que les livres de droit reprennent, à l’exemple de ce Coutumier de Bourgogne commenté par Barthélemy de Chasseneuz et imprimé à Lyon pour Simon Vincent en 1528.

Fig. 67. Invention vénitienne, le titre-frontispice offre l’avantage de permettre, grâce à des images judicieusement choisies, de compléter l’information sur le contenu du livre donnée par le titre, en révélant aussi l’esprit qui l’anime. Le Grant Coustumier de Bourgogne, publié à Paris, chez François Regnault, en 1534, est ainsi placé à la fois sous les auspices de l’Empereur et sous celles de dix anciens notables jurisconsultes.
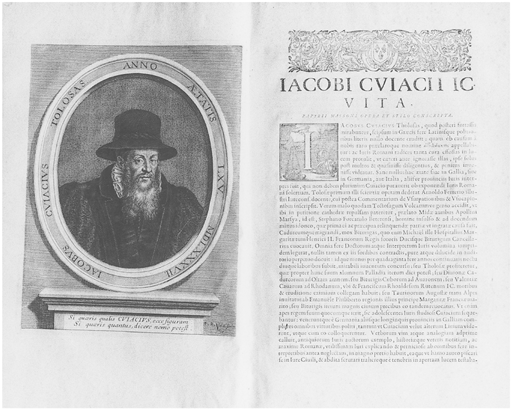
Fig. 68

Fig. 69
La figuration d’un auteur abstrait enseignant ou offrant son livre céda vite la place au portrait réaliste. Ceux des juristes, en frontispice de leurs œuvres, se comptent par dizaines. Ci-dessus Jacques Cujas (fig. 68) et Bertrand d’Argentré (fig. 69).
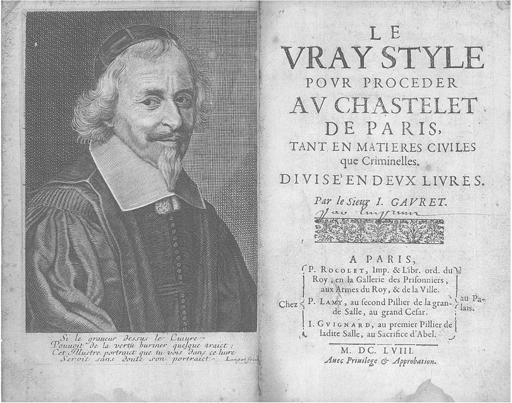
Fig. 70
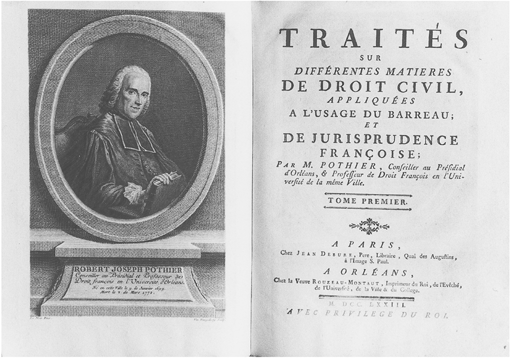
Fig. 71
Portraits de J. Gauret (fig. 70) et de R.-J. Pothier (fig. 71).
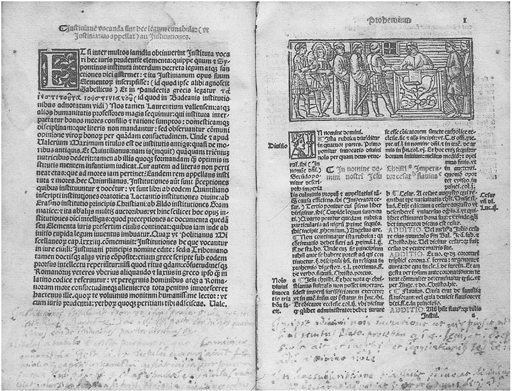
Fig. 72
Fig. 72. Les Institutes, imprimées à Venise en 1522, ornées de 22 vignettes.

Fig. 73
Fig. 73. Les Décrétales de Boniface VIII, éditées à Venise en 1514, ornées de 182 vignettes.
Quelques tentatives, principalement italiennes et souvent restées sans suite, sont faites au cours du XVIe siècle pour illustrer le corps du texte des livres de droit.

Le plus remarquable et le dernier des grands livres illustrés juridiques est la Pratique criminelle du Flamand Josse de Damhoudère, ornée d’une soixantaine de figures et qui connaît de très nombreuses éditions latines, allemandes, néerlandaises ou françaises au cours de la seconde moitié du XVIe siècle.
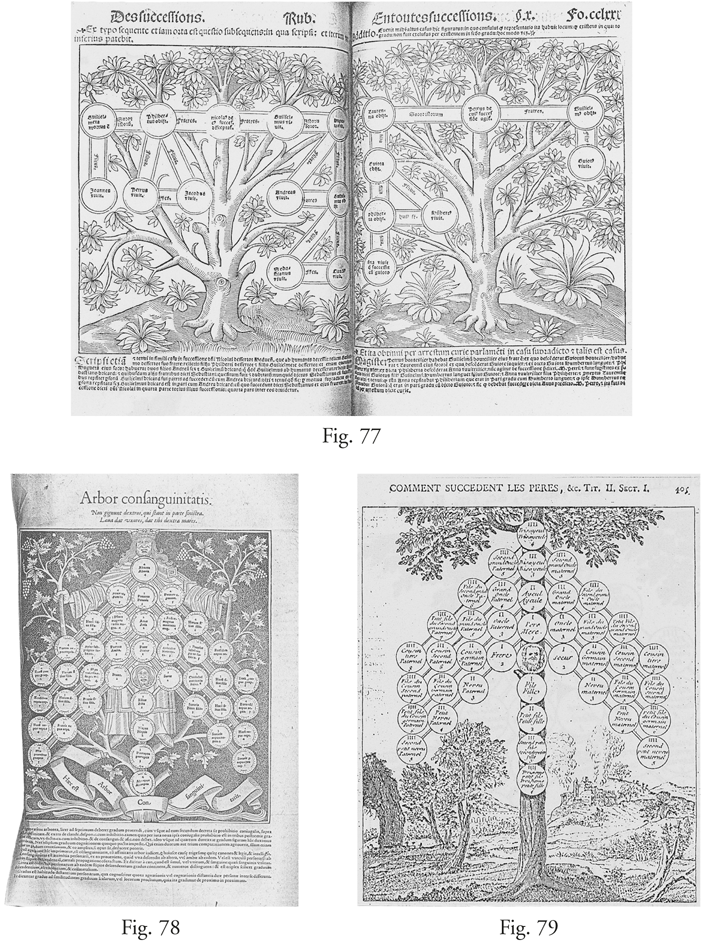
Fig. 77. Coutume de Bourgogne, imprimée à Lyon en 1528.
Fig. 78. Planche dépliante dans le Decretum Gratiani imprimé à Lyon en 1553.
Fig. 79. Les Loix civiles de Jean Domat, Paris, Nyon, 1777.
Seule échappe à la désaffection de l’illustration juridique la planche technique de l’arbre de parenté, qui peut permettre à la fantaisie des graveurs de se perpétuer jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.
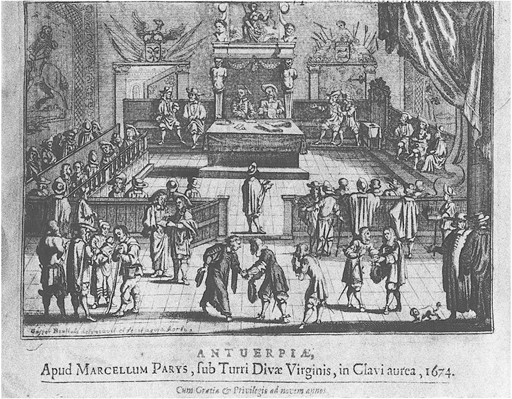
Fig. 80
Fig. 80. Cour de justice. Vignette de titre des Œuvres de J. et D. de Sande, Anvers, 1674.

Fig. 81
Fig. 81. La Cour de Parlement. Bandeau ornant la Harangue prononcée en l’honneur du parlement de Paris par Jacques de La Baune, 1685.
À défaut de programmes iconographiques développés, les éditeurs doivent se contenter d’orner les ouvrages juridiques de vignettes de titre ou de bandeaux, qui contraignent les graveurs à donner le plus à voir dans un minimum d’espace.

Fig. 82
Fig. 82. Une des neuf planches récréatives pour les Causes amusantes et connues, 1766.

Fig. 83
Fig. 83. Une des sept planches pédagogiques d’E.-A. David illustrant la Constitution de l’an VIII.
Sauf à aller vers les marges du droit, on ne trouve plus, après le XVIe siècle, d’ouvrage juridique pouvant entrer dans la catégorie des livres illustrés.

Fig. 84
Fig. 84. Titre-frontispice du Commentaire du Code par Henricus Zoesius, 1683.

Fig. 85
Fig. 85. Frontispice de L’Art de procéder en justice par Louis Lasseré, Paris, 1680.
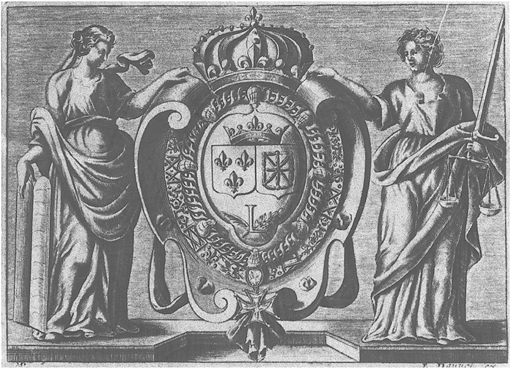
Fig. 86
Fig. 86. La Justice et la Loi tenant les armes royales, vignette de titre sur les Œuvres de Charles Loyseau ; la même sur celles de Julien Peleus, Paris, 1631.
Seule l’allégorie de la Justice échappe à l’ostracisme des juristes vis-à-vis de l’image. Les graveurs en profitent pour la décliner sous de nombreuses formes.

Fig. 87. Bandeau passe-partout des sept vertus cardinales et théologales, objet de multiples variantes, avec en tête la Justice, ici sur le Commentaire de la coutume de Bretagne par Bertrand d’Argentré, Paris, N. Buon, 1608. On le trouve aussi sur les Œuvres médicales d’André Du Laurens, Paris, A. Courbé, 1646.

Fig. 88. Une autre des nombreuses copies du même bandeau sur les Œuvres de Jean Bacquet, Paris, G. de Luynes, 1688.
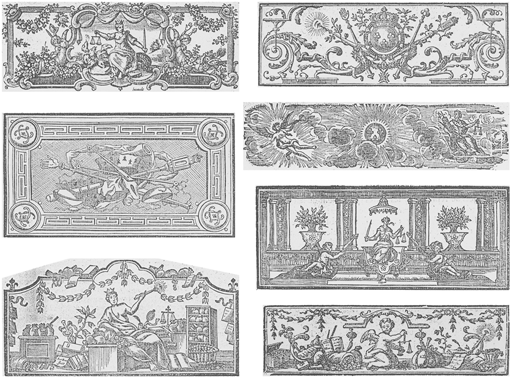
Fig. 89-95. Quelques exemples des innombrables bandeaux qui symbolisent la Justice, ornant au XVIIIe siècle les factums, lois et pièces judiciaires diverses.
____________
1 Nous n’utiliserons, pour simplifier, que le terme général d’« éditeur » sans entrer dans le détail de la distinction, sans objet pour notre propos immédiat, quoique importante pour l’histoire de l’édition en général, entre : imprimeur, simple sous-traitant d’un éditeur ; imprimeur-libraire, qui imprime et vend ; éditeur qui n’imprime pas ; libraire qui n’imprime ni n’édite ; libraire-éditeur qui édite et vend, soit directement soit par l’intermédiaire des libraires, etc.
2 En témoigne suffisamment l’indispensable guide de Louise-Noëlle Malclès, Les Sources du travail bibliographique, Genève, Droz, 1950, 3 vol., et, bien entendu, de multiples « bibliographies de bibliographies ».
3 Si l’on excepte le Catalogue des livres de la bibliothèque publique, fondée par M. Prousteau, professeur en droit dans l’université d’Orléans, paru en 1777, et le Catalogue des livres de la bibliothèque de MM. les avocats au parlement de Paris, rédigé en 1787, fonds qui furent également ceux dans lesquels Camus puisa la matière de son travail. Armand-Gaston Camus, Lettres sur la profession d’avocat et bibliothèque choisie, Paris, 1772, et nouvelles éditions de 1777, 1805 et 1818 ; 5e éd. revue et augmentée par André-Marie-J.-J. Dupin, Paris, Gobelet et Warée, 1832, 2 vol.: Profession d’avocat. I. Recueil de pièces concernant cette profession. II. Bibliothèque choisie des livres de droit qu’il est le plus utile d’acquérir et de connaître.
4 Jacques-Charles Brunet, auteur du célèbre Manuel du libraire et de l’amateur de livres…, 5e éd., Paris, 1860-1865, 6 vol., qui recense près de 40 000 livres méritant par leur ancienneté, leur rareté ou quelque particularité, d’être connus, ouvrage auquel se joint un supplément, donné par Pierre Deschamps, constitué d’une liste des lieux d’édition avec l’histoire des débuts de l’imprimerie dans chacun d’eux : Dictionnaire de géographie ancienne et moderne à l’usage du libraire et de l’amateur de livres, Paris, 1870. Quoique cette bibliographie générale ait un objet tout différent de celle de Camus et Dupin, elle peut la compléter utilement car son sixième volume, qui classe les livres par grandes divisions, comprend, col. 103-170, un chapitre Jurisprudence.
5 Aimable-Auguste Grandin, Bibliographie générale des sciences juridiques, politiques, économiques et sociales de 1800 à 1926, Paris, Sirey, 1926, 3 vol., dont un de tables, et 19 vol. de suppléments annuels pour les travaux de 1926 à 1950.
6 Notamment celle consacrée au notariat : Albert Amiaud, Recherches bibliographiques sur le notariat français, Paris, Larose, 1881 (tirée à seulement 330 exemplaires sur grand papier). Comme celle de Camus et Dupin, elle poursuit un but qui n’est pas proprement bibliographique, celui de promouvoir l’image de la profession de notaire. Aussi l’auteur dresse-t-il d’abord dans une première partie « la liste de tous les notaires qui, par leurs publications de quelque nature qu’elles fussent, littéraires, scientifiques ou juridiques, ont honoré la profession », avant, dans une seconde partie, de classer par ordre chronologique « tous les ouvrages spécialement relatifs au notariat, mais écrits par des auteurs anonymes ou étrangers à l’institution ». Destinée à fournir aux historiens du droit les instruments de base nécessaires à leurs recherches, mais sans utilité directe pour la connaissance des livres anciens, citons encore l’Introduction bibliographique à l’histoire du droit et à l’ethnologie juridique publiée sous la direction de John Gilissen, C/I, France (avant 1789), Bruxelles, éd. de l’Institut de sociologie, université de Bruxelles, 1967.
7 Bibliographie des coutumes de France. Éditions antérieures à la Révolution, Genève, Droz, 1975.
8 Brunet en dressait indirectement le constat il y a plus d’un siècle en faisant un sort expéditif à la classe des livres de droit : « Dans l’ancienne jurisprudence, nous ne trouvons guère à citer, comme livres fort recherchés aujourd’hui, que les parties du corps de droit romain et du corps de droit canonique qui sont sorties des presses de Fust et Schoeffer de 1460 à 1470 ; ensuite les premières coutumes de nos provinces et quelques coutumes étrangères, imprimées à la fin du XVe siècle et au commencement du XVIe » (ouvr. cit., pp. X-XI). De son côté, Alexandre Cioranescu, auteur d’une Bibliographie de la littérature française du seizième siècle (Paris, 1959, et Genève, Slatkine, 1975), qui n’omet point de dresser la longue liste des œuvres des principaux jurisconsultes, ne trouve, dans ses copieuses généralités liminaires, aucun travail concernant la littérature juridique digne d’être cité, ni au chapitre des divers domaines de la pensée, ni à ceux de l’enseignement, des sources d’inspiration ou des thèmes. Même le récent Manuel de bibliophilie du libraire Christian Galantaris (Paris, 1997, 2 vol.), ignore carrément la rubrique « droit et jurisprudence » dans l’inventaire qu’il dresse des principales matières ayant suscité l’intérêt des bibliophiles. Le monde clos de la bibliophilie offre de surcroît un étonnant contre-exemple, celui d’Henri Béraldi qui conseille à ses pairs une recette infaillible pour se débarasser d’un « profane avide de savoir ce que sont ces fameux livres dont il a tant entendu parler », qui tente d’entrer dans leur sanctuaire : le « coup des Pandectes ». « Il présentait à la victime un exemplaire du Corpus juris civilis, spécialement réservé à cet usage. Poids, dix kilos ; encombrant et sans aucun charme. L’infortuné commence à feuilleter, ne comprend pas, admire du bout des lèvres, murmure « oui c’est beau ! Ah que c’est beau ! » se tortille sur la chaise, prend l’apparence d’un homme qui ressent les premières atteintes d’un emprisonnement, se lève, salue et fuit. La Victoire est à nous ! » (Bibliothèque d’un amateur, Lille, 1885, p. 15 ; cité par Galantaris, ouvr. cit., t. I, pp. 138-139).
9 Sauf à citer cette approche singulière de la bibliophilie juridique qui fut celle du père d’André Gide : « Au milieu de la pièce, une énorme table couverte de livres et de papiers. Mon père allait chercher un gros livre, quelque Coutume de Bourgogne ou de Normandie, pesant in-folio qu’il ouvrait sur les bras d’un fauteuil pour épier avec moi, de feuille en feuille, jusqu’où persévérait le travail d’un insecte rongeur. Le juriste, en consultant un vieux texte, avait admiré ces petites galeries clandestines et s’était dit : « Tiens ! cela amusera mon enfant ! » Et cela m’amusait beaucoup à cause aussi de l’amusement qu’il paraissait lui-même y prendre » (Si le grain ne meurt, chap. 1, p. 13). Ce texte avait échappé à notre sagacité, mais pas à celle de Jean-Dominique Mellot que nous remercions de nous l’avoir signalé. Mais nous ne sommes pas certain toutefois qu’il contredise pleinement notre assertion première.
10 Jean-Baptiste Brissaud, Cours d’histoire générale du droit français public et privé… (Sources. Droit public. Droit privé), Paris, Albert Fontemoing, 1904, 2 vol. Les 416 premières pages de cet ouvrage sont consacrées aux sources, répertoriant et replaçant dans leur contexte intellectuel environ mille cinq cents auteurs, dont un grand nombre de romanistes ignorés de Camus et Dupin. Malheureusement il ne donne quasiment aucun détail biographique sur les auteurs cités, lacune qui peut être partiellement comblée par la consultation du tout aussi utile Répertoire des sources historiques du Moyen Âge. Bio-bibliographie d’Ulysse Chevalier, nouv. éd., Paris, Picard, 1905, 2 vol.
11 Ce que constate Michel Reulos en conclusion d’une communication : « L’édition juridique a constitué une spécialité essentielle qui n’a pas fait l’objet d’études assez approfondies » (« Les droits savants dans l’édition française du XVIe siècle », Le Livre dans l’Europe de la Renaissance. Actes du XXVIIIe colloque international d’études humanistes de Tours, Paris, Promodis, 1988, p. 331).
12 En tout premier lieu sur l’œuvre d’Henri-Jean Martin, archiviste paléographe qui a commencé une longue et prestigieuse carrière au service du livre comme conservateur à la Bibliothèque nationale. Ses principales contributions dispersées ont été compilées dans Le Livre français sous l’Ancien Régime, Paris, Promodis, 1987. On y trouve ici et là, ainsi que dans sa thèse Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), Genève, Droz, 1969, 2 vol., de nombreux aperçus sur les livres juridiques dont nous avons fait largement notre profit.
13 C’est à ce laborieux exercice que se sont livrés Dominique Coq et Ezio Ornato, « La production et le marché des incunables. Le cas des livres juridiques », dans Le Livre dans l’Europe de la Renaissance…, ouvr. cit., pp. 304-322. Leurs conclusions, auxquelles nous nous référons, reposent sur le recensement de douze cents éditions de traités juridiques en langue latine dont on connaît la localisation de dix-neuf mille exemplaires subsistants.
14 Phénomène de concentration qui se prolonge à l’intérieur de ce centre, l’imprimeur Battista de Tortis assurant à lui seul le tiers des éditions juridiques vénitiennes.
15 Le cadre de cet essai ne permet pas d’entrer dans le détail. Outre un phénomène de saturation naturel, la crise de l’activité éditoriale observée dans les années 1480 tient aussi aux grandes épidémies de peste qui bloquent les investissements, dégarnissent les ateliers, déciment la clientèle et approvisionnent le marché de l’occasion.
16 Voir sa notice et les références bibliographiques complémentaires dans le « Dictionnaire des imprimeurs et libraires lyonnais du XVe siècle » publié par la Revue française d’histoire du livre, 2003, nos 118-121, pp. 209-262, ill., notice n° 87.
17 René Fédou, Les Hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge. Étude sur les origines de la classe de robe, thèse de lettres, Annales de l’université de Lyon, 1964, pp. 323-325, d’après Charles Perrat, « Barthélemy Buyer et les débuts de l’imprimerie à Lyon », dans Humanisme et Renaissance, 1935, pp. 103-121 et 349-387. Sur le phénomène Buyer et les gros marchands qui investissent dans l’édition, voir aussi : Henri et J. Baudrier, Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres de Lyon au XVIe siècle, Lyon, 1895-1921 (et réimpr., Genève, Slatkine, 1999), t. XI, pp. 166-167. Voir les références complémentaires dans le « Dictionnaire des imprimeurs et libraires lyonnais du XVe siècle », art. cit.
18 M. Reulos, « Les droits savants dans l’édition française du XVIe siècle », art. cit.
19 Digestum est un mot latin qui signifie « ce qui est classé méthodiquement », Pandectæ un mot grec qui désigne « ce qui comprend tout ».
20 D’où le nom de « facultés de décret » donné aux facultés de droit canonique où cette collection formait la base de l’enseignement. Notons au passage que l’enseignement du droit pouvait porter sur les deux droits, mais aussi, dans certaines universités, notamment à Paris, sur le seul droit canonique.
21 Sur le détail de la genèse des Corpus juris canonici et Corpus juris civilis, voir les excellents développements aux mots susdits dans le Dictionnaire de droit canonique paru sous la direction de R. Naz, Paris, Letouzey et Ané, t. IV, 1949.
22 On peut s’interroger sur les qualifications données par les glossateurs aux trois parties du Digeste, notamment à la deuxième partie qui porte le curieux nom d’Infortiat. Son origine reste énigmatique. Du Cange estime qu’il n’était pas usité avant l’an 1000. Le Dictionnaire de l’Académie française (1re éd., 1694) l’ignore, Furetière (1690) cite sans conviction deux ou trois étymologies fantaisistes, le Dictionnaire français et latin de Trévoux recopie Furetière. Littré, qui tente de faire le point sur la question, le fait dériver du mot « force » et lui donne le sens de « renforcé ». Tout en reconnaissant qu’on est sans renseignement direct sur son étymologie, il rapporte la conjecture de Friedrich Carl von Savigny selon laquelle les glossateurs, n’ayant d’abord retrouvé que le commencement du Digeste, puis sa fin, les qualifièrent respectivement de vetus et de novum. La partie intermédiaire, enfin retrouvée, fut appelée Infortiat ou « Digeste renforcé ».
23 Du moins après l’abandon du gothique car de nombreuses éditions françaises, en cela fort en retard sur les italiennes, furent entièrement imprimées en lettres gothiques au cours des deux premières décennies du XVIe siècle et même bien au-delà. On trouve par exemple des coutumiers bretons gothiques jusqu’en 1546 !
24 J.-C. Brunet, Manuel du libraire…, ouvr. cit., t. III, 607-608. Imprimée en 1575-1576 par Henri Thierry et Olivier de Harsy en beaux caractères à deux colonnes principales de texte et quatre colonnes de gloses, elle dépasse les 5000 pages in-folio.
25 H. et J. Baudrier, Bibliographie lyonnaise, ouvr. cit., t. XI, 90. Voir les références complémentaires dans le « Dictionnaire des imprimeurs et libraires lyonnais du XVe siècle », art. cit.
26 Ce qui va suivre sur cette question est issu pour l’essentiel de Jeanne-Marie Dureau-Lapeyssonnie, « Recherches sur les grandes compagnies de libraires lyonnais au XVIe siècle », dans Nouvelles Études lyonnaises, Genève, Droz, 1969, pp. 5-69, et complété par des indications, hélas dispersées, fournies par la Bibliographie lyonnaise de Baudrier. Cette dernière bibliographie en effet, restée inachevée, ne contient pas la rubrique spéciale consacrée à la Compagnie des libraires, pourtant annoncée. Elle se contente de citer ces éditions collectives à l’occasion de chaque impression concernée. Par exemple le Corpus juris civilis imprimé par Jacques I Mareschal en cinq volumes in-folio est signalé comme étant « pour le compte de la première Compagnie des libraires de Lyon ».
27 Baudrier, Bibliographie lyonnaise, ouvr. cit., t. IX, 21-22.
28 Sur la pratique des éditions collectives « au profit de la communauté » à Rouen, voir Jean-Dominique Mellot, L’Édition rouennaise et ses marchés (vers 1600-vers 1730) : dynamisme provincial et centralisme parisien, Paris, École nationale des chartes (diffusion Paris, Champion ; Genève, Droz), 1998, p. 95. Se rattachant à la technique des éditions collectives il faut signaler encore la pratique de la sous-traitance. L’activité des imprimeurs lyonnais les amenait également à collaborer avec divers éditeurs du royaume. En 1512, Jean de La Place imprime une édition des ordonnances royales de Louis XII pour le compte de Jean de Clauso, libraire à Toulouse (à l’adresse de Toulouse, mais en réalité à Lyon) ; Jacques Mareschal imprime en 1523 une autre édition des ordonnances royales à l’adresse de Clermont (ce qui a pu la faire passer pour le premier livre imprimé en ce lieu) ; le même J. Mareschal imprimant également pour Jean Petit, grand éditeur parisien, et ses associés, de nombreux ouvrages de jurisprudence, dont en 1521 un volumineux commentaire gothique des Décrétales en neuf volumes in-folio, etc., (cf. Baudrier, Bibliographie lyonnaise, ouvr. cit., t. I, 375-376).
29 Baudrier, Bibliographie lyonnaise, ouvr. cit., t. VII, 263.
30 Ibid., IX, pp. 185, 335 et 381. Un bel exemple de cet ouvrage, relié plein vélin, est photographié dans le catalogue de la Librairie historique Clavreuil, n° 344, décembre 2000, p. 13.
31 Brigitte Moreau, Inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVIe siècle d’après les manuscrits de Philippe Renouard, Paris, Service des travaux historiques de la Ville de Paris, t. III, 1985, pp. 337-338, n° 1176-1181.
32 Roger Doucet, Les Bibliothèques parisiennes au XVIe siècle, Paris, Picard, 1956.
33 Albert Labarre, Le Livre dans la vie amiénoise du seizième siècle. L’enseignement des inventaires après décès, 1503-1576, Paris et Louvain, Nauwelaerts, 1971.
34 Pierre Aquilon, « Quatre avocats angevins dans leurs librairies (1586-1592) », Le Livre dans l’Europe de la Renaissance…, ouvr. cit., pp. 502-512.
35 À Lyon, la librairie est avant tout une affaire de grands marchands qui exploitent ce secteur comme tout autre secteur commercial et mettent au mieux à profit à la fois le caractère universel des textes romains et canoniques et leur position géographico-économique au confluent des mondes germanique et latin. À Paris, l’atout des libraires est la présence sur place du pouvoir politique et judiciaire, qui encourage leur prospérité, au détriment s’il le faut des presses provinciales. À Rouen l’édition est tenue par des artisans locaux qui ne peuvent espérer rivaliser avec succès avec les précédents et qui vont en conséquence viser surtout des secteurs ignorés ou peu cultivés par les Lyonnais et les Parisiens. Voir J.-D. Mellot, L’Édition rouennaise…, ouvr. cit., pp. 30 et 125.
36 Visant à l’exhaustivité, cet ambitieux travail a, par la force des choses, ignoré l’existence d’un certain nombre d’éditions. Tel qu’il est, et dans l’attente d’une éventuelle seconde édition revue et complétée, il rend néanmoins d’immenses services, ses lacunes n’étant pas de nature à modifier sensiblement les constatations qu’ils nous a permis de tirer de sa consultation. Certaines études publiées depuis sa parution peuvent à l’occasion le compléter. Voir par exemple, pour l’Aquitaine : Gérard D. Guyon, « Les textes de la coutume de Bordeaux et leurs éditions », dans Revue française d’histoire du livre, 19, 1978, pp. 399-414 ; pour les Pyrénées : François Pic, « Le droit pyrénéen en occitan. Bibliographie des impressions (1552-fin XVIIIe s.) », dans Recherches pyrénéennes, Bulletin, n° 3, 1982, pp. 125-227.
37 Communes jusqu’en 1508.
38 André Gouron, « Coutumes et commentateurs : essai d’analyse quantitative », dans Droit privé et institutions régionales. Études historiques offertes à Jean Imbert, Paris, Presses universitaires de France, 1976, pp. 321-332.
39 La Bibliothèque nationale de France à elle seule possède, pour la période 1598-1643, quelque 500 000 impressions différentes de cette espèce (pièces à caractère administratif ou juridique). Cf. H.-J. Martin, Livre, pouvoirs et société…, ouvr. cit., t. I, p. 258. Sur l’importance, pour les éditeurs provinciaux, tant de l’impression des textes coutumiers que des multiples pièces émanées de l’autorité voir : Louis Desgraves, Le Livre en Aquitaine XVe-XVIIIe siècles, [s. l.,] Atlantica, Centre régional des lettres d’Aquitaine, 1998, pp. 151-153 et 109-111. L’auteur cite, entre autres, le cas du Bordelais Michel Racle qui, en 1775, imprime avis, ordonnances et certificats, souvent par milliers, avec un total de plus de trente mille exemplaires.
40 A.-G. Camus reprit la collection sous l’Empire et publia le quinzième volume en 1811. Elle se conclut en 1847 avec le vingt-troisième volume. Elle avait traversé la Révolution et mis cent vingt-cinq ans pour s’achever.
41 A.-G. Camus, A.-M. Dupin, Bibliothèque choisie des livres de droit…, ouvr. cit., 1301.
42 Avertissement sur la troisième édition, p. V.
43 Causes amusantes et connues, Berlin [i. e. Paris, Estienne], 1769-1770, 2 vol. in-12, avec 9 figures hors texte non signées. Publiées anonymement, ces causes ont pour auteur, selon A.-G. Camus et A.-M. Dupin, l’avocat Louis-Théodore Hérissant.
44 J.-C. Brunet, Manuel du libraire…, ouvr. cit., 5e éd., t. III, 1483, et Avenir Tchémerzine, Bibliographie d’éditions originales et rares d’auteurs français…, Paris, 1927-1934, 10 vol., t. IV, p. 583. Un autre auteur à la plume facétieuse, Guillaume Coquillart, avait déjà eu l’idée de rapprocher galanterie et justice avec son Plaidoié d’entre la simple et la rusée.
45 Jean-Marie Augustin, « Justice et patois au XVe siècle : la Gente Poitevinrie », Journées régionales d’histoire de la justice, Poitiers 13, 14 et 15 novembre 1997, Paris, Presses universitaires de France, 1999, pp. 209-222. La première édition s’intitule plaisamment : La Gente Poitevinrie Tout de nouvea Racoutrie, Ou Talebot bain, et beau, Fat raiponse à Robinea. Lisez sou bain y ve prie, Pre vous railly do sotrye, De beacot de Chiquanours Quyi fasant de moichan tours. Aveque le Preces de Jorget et de son Vesin… Sur les différentes éditions de cette facétie, voir A. de La Bouralière, Bibliographie poitevine ou Dictionnaire des ouvrages poitevins et des ouvrages publiés sur le Poitou jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, Poitiers, 1908, pp. 255-256.
46 Au moment où nous apportons les premières corrections à cet article, le catalogue des nouveautés des éditions H. Champion-Slatkine pour le premier trimestre 2002 nous apprend la sortie du travail de Christian Biet, Droit et littérature sous l’Ancien Régime, parution qui contribue à combler un champ de recherche jusqu’ici trop négligé.
47 Voir A.-M. Dupin, De la jurisprudence des arrêts, à l’usage de ceux qui les font, et de ceux qui les citent, Paris, Baudouin frères, 1822, section VI, « Ancienneté et multiplicité des compilations d’arrêts », pp. 74-80 ; lequel auteur avoue avoir été fortement tenté de prendre à son compte la coquille du prote qui, au lieu d’« arrestographe », avait composé « arrestophage ».
48 Nous ne résistons pas au plaisir de citer ici le fameux exergue que l’orgueilleux Dumoulin inscrivait en tête de ses consultations : « Ego qui nemini cedo et a nemine doceri possum » (= Moi qui ne le cède à personne et à qui personne ne peut rien apprendre).
49 D’après Jean-Antoine Dellac, Biographie universelle ancienne et moderne, Paris, Desplaces, t. XXIII, 1854, p. 349.
50 Ce qui ne contredit en rien notre assertion liminaire selon laquelle les juristes furent de piètres bibliographes, puisque Naudé n’appartenait pas à ce corps mais à celui des médecins.
51 Nous évoquerons les boutiques du Palais au paragraphe suivant. Sur cette planche fameuse, voir Jeanne Duportal, Étude sur les livres à figures édités en France de 1601 à 1660, Paris, H. Champion, 1914, pp. 48-50. Notons qu’elle a été judicieusement choisie par l’éditeur de l’Histoire de l’édition française, 1re éd., Paris, Promodis, 1982, pour servir de jaquette à son tome I.
52 J.-B. Brissaud, Cours d’histoire générale du droit français public et privé…, ouvr. cit., t. I, p. 405.
53 Cité par Robert Darnton, L’Aventure de l’Encyclopédie, 1775-1800. Un best-seller au siècle des Lumières, Paris, Libr. académique Perrin, 1982, p. 28.
54 Voir par exemple sur cette question des presses étrangères éditrices de la pensée française : Albert Menzel dit Flocon, L’Univers des livres. Étude historique, des origines à la fin du XVIIIe s., Paris, Hermann, 1961.
55 On a souvent confondu cette contrefaçon, qui présente la même page de titre et comporte la même pagination, avec l’édition originale. Elle s’en distingue néanmoins au premier coup d’œil par un détail. Le nom du libraire Jacques Barrillot est orthographié avec deux « r » dans l’édition originale de Genève, avec un seul « r » dans la contrefaçon parisienne de Prault.
56 La troisième édition de Camus, publiée avant que Dupin l’ait augmentée des auteurs postérieurs à la Révolution, contenait 1753 articles, chiffre confirmé en gros par la « Liste des anciens jurisconsultes » donnée par J.-B. Brissaud dans son Cours d’histoire générale du droit français public et privé…, ouvr. cité, II, pp. 1801-1817.
57 Jean-Dominique Mellot a établi pour le XVIIe siècle de précieuses statistiques qui permettent, pour Rouen et Paris, de connaître la proportion respective des livres entre droit et autres disciplines. Sans entrer dans le détail par périodes, on peut retenir que ce pourcentage, qui se situe entre 5 et 8%, ne diffère pas sensiblement entre les deux villes, la divergence la plus marquée se situant dans d’autres domaines (Paris domine en matière de sciences religieuses et d’histoire, Rouen en matière littéraire). Toutefois, à partir de 1670, Rouen tend à dépasser Paris pour le droit, et au début du XVIIIe siècle les impressions juridiques y atteignent près de 10%. Une autre étude réalisée par Jean Quéniart pour le XVIIIe siècle nous indique pouvoir atteindre à certaines périodes 20% des titres produits avec même une pointe à 30% pour les années 1740-1750, ce qui est considérable. J.-D. Mellot, L’Édition rouennaise et ses marchés…, ouvr. cit., statistiques aux pp. 131-132 et 314-315 et « Nouveaux enjeux du droit », p. 559 ; J. Quéniart, L’Imprimerie et la librairie à Rouen au XVIIIe siècle, Paris, Klincksieck, 1969, pp. 125 et suiv.
58 Dans le livre second, à l’Inventaire de Mythophilacte. L’énigmatique allusion aux « Heures à la chancellière » évoque un livre d’Heures offert à la femme de Pierre Séguier, par la corporation des relieurs, pour se rendre le chancelier favorable. Elle nous donne l’occasion d’évoquer la figure de ce grand magistrat bibliophile, qui présida à la rédaction des célèbres ordonnances de 1669 et 1670 réformant la justice civile et criminelle, fut aussi l’un des principaux créateurs de l’Académie française et possédait l’une des plus importantes bibliothèques de l’époque, largement ouverte aux chercheurs (un tel exemplaire d’hommage, un superbe Coutumier des pays, comté et bailliage du Grand-Perche, imprimé sur vélin à Paris par Jean Dallier, 1558, avec toutes les lettrines et bandeaux peints, dans une riche reliure ornée d’entrelacs mosaïqués et frappée à ses armes, a été vendu aux enchères à Alençon le 29 septembre 2001 et préempté par le musée municipal du Château-Saint-Jean de Nogent-le-Rotrou). Un autre grand magistrat du siècle précédent, Jacques-Auguste de Thou, président à mortier au parlement de Paris, qui avait réuni la plus belle collection de livres de son époque, poussait le goût de la bibliophilie jusqu’à faire imprimer sur papier spécial deux ou trois exemplaires de tous les bons livres qui paraissaient et les faisait généralement relier en maroquin rouge à ses armes.
59 La question de la diffusion des livres de droit relativement aux autres domaines aurait besoin, pour être creusée, qu’on possédât davantage d’inventaires des stocks de libraires. Voir en ce sens par exemple : H.-J. Martin, M. Lecocq, Livres et lecteurs à Grenoble. Les registres du libraire Nicolas (1645-1668), Genève, Droz, 1977, 2 vol., ou bien Suzanne Tucoo-Chala, Charles-Joseph Panckoucke et la librairie française 1736-1798, Pau, Marimpouey jeune ; Paris, Touzot, 1977, où sont détaillés non seulement les éditions et diffusions propres de Panckoucke mais aussi les fonds des divers libraires qu’il racheta.
60 Pour être complet, précisons que ce phénomène d’édition « régionaliste » s’applique aussi aux ouvrages médicaux, le Midi produisant autant de médecins locaux notables que de juristes. Cf. Madeleine Ventre, L’Imprimerie et la librairie en Languedoc au dernier siècle de l’Ancien Régime, Paris, La Haye, Mouton et Cie, 1958, pp. 245 et suiv.
61 Quoique théoriquement possible pour le XVe siècle, l’attrait bibliophilique des incunables en ayant depuis longtemps permis et continuant toujours à en permettre le plus large recensement, et aussi en bonne partie pour le XVIe siècle grâce principalement, pour Paris, aux travaux manuscrits et imprimés de Philippe Renouard ; pour Lyon, aux travaux d’H. Baudrier et de Sybille von Gültlingen ; pour les autres centres, à la série, par villes, constituée par le Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au seizième siècle, entreprise par Louis Desgraves en 1968 et qui a donné lieu à ce jour à une trentaine de fascicules.
62 J.-D. Mellot, L’Édition rouennaise et ses marchés…, ouvr. cit., pp. 63 et suiv.
63 Voir plus haut à propos de l’estampe d’Abraham Bosse La Galerie du Palais. Notons qu’une pièce de Pierre Corneille, intitulée aussi La Galerie du Palais, se déroule dans ce cadre. Une figure de l’édition de 1664 (Rouen et Paris, Louis Billaine, au Palais, au second pilier de la Grand’Salle, à la Palme & au Grand César, t. I, 278) montre Dorimant, dédaignant les séries d’in-folio qui garnissent les rayons du libraire et faisant mine de se faire conseiller un livre à la mode pour garder un œil sur une belle inconnue qui choisit des dentelles à la boutique de lingerie d’en face.
64 Annie Charon-Parent, « Aspects de la politique éditoriale de Galliot Du Pré », Le Livre dans l’Europe de la Renaissance…, ouvr. cit., pp. 209-218. Toutes matières confondues, Du Pré publia 330 titres dont 42% de droit, 19% de littérature, 20% d’histoire, 9% de traductions classiques, 6% de religion et 4% de géographie et de sciences.
Les catalogues de libraires, parfois donnés en tête ou en fin d’ouvrage, peuvent également constituer une intéressante source de documentation. Celui des libraires et éditeurs Michel Guignard et Claude Robustel, publié en 1713 en tête de leur édition du Journal du Palais, contient quatre-vingt-quatorze titres, dont les deux tiers sont juridiques. Sur soixante-quatre titres de droit, on compte quatorze in-folio, vingt-cinq in-4°, deux in-8°, quinze in-12 et huit in-16 ou in-24. Les trente titres non juridiques sont pour la plupart des valeurs aussi sûres que les œuvres littéraires de Voiture, La Fontaine, Racine, Molière, Cervantes, Boursault, des traductions d’auteurs antiques ou des œuvres historiques, dont l’Histoire généalogique de la Maison de France du Père Anselme et l’Histoire de France de François Eudes de Mézeray, tous ouvrages propres à compenser, par leur facilité de débit, la lenteur de celui des ouvrages de droit.
65 Michel Simonin, « Peut-on parler de politique éditoriale au XVIe siècle ? Le cas de Vincent Sertenas, libraire du Palais », Le Livre dans l’Europe de la Renaissance…, ouvr. cit.
66 Marie-Anne Merland, « Tirage et vente de livres à la fin du XVIIIe siècle : des documents chiffrés », Revue française d’histoire du livre, 1973, III, 5, pp. 101-102.
67 « Quoique sa fortune fût médiocre [Jousse] et sa famille assez nombreuse, il dédaigna toujours les profits qu’il aurait pu tirer de ses nombreuses compositions. Leur mérite et leur utilité donnaient au débit de ses ouvrages une rapidité qui ne tourna qu’au profit du libraire Debure : celui-ci aimait à convenir que c’était surtout au don généreux que Jousse et Pothier lui avaient fait de leurs productions qu’il devait le succès de son établissement », d’après la Biographie universelle de Michaud, t. XXII, 1818, p. 61.
68 Plaidoyez de M. Claude Expilly…, Paris, veuve Abel L’Angelier, 1612.
69 Abrégé de la jurisprudence romaine…, par Claude Colombet, Paris, Michel Bobin et Nicolas Le Gras, 1671.
70 Les Œuvres de M. Charles Loyseau…, Paris, Guillaume Loyson, 1640.
71 « A Paris, au Palais, / Chez Le Gras, Libraire, Grand’Salle, à l’L couronné / Paulus-du-Mesnil, Imprimeur-Libraire, Grand’Salle, au pilier des Consultations, au Lion d’or / De Nully, Libraire, Grand’Salle, à l’Écu de France & à la Palme / De Bats, libraire, Grand’Salle, à S. François. » Citons encore l’important Dictionnaire des arrêts de Brillon en 6 vol. in-folio qui paraît en 1737 sous les quatre adresses conjointes de Guillaume Cavelier père, Michel Brunet et Nicolas Gosselin, libraires « Grand-Salle », et de Guillaume Cavelier fils, « ruë Saint-Jacques, au Lys d’or ».
72 Sur l’édition originale in-4° des Ordonnances de Louis XIV (…) d’aoust 1670 pour les matieres criminelles et (…) d’avril 1667 (…) pour les matieres civiles.
73 Sur le Stile universel de toutes les cours et juridictions du royaume… donné par Jacques Gauret, Paris, 1703.
74 Par exemple l’Ordonnance de Louis XIV sur les grosses fermes… publiée par Prault en 1717 et le Tarif général des droits des sorties et entrées du royaume… en 1722 par Jouvenel.
75 Cf. J. Quéniart, L’Imprimerie et la librairie à Rouen…, ouvr. cit., p. 26. Un procès de librairie de janvier 1662 nous apprend par exemple qu’une Coutume de Normandie, imprimée par Laurent III Maurry, a été tirée à mille huit cents exemplaires, chiffre révélant un titre de bonne vente. J.-D. Mellot, L’Édition rouennaise et ses marchés…, ouvr. cit., p. 123.
76 Citons la justification que Pardoux Du Prat donne de cet article dans le Recueil d’édits et ordonnances royaux de Pierre Néron et Girard, Paris, 1720, p. 487 : « Si chacun avait la licence d’imprimer un livre sans mettre ce qui est ici requis, la liberté de semer des hérésies ou d’injurier serait telle que l’univers serait infesté de telles pestes. »
77 Sur ce sujet, voir notamment : Bernard Barbiche, « Le régime de l’édition », dans Histoire de l’édition française, 1re éd., Paris, Promodis, t. I, 1982, pp. 367-377, et : « Les règlements », chapitre IX d’A. Flocon, ouvr. cit., pp. 399-422.
78 René Moulinas, L’Imprimerie, la librairie et la presse à Avignon au XVIIIe siècle, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1974 ; J. Quéniart, L’Imprimerie et la librairie à Rouen au XVIIIe siècle, ouvr. cit., pp. 22 et 107 ; J.-D. Mellot, L’Édition rouennaise et ses marchés…, ouvr. cit.
79 Le titre de la première édition est ainsi libellé : La // conference // des covstvmes // tant generales, qve locales // et particvlieres dv // Royaume de France. // Distribuée en deux parties : contenant l’Harmonie & difference d’icelles : // Avec vne briefue explication tirée des Loix Romaines ou Cano- // niques, Anciens Docteurs & Modernes. // Ensemble des Ordonnances & Arrests des Cours souueraines : Le tout pour seruir // d’interpretation & esclarcissement des Articles desdictes Coustumes. // Avec des Indices fort amples, tant des Titres que des principales matieres & Annotations. Celui de la seconde : La // conference // des covstvmes, // tant generales, qve locales et // particvlieres dv Royaume de France ; // distribuée en deux parties : contenant l’Har- // monie & difference d’icelles : // Avec vne briefue explication tirée des Loix Romaines ou Canoniques, // Anciens Docteurs & Modernes : // Ensemble des Ordonnances & Arrests des Cours Souueraines ; Le tout // pour seruir d’interpretation & esclarcissement des Articles // desdictes Coustumes, Auec des Indices fort amples.
80 D’après H.-J. Martin, Livre, pouvoirs et société…, ouvr. cit., t. I, p. 378, n. 64.
81 À Rouen, sur deux cent soixante-treize éditions dont on connaît le tirage au XVIIIe siècle, cent douze sont tirées à douze cents exemplaires, dix-neuf à mille, cent sept à sept cent cinquante et deux à six cents. Cf. J. Quéniart, L’Imprimerie et la librairie à Rouen…, ouvr. cit., p. 100.
82 Pour imprimer un in-folio d’environ douze cents pages, format habituel pour nombre de livres juridiques, soit deux cent cinquante à trois cents feuilles, il faut, à raison d’une feuille par jour, rythme difficile à tenir, près d’un an s’il est assuré par une seule presse, auquel s’ajoute un délai de composition d’un à deux ans si celle-ci est effectuée par un seul compagnon. Il n’y a donc d’autre solution, pour abréger les délais, que de confier l’exécution d’un même livre à plusieurs presses, souvent distribuées entre plusieurs ateliers. Cela explique que les contrefaçons, réalisées à la hâte pour prendre de vitesse l’original ou profiter au plus vite de son succès, soient si souvent fautives.
83 M.-A. Merland, « Tirage et vente de livres… », art. cit., p. 104.
84 Mais pas nécessairement, comme le démontre l’étude précitée de R. Moulinas. À Avignon, où le papier et la main-d’œuvre sont moins chers qu’ailleurs, on édite des contrefaçons moins coûteuses, quoique de qualité formelle égale, sinon supérieure, aux originaux édités par les autres centres.
85 Cette filiation des deux œuvres est parfaitement mise en lumière par Claude-Joseph de Ferrière dans la préface de la Nouvelle Introduction à la pratique : « Le désir que la nature inspire à l’homme de se rendre utile au public, soutenu par l’éducation que j’ai reçue de feu mon père et encore plus par l’exemple qu’il m’a donné, me porte à revoir quelques-uns de ses ouvrages, et à y faire des changemens et des augmentations dont ils me paraissent avoir besoin (…). De tous les livres qu’il a donnés au public, l’Introduction à la pratique m’a paru un des plus utiles, mais ce n’était qu’un très petit volume, il ne pouvait être regardé que comme un essai, ou même un canevas qui avait besoin d’être conduit à sa perfection. Par les soins que j’ai pris pour y parvenir, j’en ai fait un nouvel ouvrage (…), ceux qui ne font que commencer à s’appliquer à la jurisprudence et à la pratique y trouveront un secours propre à rendre leurs études, et plus faciles, et moins désagréables. À l’égard de ceux qui ont déjà fait quelque progrès, j’ai donné récemment un Dictionnaire de droit et de pratique en deux volumes in-quarto, qui pourra leur être très utile… » (éd. de Bruxelles, « par la Société », 1739).
86 Dans notre collection.
87 Privilège de la Nouvelle Introduction à la pratique, ouvr. cit., qui se conclut par cette formule en appliquant les termes : « Le sieur de Ferrière a cédé son droit au présent privilège, pour l’Introduction à la pratique seulement, aux sieurs Brunet et Prudhomme, libraires à Paris, suivant l’accord fait entr’eux ».
88 R. Doucet, Les Bibliothèques parisiennes au XVIe siècle…, ouvr. cit., p. 26.
89 Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, criminelle, canonique et bénéficiale ; ouvrage de plusieurs jurisconsultes, mis en ordre et publié par M. Guyot, Paris, « chez Panckoucke (…), et se trouve chez les principaux libraires de France », 1776-1786.
90 Par livre illustré ou historié nous entendons ici essentiellement tout livre dont le corps du texte est agrémenté de figures, en nombre plus ou moins important, dont le sujet d’inspiration est en rapport avec le contenu de celui-ci. Cela n’inclut donc pas les frontispices, portraits ou allégories isolés, qui s’y rattachent toutefois et que nous évoquerons en premier lieu ; cela exclut toutes les lettres ornées, bandeaux, culs-de-lampe, marques d’imprimeurs ainsi que les autres motifs purement décoratifs qui appartiennent à un fonds général d’ornements utilisés indifféremment pour tous genres de livres. Nous n’évoquerons que ceux, assez rares, conçus spécifiquement pour les livres juridiques.
91 Decisiones parlamenti Dalphinalis Gratianopolis per (…) Guidonem Pape…, Lyon, Simon Vincent, 1520.
92 Tiraquelli (…) commentariorum de utroque retractatu, et municipali et conventionali. Editio tertia…, Venezia, 1554.
93 De la même façon qu’en architecture le « frontispice » désigne la façade principale d’un édifice, celle qu’on découvre au premier coup d’œil et sur laquelle s’exerce de préférence le talent de l’architecte et du sculpteur, en typographie il désigne communément la première page d’un livre lorsqu’elle a bénéficié d’une décoration gravée. Ce peut être la page de titre qui a été dotée d’un décor encadrant totalement le titre, procédé qui apparaît en premier (on la qualifie alors plus précisément de « titre illustré ») ; ce peut être aussi, usage qui sera couramment pratiqué à partir du XVIIe siècle, une page spécifique placée avant ou en regard de la page de titre, contenant soit une allégorie symbolisant l’esprit de l’ouvrage, soit le portrait de l’auteur ou du dédicataire (seule qualifiée de frontispice à proprement parler). La même fonction, plus économique, pourra être aussi remplie par une « vignette de titre », gravure de moindre surface, placée généralement entre le titre et l’adresse. Cette dernière ne doit pas être confondue avec la marque de l’imprimeur, souvent pittoresque au XVIe siècle, qui est sans rapport avec le contenu de l’ouvrage concerné (sauf rapport fictif s’agissant des quelques imprimeurs ayant choisi la figure de la Justice comme marque). Enfin, remplissant la même fonction que le frontispice, mais à l’échelon de chaque titre ou partie qu’ils ouvrent, des « bandeaux d’en-tête » peuvent aussi à l’occasion être gravés de figures symboliques.
94 Reproduit dans l’ouvrage du prince d’Essling, Études sur l’art de la gravure sur bois à Venise. Les livres à figures vénitiens de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe (1450-1525), Firenze, Leo S. Olschki ; Paris, Henri Lerclerc, 1907-1914, t. III, 505. Les trois ouvrages auxquels il sert de frontispice sont : Joannes Crottus, Tractatus de testibus, 25 mai 1523 ; D. Luis Gomes, Novissima Commentaria super titulo Institutionum de actionibus, 15 septembre 1523 ; Hippolyte de Marsiliis, Commentaria super titulis (…) de parricidi…, 14 janvier 1524.
95 Reproduit par Baudrier, ouvr. cit., t. XI, 424 ter. Cet auteur reproduit au long de son travail de nombreux autres frontispices et encadrements du même type.
96 Ibid., t. V, 443. Sur Portonariis et l’Espagne, voir aussi Gérard Morisse, « Libraires lyonnais en Castille au XVIe siècle : l’édition espagnole de la Bible de Vatable (1568-1596) », Revue française d’histoire du livre, 2002-1, nos 114-115, pp. 53-78, ill.
97 Ibid., t. XI, 407 bis.
98 Ouvrages de Ceppola et de Guy Pape de notre collection. Dans cet exemplaire de Pape, le possesseur du temps qui a laissé son ex-libris, un certain Pierre Gavaud, a ajouté les noms de sa main. Malheureusement nous ne sommes certains que de la lecture de celui de Cicéron.
99 Notre exemplaire (les ouvrages dont les gravures seront décrites ici sans autre précision d’origine viennent de notre collection). Un frontispice quasi identique à quelques différences de décor près, présentant les mêmes personnages, orne aussi une autre édition du Décret donnée à Paris en 1550 chez Jacques Bonhomme. Il est reproduit dans le catalogue des ouvrages du XVIe siècle de la Bibliothèque universitaire de Poitiers, 1988, t. III, p. 336. Nous savons gré aux conservateurs de cette bibliothèque d’avoir suivi l’exemple de Baudrier pour Lyon et d’être ainsi parmi les très rares éditeurs de catalogues à avoir compris tout l’intérêt qu’il y avait à signaler, et mieux encore, à reproduire largement, les figures des ouvrages décrits.
100 Édition qui, selon B. Moreau (Inventaire chronologique des éditions parisiennes, ouvr. cit., t. III, 141), est une nouvelle édition augmentée de l’édition de 1528 (II, 1414). Nous ignorons si la première est également ornée, ce qui nous amène à déplorer que ce précieux inventaire ait l’inconvénient, commun à la multitude des bibliographies qui ne concernent pas directement les ouvrages possédant le statut d’ouvrages illustrés, d’ignorer la présence de figures. Or, outre ce titre orné, cet ouvrage comporte une belle planche à pleine page de l’arbre de parenté. Cette regrettable lacune généralisée ne permet pas de faire de recherches systématiques dans de telles bibliographies pour repérer la présence de gravures et oblige à procéder empiriquement en examinant systématiquement tous les ouvrages que l’on a la chance de rencontrer. Il est de ce fait difficile de se faire une idée précise et du nombre et de la fréquence des figures dans les livres de droit, ce qui laisse entier ce champ de recherche qui ne peut guère être cultivé aujourd’hui que devant les rayonnages des fonds anciens de droit, en feuilletant livre après livre.
101 Nous ne pouvons omettre de signaler, en dernière minute, que nous venons de faire l’acquisition d’une édition d’un autre coutumier de Bourgogne, commenté par Chasseneuz, imprimé à Lyon en 1528 pour Simon Vincent, comportant plusieurs illustrations. Le titre figure dans un encadrement à peu près semblable à celui de l’éditeur Regnault, garni comme lui de dix jurisconsultes nommés, mais cet encadrement est répété au verso pour loger une dédicace au roi avec dix nouveaux noms placés au pied des portraits. Il est en outre orné d’un autre fort beau frontispice figurant l’auteur offrant son ouvrage (Cf. pl. 24), d’une suite de six arbres de parenté et d’une grande capitale ornée d’une scène d’investiture.
102 Sur lequel voir : Frédéric Barbier, « L’imprimerie, la Réforme et l’Allemagne : le cas de Nicolas Bassé, valenciennois », Valentiana, 1993, 12, pp. 9-16.
103 Véritable spécialiste du frontispice. Les œuvres de Gaultier sont citées plus d’une centaine de fois par Jeanne Duportal, Contribution au catalogue général des livres à figures du XVIIe siècle (1601-1633), thèse complémentaire, Paris, Champion, 1914. Cet auteur, une fois n’est pas coutume, classe, année par année, les vignettes par thèmes, en faisant une place à la rubrique « jurisprudence ». Fait significatif, c’est la moins étoffée de toutes et la seule à être le plus souvent vide.
104 D’après J. Duportal, ouvr. cit., 534.
105 A. Gouron, O. Terrin, Bibliographie des coutumes, ouvr. cit., ne signalent pas non plus les frontispices, portraits et vignettes qui ornent les coutumiers.
106 Nous avons rencontré plusieurs portraits différents dans les éditions de Tiraqueau. Le plus connu est reproduit par Baudrier, ouvr. cit., t. IX, 211. Il est dû à l’initiative de l’éditeur lyonnais Guillaume I Rouillé lequel, en 1554, dota ses œuvres d’un encadrement de titre purement décoratif mais contenant au verso le portrait de l’auteur accompagné d’un poème. La disposition de ce feuillet de titre fut régulièrement utilisée par la suite.
107 Reproduit par Baudrier, ouvr. cit., t. VII, 435.
108 Le portrait de Cochin est notre préféré. C’est le seul que nous ayons rencontré en frontispice montrant un juriste au visage avenant. Il arbore en effet un léger sourire mi-satisfait, mi-bon-homme, qui contraste avec les visages habituellement graves et aux traits sévères de ses homologues gravés.
109 D’après J. Duportal, Étude sur les livres à figures édités en France de 1601 à 1660, ouvr. cit., pp. 281 et 280.
110 Frontispice d’une thèse de 1695 reproduit dans : Association française pour l’histoire de la Justice, La Justice en ses temples. Regards sur l’architecture judiciaire en France, Poitiers, Brissaud, 1992, p. 49.
111 D’après Duportal, Étude sur les livres à figures…, ouvr. cit., p. 211 : Sr de Sainctyon, Les Édits et ordonnances des Rois, coustumes des provinces, arrests et jugemens notables des Eaux et Forests…, Paris, 1610 (Bibliothèque de l’Institut, L. 181).
112 Reproduits dans : prince d’Essling, Études sur l’art de la gravure sur bois, ouvr. cit., t. III, 441 et 156.
113 Voir par exemple des reproductions de cette figure impériale dans Baudrier, ouvr. cit., t. VII, 320 bis et ter, t. XI, 219 bis, et dans le Catalogue des ouvrages du XVIe siècle… de la Bibliothèque universitaire de Poitiers, ouvr. cit., t. III, pp. 355, 374 et 375.
114 Comme par exemple le frontispice de la Practica de Giampietro Ferrari éditée à Lyon en 1524 par Jacques Giunta. Cet encadrement comprend en outre une belle vignette double placée entre le nom de l’auteur et le titre figurant l’auteur en chaire enseignant un groupe de disciples, tandis qu’on voit, hors de la salle de cours, se presser deux cavaliers venus de loin écouter le maître. Le même encadrement est réutilisé en 1536 pour le commentaire des Institutes de Angelus de Aretio, la seule différence entre les deux frontispices résidant dans le mention « Jo. p.f. » placée au pied de la chaire du premier et « Angel. » au pied de la chaire du second. Ce dernier frontispice est reproduit par Baudrier, ouvr. cit., t. VI, 168.
115 Dans les Décrétales de Grégoire IX, publiées à Venise en 1514 par Lucantonio I Giunta, ces deux arbres sont placés en vis-à-vis, le premier à symboles fructifères, le second à symboles floraux. On trouvera reproduits de tels arbres dans Baudrier, ouvr. cit., t. XI, 103 bis, et dans le Catalogue des ouvrages du XVIe siècle… de la Bibliothèque universitaire de Poitiers, t. III, 341.
116 Reproduit dans : prince d’Essling, Études sur l’art de la gravure sur bois à Venise, ouvr. cit., t. I, 499-500.
117 Ouvrages décrits et figures reproduites dans le Catalogue des ouvrages du XVIe siècle… de la Bibliothèque universitaire de Poitiers, t. III, pp. 345-346, 370, 369 et 378. A fortiori les arbres de parenté ornent les traités spécifiques consacrés à cette épineuse question. Par exemple celui de Jean d’Andréa, Arbor consanguinitatis cum suis enigmatibus & figuris, dont l’édition de Höltzel, Nürnberg, 1505, contient quatorze figures dues à Hans Baldung Grien.
118 Notamment des vignettes en hommage au roi, tel cet en-tête de dédicace figurant la Justice couronnant l’effigie de Louis XVI, accompagné d’une capitale ornée au soleil rayonnant, dans Loix criminelles de France de Muyart de Vouglans (Paris, Mérigot, 1780), ou cette vignette à la place de la marque d’imprimeur, figurant les allégories de la Loi et de la Justice encadrant les grandes armes de France sur le titre des Œuvres de Charles Loyseau (Paris, Guillaume Loyson, 1640) (Cf. pl. 33, fig. 86). Signalons en passant, sans en tirer de conclusion pour ne pas avoir approfondi cette question, que l’allégorie de la Justice est utilisée assez fréquemment par les imprimeurs et sert même parfois de marque à certains d’entre eux. Ce fut le cas au XVIe siècle pour les imprimeurs vénitiens Alessandro, Benedetto, Agostino et Francesco Bindoni (dont quatre modèles différents sont reproduits par le prince d’Essling, ouvr. cit., t. IV, p. 178). Elle figure également, en plusieurs modèles, à partir du milieu du XVIe et au XVIIe siècle, au sommet d’un encadrement entourant un lion sur la marque de la Compagnie des libraires de Lyon (reproductions dans Dureau-Lapeyssonnie, « Recherches sur les grandes compagnies de libraires lyonnais… », art. cit.); plusieurs imprimeurs helvétiques l’utilisent encore au XVIIIe siècle (une vingtaine d’allégories différentes sont reproduites par Silvio Corsini, La Preuve par les fleurons ? Analyse comparée du matériel ornemental des imprimeurs suisses romands 1775-1785, Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du XVIIIe siècle, 1999).
119 Citons trois bandeaux de ce type dérivés d’un même dessin et qui ne diffèrent que par de légers détails d’exécution : sur le commentaire de la coutume de Bretagne par Bertrand d’Argentré (Paris, Nicolas Buon, 1608), sur les Œuvres de Jean Bacquet (Paris, Guillaume de Luynes, 1688), et, pour évoquer une autre discipline, sur les Œuvres du médecin André Du Laurens (Paris, Augustin Courbé, 1646), tous les trois de format in-folio.
120 Prince d’Essling, Études sur l’art de la gravure sur bois à Venise…, ouvr. cit., 1907-1914, 3 parties en 6 volumes in-4°.
121 Ibid., I, 348 ; II, 495-496 ; III, 274 et 275 ; III, 668 ; III, 317.
122 Que nous citons d’après l’édition dont nous disposons, inconnue du prince d’Essling, éditée sous l’adresse d’Ottaviano I Scoto, avec la mention « ultima editio ». Elle constitue vraisemblablement une nouvelle édition de celle qu’il décrit, publiée en 1522 à l’adresse des héritiers du même Scoto (« haeredes Octaviani Scoti »). Toutefois la collation en est légèrement différente et surtout les vignettes de la nôtre en ont peut-être été regravées. En effet la première vignette, reproduite dans la bibliographie du prince d’Essling, porte une signature, l’initiale C, absente de la nôtre, dont elle diffère par d’infimes détails.
123 On trouvera la description détaillée des diverses éditions des œuvres de Damhoudère dans la Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas, rééd., Bruxelles, Culture et civilisation, 1979, t. II, pp. 9-45. La Pratique criminelle a eu, entre 1551 et 1660, trente-sept éditions qui manifestent bien son succès international, en latin, français, néerlandais et allemand, issues de douze centres différents : Bruges, Louvain, Anvers, Venise, Lyon, Francfort, Cologne, Wurzbourg, Paris, Amsterdam, Rotterdam et Utrecht. La Pratique civile a eu quant à elle neuf éditions en latin, français et néerlandais. Il faut y ajouter encore six autres éditions de ces deux œuvres réunies ou contenues dans des œuvres complètes.
124 Tel que l’exemplaire du Vieux Coustumier de Poictou de la Bibliothèque municipale de Niort, de la deuxième moitié du XVe siècle, qui contient soixante et onze dessins à la plume rehaussés de couleurs, placés en tête de chaque titre. Son édition critique, illustrée de la reproduction de toutes les figures, a été donnée en 1956 par notre maître René Filhol. Il constitue le premier volume des « Travaux de la Société d’histoire du droit et des institutions des pays de l’ouest de la France » (Bourges, Tardy). Un autre manuscrit enluminé de ce même Vieux Coustumier de Poictou, de 1499, est conservé à la Bibliothèque de la Cour de cassation (ms. 141). Citons encore deux autres manuscrits de droit enluminés conservés à la Bibliothèque nationale de France : les Établissements de saint Louis, de la fin du XIIIe siècle (ms. fr. 5899), et la Pratique judiciaire à l’usage d’Auvergne de J. Masuer, de 1483 (ms. fr. 4368).
125 Lettres reproduites dans le Catalogue des ouvrages du XVIe siècle…, ouvr. cit., t. III, pp. 356, 365 et 366.
126 Dix de ces vignettes sont reproduites dans le Catalogue des ouvrages du XVIe siècle…, ouvr. cit., t. III, pp. 370-371.
127 J. Duportal, Contribution au catalogue général des livres à figures du XVIIe siècle, ouvr. cit., et Étude sur les livres à figures édités en France de 1601 à 1660, ouvr. cit. ; Mme Stéphan Tchemerzine, Avenir Tchemerzine, Répertoire de livres à figures rares et précieux édités en France au XVIIe siècle contenant environ 1500 fac-similés de frontispices, titres et figures…, Paris, P. Catin, 1933 ; Henri Cohen, Guide de l’amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle, 6e éd. Paris, Rouquette, 1912.
Cette absence de référence à tout livre de droit illustré dans ces grandes bibliographies généralistes qui ont tendance à privilégier textes littéraires, religieux ou historiques ne signifie pas nécessairement qu’il n’en n’existe point, mais à coup sûr laisse présumer qu’ils sont rarissimes et font figure d’exception. Citons par exemple celle, assez tardive, des Coutumes générales d’Artois, annotées par Adrien Maillard (Paris, Jean Rouy, 1739), ornées de huit grandes vignettes illustrant divers stades de la procédure et du jugement, dont une planche d’exécution par pendaison. Fausse exception d’ailleurs, car il ne s’agit pas d’une illustration originale mais de la reproduction, dans une perspective quasi archéologique, des miniatures ornant un manuscrit sur vélin du XIVe siècle de la Bibliothèque du Roi.
128 À Berlin (sic pour Paris), sans nom d’éditeur. Cohen, Guide de l’amateur de livres à gravures…, ouvr. cit., 365.
129 Cohen, Guide de l’amateur de livres à gravures…, ouvr. cit., 863. Sur cette célèbre affaire qui a fourni le sujet de Thérèse philosophe (Mademoiselle Éradice est l’anagramme de Cadière) et sur ce curieux illustré, voir aussi le développement de Pascal Pia, Les Livres de l’Enfer. Bibliographie critique des ouvrages érotiques dans leurs différentes éditions du XVIe siècle à nos jours, Paris, Coulet et Faure, 1978, t. I, p. 592.
130 À Amsterdam par Lareman et à Leyde par Verboeck, 5 vol. in-12. Cf. Cohen, Guide de l’amateur de livres à gravures, ouvr. cit., 869.
131 À l’époque contemporaine un quarteron de crayons facétieux s’est chargé de venger quatre siècles de vacuité iconographique avec un Code civil illustré par Hémard de soixante-quatre vignettes humoristiques (Paris, R. Kieffer, 1925) ; un Code Napoléon en vers, préfacé par Me Maurice Garçon et illustré par Pierre Noël de soixante bois en couleur (L’Intermédiaire du bibliophile, 1932) ; un Code général des impôts, illustré de quarante-deux compositions, aussi peu conventionnelles que possible, de Dubout (Gonon, 1958) ; un Code pénal, illustré par l’humoriste belge Jean Dratz de pas moins de cent vingt-six pochoirs (Brachot, 1950) et un autre par Siné (Gonon, 1958).
132 Post-scriptum. La publication de ces notes relève pour ainsi dire du hasard. Elles n’étaient à l’origine destinées qu’à servir de substrat à un chapitre d’un cours de bibliographie appliquée à l’histoire du droit. Si nous les avons quelque peu revues et mises en forme à cette occasion, elles reposent moins sur des recherches conduites auprès des sources originales que sur le fruit de notre propre expérience pratique du livre, acquise tant dans le cadre de notre profession d’historien du droit que dans le suivi des affaires d’une librairie ancienne et maison d’édition familiale, complétée par la consultation des bibliographies et la lecture d’études spécialisées. Aussi laissent-elles subsister bien des incertitudes et des lacunes, que seules de longues et systématiques recherches pourraient lever. Comme telles, elles conservent néanmoins l’ambition d’avoir quelque peu déblayé le terrain dans un domaine resté vierge à ce jour et désigné de multiples pistes de recherche (nous aurions pu les prolonger au-delà de la Révolution et tirer les mêmes conclusions pour la période suivante quant à la nécessité d’en entreprendre l’étude approfondie). Si leur lecture pouvait donner à quelque doctorant le désir de se lancer dans l’aventure d’une recherche sur le sujet général de l’édition juridique ou sur l’un de ses aspects particuliers, nous nous estimerions suffisamment récompensé de nos propres efforts pour l’avoir mis en vedette. Des sujets aussi totalement neufs et féconds que celui-ci ne sont plus légion.